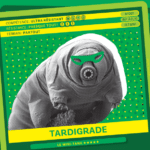Si la santé des hommes et des femmes est impactée par les différences biologiques sexuelles, celles-ci sont-elles uniquement d’origine physiologique ? Ne s’expliquent-elles pas aussi par des mécanismes sociaux liés au genre ? C’est ce que se propose de démontrer Hélène Colineaux, médecin de santé publique et docteure en épidémiologie sociale, dans Déconstruire les différences de sexe. Cet ouvrage passionnant parvient à mettre à la portée même des non spécialistes l’essentiel du travail de recherche de l’autrice. Et à en expliquer les enjeux, car comprendre que les différences physiologiques hommes-femmes ne sont pas que « naturelles », mais « reposent, au moins en partie, sur des mécanismes sociaux », c’est comprendre aussi qu’on peut les « réduire ». En effet « si on ne peut pas modifier le génome », on peut en revanche « agir d’un point de vue de santé publique (sur) l’environnement social, la socialisation, les comportements… », conclut Hélène Colineaux.
Si la santé des hommes et des femmes est impactée par les différences biologiques sexuelles, celles-ci sont-elles uniquement d’origine physiologique ? Ne s’expliquent-elles pas aussi par des mécanismes sociaux liés au genre ? C’est ce que se propose de démontrer Hélène Colineaux, médecin de santé publique et docteure en épidémiologie sociale, dans Déconstruire les différences de sexe. Cet ouvrage passionnant parvient à mettre à la portée même des non spécialistes l’essentiel du travail de recherche de l’autrice. Et à en expliquer les enjeux, car comprendre que les différences physiologiques hommes-femmes ne sont pas que « naturelles », mais « reposent, au moins en partie, sur des mécanismes sociaux », c’est comprendre aussi qu’on peut les « réduire ». En effet « si on ne peut pas modifier le génome », on peut en revanche « agir d’un point de vue de santé publique (sur) l’environnement social, la socialisation, les comportements… », conclut Hélène Colineaux.
En quoi consiste l’épidémiologie et quels sont les enjeux de l’épidémiologie sociale, au cœur de votre travail de recherche ?
 La recherche en épidémiologie – de « épi- », autour, « demos », le peuple, la population, et « -logie », la science, la connaissance – s’intéresse à la santé des populations : Qu’est-ce qui cause les maladies ? Pourquoi tel groupe est-il plus touché par tel cancer que tel autre groupe ? Quelle prise en charge améliore la survie après un infarctus ? Et cetera. Il y a plusieurs domaines, certains sont définis à partir d’un type de pathologie (épidémiologie des maladies cardiovasculaires, par exemple), d’un groupe (épidémiologie pédiatrique) ou d’un type d’exposition, c’est-à-dire d’un phénomène dont on étudie l’impact sur la biologie et la santé. L’épidémiologie environnementale par exemple étudie l’impact des facteurs présents dans l’environnement, comme la pollution, sur la santé. L’épidémiologie sociale fait aussi partie de ce dernier groupe : l’enjeu est de comprendre quels facteurs sociaux impactent la santé et comment.
La recherche en épidémiologie – de « épi- », autour, « demos », le peuple, la population, et « -logie », la science, la connaissance – s’intéresse à la santé des populations : Qu’est-ce qui cause les maladies ? Pourquoi tel groupe est-il plus touché par tel cancer que tel autre groupe ? Quelle prise en charge améliore la survie après un infarctus ? Et cetera. Il y a plusieurs domaines, certains sont définis à partir d’un type de pathologie (épidémiologie des maladies cardiovasculaires, par exemple), d’un groupe (épidémiologie pédiatrique) ou d’un type d’exposition, c’est-à-dire d’un phénomène dont on étudie l’impact sur la biologie et la santé. L’épidémiologie environnementale par exemple étudie l’impact des facteurs présents dans l’environnement, comme la pollution, sur la santé. L’épidémiologie sociale fait aussi partie de ce dernier groupe : l’enjeu est de comprendre quels facteurs sociaux impactent la santé et comment.
Cet enjeu, pour l’épidémiologiste, nécessite d’avoir une compréhension fine des phénomènes de santé mais aussi des faits sociaux et de la façon de les appréhender : Qu’est-ce qu’être défavorisé ou favorisé socialement ? Qu’est-ce que l’isolement social ? Comment mesurer la classe sociale ? Ces questions nous font naviguer régulièrement dans les eaux des sciences humaines et sociales, dont nous avons besoin, bien que nous ayons notre épistémologie et nos objectifs propres. C’est ce qui motive d’ailleurs le travail rapporté dans ce livre : qu’est-ce que le « genre » et que devient le « genre » sous le regard de l’épidémiologiste qui cherche à comprendre, utiliser ou agir sur les différences biologiques observées entre les femmes et les hommes ?
S’il y a impact du genre sur la biologie et la santé, diriez-vous qu’il y a déjà, aussi, un biais de genre dans la production des connaissances scientifiques ?
Qu’est-ce qu’un biais ? C’est une erreur qui, par sa répétition, produit une connaissance déformée de la réalité. Par exemple, une balance qui donne un poids systématiquement inferieur au poids « vrai » est biaisée. D’une certaine façon, on peut considérer que la pratique scientifique consiste à mettre en place des méthodes pour produire des connaissances affranchies de biais. Mais ce serait une erreur que croire que cette connaissance n’est pas non plus biaisée (sans toutefois la mettre sur le même plan que celle d’une expérience ou opinion individuelle). Ce n’est simplement pas binaire « avec ou sans biais », c’est plutôt une histoire de degré : une balance même bien calibrée sera toujours légèrement biaisée (on ne le saura jamais !) mais évidemment moins qu’une simple estimation visuelle par une personne en particulier.
Il est souvent plus prudent et pragmatique de partir du principe que nos méthodes et connaissances sont forcément biaisées, et viser l’identification d’un maximum de ces biais, et leur réduction quand cela est possible. Cela fait d’ailleurs toujours partie de nos méthodologies de recherche. Le genre est un prisme par lequel on peut évaluer ces biais : quels types de personnes produisent la recherche et dans quel contexte de contraintes, de pouvoirs, de rapports de domination ? Qu’est-ce qui fait de tel ou tel phénomène un objet de connaissance ou un objet d’ignorance ? Quelles thématiques suscite l’intérêt des chercheur·es ? Qu’est-ce qui leur assure du prestige, des postes, des financements ? Quelles mesures sont utilisées pour mesurer un phénomène, tel que la dépression, et mesurent-elles la même chose en fonction du genre ?, etc. Dans cet ouvrage, je m’intéresse plus spécifiquement à la façon dont un apriori (« les différences biologiques entre les hommes et les femmes sont dues au dimorphisme sexuel ») peut biaiser nos choix méthodologiques et l’interprétation des résultats, et je tente de déconstruire cet apriori.
Les différences biologiques entre les femmes et les hommes ne sont donc pas uniquement physiologiques, mais s’expliquent aussi par des mécanismes socio-politico-historiques liés au genre ?
Le « social » et « biologique » ne sont pas cloisonnés. Notamment, la vie que nous vivons et le contexte dans lequel nous évoluons viennent en permanence modifier notre biologie. Une situation donnée va activer tel ou tel système physiologique, qui va répondre à la demande mais aussi se modifier lui-même pour s’adapter. Aucun état biologique observé à un moment donné ne peut donc être compris sans son environnement présent et passé. En épidémiologie sociale, on parle d’incorporation biologique et cela nous permet de comprendre les mécanismes de certaines inégalités sociales de santé. Selon le contexte social, du foyer aux conditions socio-historiques, les individus ne sont pas confrontés aux mêmes expériences et ne produiront donc pas en moyenne les mêmes réponses biologiques. Les structures sociales viennent donc structurer la biologie et la santé des individus.
Or, le genre est l’une de ces structures sociales, sans doute encore l’une des plus fortes. En raison du système de genre, les personnes, selon leur sexe assigné à la naissance ou in-utero, ne seront pas en moyenne soumises aux mêmes expositions physiques, sociales, économiques, culturelles, affectives et émotionnelles, ne seront pas socialisées de la même façon, ne subiront pas les mêmes facteurs de stress, ni ne les percevront et n’y réagiront de la même manière, n’intégreront pas les mêmes habitudes, n’adopteront pas les mêmes comportements, etc. Pour ces raisons, les catégorisé·es hommes et les catégorisé·es femmes, indépendamment de leur biologie innée, ne produiront en moyenne pas les mêmes réponses biologiques. Ainsi, la structuration sociale genrée conduit à une biologie et une santé genrées.
Peut-on même parler d’interaction entre mécanismes sociaux et mécanismes biologiques ?
Oui, d’une certaine façon. Et l’impact de ces deux facteurs est sans doute indémêlable complètement. Ils sont pourtant rarement analysés ensemble, car répartis en quelque sorte entre des disciplines qui, elles, interagissent assez peu. L’enjeu est donc, à mon sens, que les chercheur·es des sciences sociales qui s’intéressent au genre ne délaissent pas le « biologique », même si cela peut leur sembler risqué, « touchy », car flirtant avec les théories essentialistes. Mais justement : n’abandonnons pas ces aspects aux thèses naturalistes et entrons dans le débat. L’enjeu est aussi que les chercheur·es des sciences biomédicales de leur côté ne négligent ni ne sous-estiment l’impact des mécanismes sociaux. Etudier la santé humaine tout en ignorant cette immense part de nous qui interagit en permanence avec notre biologie, c’est construire une connaissance dangereusement biaisée.
La nature (le biologique) est donc construite par la culture (le social) : pouvez-vous nous donner des exemples concrets de la manière dont cette « structuration sociale genrée » conduit à une « construction genrée de la biologie et de la santé » ?
Il n’est pas aisé de donner des exemples concrets car je prends le phénomène (cette « structuration sociale genrée ») comme un tout complexe et multidimensionnel, alors qu’il est peut-être plus facilement compris lorsqu’on le découpe en différents chemins. On peut par exemple le regarder par l’angle des habitudes et comportements : la socialisation genrée conduit à des différences de rapports et donc de pratiques concernant l’alimentation, le tabagisme, la consommation d’alcool, la prise de risque, etc. Tout cela conduit nécessairement à des différences biologiques (par exemple en terme de taux de cholestérol, de glycémie) puis de santé (par exemple de risque d’infarctus ou de cancers). On peut aussi penser à la construction genrée du rapport au corps, à la sante, à la recherche d’aide, au système de santé, etc., ce qui va évidemment avoir un impact sur la sante, par exemple en terme de délai pour poser un diagnostic et entreprendre un traitement.
Mais il ne s’agit que de faces émergées de l’iceberg. Le système de genre est diffus, à tel point que l’on peut dire que chaque aspect de la vie d’un être humain est influencé par les normes de genre de sa société. En moyenne, l’accès à l’éducation, aux connaissances, au pouvoir, aux ressources financières, aux responsabilités domestiques, aux relations sociales et affectives, au stress et aux ressources pour s’y adapter, etc. ne sont pas les mêmes en fonction de la catégorie de sexe attribuée à la naissance. Techniquement, on ne peut bien sûr pas prendre en compte tous ces aspects, mais lorsqu’on simule des scenarios dans lesquels les hommes et les femmes auraient certains mêmes comportements, ressources et contraintes, certaines différences biologiques sont modifiées. Par exemple, dans l’une des populations que j’ai étudiée, les différences de tension artérielle seraient réduites de 12%, et, puisque nous n’avons bien sûr pas pris en compte tous les mécanismes de genre, cela pourrait être compris comme « au moins 12% ».
J’en profite pour repréciser ici qu’en épidémiologie, nous étudions « les populations » par le biais de méthodes statistiques et non des situations individuelles particulières, c’est pourquoi j’utilise souvent l’expression « en moyenne ». Lorsqu’on parle de « structuration sociale genrée », c’est à ce niveau, populationnel, que l’on se situe. On pense ici le « genre » comme un système normatif qui influence la vie des personnes en fonction de leur catégorie de sexe et qui va créer des différences entre les femmes et les hommes, observables seulement à l’échelle de la population. Individuellement, une personne donnée n’aura pas forcément conscience de ces normes et de la façon dont elles l’influencent, elle n’aura évidemment pas la trajectoire « typique », « moyenne » de sa catégorie de sexe, et il sera difficile de savoir si l’une de ses caractéristiques en particulier est due au genre ou à d’autres influences auxquelles elle a été soumise. Cette perspective populationnelle est sans doute difficile à saisir car elle est difficilement transposable à notre vécu de tous les jours.
Dans son approche des notions de sexe et de genre, longtemps utilisées indifféremment dans la littérature biomédicale – par méconnaissance ou par pragmatisme, dites-vous – la recherche a donc dû évoluer : où en est-on actuellement ?
J’aurais envie de dire que ces notions sont globalement mieux comprises et prises en compte aujourd’hui, mais je ne peux exclure un biais de perception lié au fait qu’il s’agit de ma thématique de recherche et donc que je côtoie de plus en plus de personnes qui s’y intéressent ! En tout cas, le champ de la recherche « du social au biologique » sensible aux questions de genre, bien qu’encore très marginal, est actuellement en ébullition, ce qui promet des avancées intéressantes dans les prochaines années.
Mais globalement dans la recherche biomédicale, je dirais que l’approche qui prévaut aujourd’hui est l’approche dite « sexe-spécifique », c’est-à-dire que l’on va effectuer les recherches, et donc produire la connaissance, séparément pour les catégories « hommes » et « femmes », de façon quasi-systématique. C’est même parfois exigé par les revues dans lesquelles nos résultats sont publiés. Cette approche a été initialement recommandée pour tenter de lutter contre certains biais de genre qui invisibilisaient, négligeaient et désavantageaient en particulier les femmes. Cette approche a cependant des inconvénients. Elle tend notamment à exagérer les différences entre les catégories de sexe, à auto-entretenir et auto-justifier cette binarisation de l’humanité, à effacer les situations d’intersexuations ou de transidentités, et à sous-estimer les différences liées à la classe sociale, à la catégorie de race, à l’âge, etc. à l’intérieur des groupes. Cette approche entretient aussi la confusion entre le sexe et le genre, car cette catégorisation englobe finalement tout ce qui différencie les hommes des femmes, sur le plan biologique et social, se passant pour cela d’hypothèses ou de justifications. Les différences observées sont alors ouvertes à des interprétations variées selon les auteur.es et les disciplines, et donc encore trop souvent attribuées sans réelles preuves scientifiques à des mécanismes innés, liés au dimorphisme sexuel.
Si la catégorie de sexe reste un « facteur prédictif » de la santé, vous évoquez par exemple la mort subite du nourrisson, l’important est donc de ne pas considérer une « association statistique même puissante, même utile » liée au sexe, comme synonyme d’une relation de cause à effet ?
On observe des différences entre les hommes et les femmes sur de nombreux paramètres biologiques et phénomènes de santé, c’est un fait. Il y a donc, du point de vue de l’épidémiologie qui informe la pratique clinique, un intérêt à étudier les phénomènes en fonction de la catégorie de sexe, en tant que facteur associé à des risques, des symptomatologies, des pronostics différents. Une fois que l’on a dit cela, il est en effet nécessaire de poser certaines limites notamment : il ne faut pas confondre observer et expliquer. Une phrase bien connue, je pense, est « corrélation n’est pas causalité », elle invite à une grande retenue lorsqu’on cherche à interpréter une association de ce type. Mais d’un autre coté nous, humain·es, sommes comme programmé·es pour voir des relations de cause à effet partout. Certaines méthodes quantitatives ont donc assumé cette ambition pour chercher à identifier les situations dans lesquelles on peut effectivement conclure qu’une corrélation est causalité.
D’une certaine façon, on peut dire que la catégorie de sexe (en tant que typologie basée sur un ensemble de critères biologiques de différentes natures) est bien une cause des différences de risque de mort subite, de niveau d’inflammation, de fréquence cardiaque, etc. Elle est aussi une cause de la façon dont les individus vont être socialisé·es et vont construire leur corps, même si cette façon d’agir n’est pas la même que la façon dont le taux de testostérone va modeler le corps au cours du développement, par exemple. Lorsque l’on étudie l’effet causal d’une variable « Catégorie de Sexe » se mélange donc deux types d’effets : celui des phénomènes biologiques innés que cette catégorisation cherche à labelliser et celui de la catégorisation elle-même, c’est-à-dire tout ce qu’elle va conditionner pour l’individu dès l’instant où elle s’applique à elle ou lui.
On ne peut donc pas expliquer d’emblée une association entre la catégorie de sexe et un phénomène biologique ou de santé comme relevant uniquement de l’un ou de l’autre. Cela relèverait du simple apriori, non justifié scientifiquement. Pour démêler les deux, il est alors nécessaire d’utiliser des méthodes dites « de médiation » qui s’intéresse aux chemins mécanistiques des relations de cause-a-effet. Mais il est difficile d’expliquer cela simplement en quelques mots, j’y ai consacré plusieurs chapitres dans mon livre !
Votre ouvrage se conclut sur les implications de la prise en compte des mécanismes sociaux de genre pour expliquer les différences femmes-hommes : quelles en sont, selon vous, les principales ?
Ces résultats ont des implications sur plusieurs plans, notamment pour ma discipline. Ils questionnent notamment l’utilisation des seuils « sexe spécifiques » dans la recherche et dans la pratique clinique. Je n’apporte pas de recommandations figées et universelles à ce sujet, mais plutôt une invitation à réfléchir sur les justification et impact de l’utilisation de tels seuils au regard du fait que des mécanismes sociaux sont en jeu.
Je pense aussi que la principale nouveauté de mon approche dans le champ de la recherche sur le sexe/genre en biologie/santé est d’avoir montré que l’on peut étudier le « genre » sans le penser, le définir et le mesurer comme une caractéristique individuelle mais plutôt comme un phénomène structurel, systémique. Cette nouvelle approche offre un cadre analytique rigoureux et puissant pour comprendre les mécanismes qui construisent les différences entre les hommes et les femmes et peut donc contribuer à comprendre la spécificité de l’incorporation genrée du social et la façon dont elle s’articule avec la physiologie sexuée. Et montrer que ces différences hommes-femmes reposent, au moins en partie, sur des mécanismes sociaux implique aussi la possibilité de les réduire car, si on ne peut pas modifier le génome, au contraire, l’environnement social, la socialisation, les comportements, etc. semblent des univers sur lesquels on peut agir d’un point de vue de sante publique.
Mais au-delà de ses conclusions scientifiques, un élément que j’aimerais avoir transmis à travers la translation de mon travail de thèse dans cet ouvrage destiné à un public plus large, c’est l’idée d’une intrication forte du biologique et du social. Notre biologie impacte notre vie sociale et nos comportements, mais notre vie sociale et nos comportements impactent aussi notre corps et notre biologie. C’est un point capital car le corps et la biologie ont longtemps et sont encore aujourd’hui utilisés pour expliquer, figer et même légitimer des différences de comportements ou sociales. Il est donc, à mon sens, important de rappeler que le corps aussi est dynamique, évolutif et construit.
Propos recueillis par Claire Berest