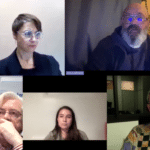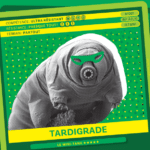Notre nouvelle chronique vous propose de partager les réflexions de cinq enseignant·es ordinaires travaillant en milieu urbain, mais avec des parcours, des expériences et des spécialisations différentes. Aujourd’hui, nous avons choisi de parler de ces enfants pour lesquels nous n’avons aucune prise, aucun appui, que ce soit cognitif, familial, relationnel, dans et hors de l’école.
 LE CADRE
LE CADRE
Eve : Je pense à un élève de CE2 qui est tellement en souffrance qu’il ne fait rien, même pas un dessin. Il a tellement besoin de limites, même physiques : il se donne des claques, il rampe, il provoque l’enseignant et ses camarades. On a même parfois l’impression qu’il a besoin de recevoir des coups, qu’évidemment personne ne lui donne. Et il se met souvent en danger en se faisant tomber au sol.
Daphné : Je le connais aussi. Il est en grande difficulté dans les apprentissages, très en décalage par rapport aux autres élèves. Il y a une orientation qui a été demandée pour lui. Il n’y a pas de « prise » sur lui avec les apprentissages. Lui-même se sent trop en décalage. Il n’est pas capable de faire la même chose que les autres, il a un blocage de passage à l’écrit. Bref, on ne peut pas le rattraper avec le scolaire, contrairement à d’autres élèves.
Eve : Il s’oppose à tout. Quand on lui donne un travail plus facile, il dit que c’est trop facile pour lui, et il n’arrive pas non plus à faire ce que font les autres. Il s’empêche tout le temps, et quand on construit un lien avec lui, il le casse très vite.
NOTRE REGARD
Daphné : Dans ces situations-là, nous nous remettons souvent en question, nous, et nous le vivons mal, parce que cette détresse est poreuse, mais aussi parce que nous essayons plein de choses qui ne fonctionnent pas. Nous nous sentons démunis, parfois déprimés, parce que nous avons du mal à avancer, avec parfois un pas en avant, mais le lendemain, tout est à recommencer. Ça nous met dans une situation de précarité. C’est là que nous avons intérêt à nous dire : « Ce n’est pas contre moi ! Ce n’est pas moi le problème ! » Cet enfant est peut-être trop en détresse par rapport à quelque chose qui le dépasse, et me dépasse. Je peux être la cible en tant qu’institution, mais pas en tant que personne.
Denis : Il y a même une expression que nous entendons souvent, qui est « T’as vu ce qu’il m’a fait ! »
Daphné : Avec ce genre d’enfant, très vite, nous le prenons pour nous, nous l’emportons même chez nous.
Eve : C’est ce que j’appellerais « enfant-gouffre », un enfant qui focalise tout sur lui : il engouffre tout le monde, enfants et adultes. Il est tellement mal qu’il n’y prend pas de plaisir, je pense. Simplement, il ne peut pas être tout seul dans son mal-être. Mais je n’y vois pas de perversion.
Denis : J’ai pas mal pensé ces derniers temps au phénomène de harcèlement, vu qu’on en parle beaucoup, et je considère qu’on ne se pose pas suffisamment la question de ce qui amène un enfant à harceler. Mon hypothèse de réponse est « l’exister » : « Comment je peux faire pour exister, pour que je puisse exister ? » Ces enfants-là, qui n’existent peut-être pas dans leur famille, ni dans les apprentissages, vont passer par des modalités autres, tel le harcèlement. « Au moins, on parle de moi, j’existe, même si c’est de façon négative. Peut-être même que je vais sur-exister grâce à ce biais. On va peut-être même me rejeter, mais on parle de moi, j’ai un prénom, j’existe ! »
Daphné : D’ailleurs, ce sont ceux dont on parle le plus dans une école.
Denis : Il y a donc peut-être un bénéfice, sans doute inconscient, profond, mais ce bénéfice est là.
Cyrille : J’ai un élève comme ça, et souvent je lui dis : « Tu sais, je te vois ! »
Sinon, pour répondre à la question, je pense qu’il faut faire jouer le collectif, en tant qu’enseignant avec les adultes, lors de conseils des maîtres où on exposera la situation, mais aussi avec les élèves, car les élèves voient bien la situation. Ça ressemble à la méthode de préoccupation partagée. Faire jouer le collectif, car pour moi, ces élèves manquent d’amour, de lien social, familial, de toucher, de mots doux, très souvent. Que le collectif puisse contenir, lui montrer que cet enfant existe par des aspects positifs. Trouver des modalités qui le mettent en réussite, en valorisation. Mais souvent, ils ne sont pas disponibles, c’est ainsi, surtout que nous ne savons pas tout ce qui se passe dans leur vie.
Eve : Ce qui est très dur, c’est que d’une part ils ne sont pas disponibles, d’autre part, il y a souvent un cassage systématique du lien.
Aude : Je partage la réflexion de Cyrille sur la force du collectif constitué par le groupe-classe. Cette année, j’ai accueilli un élève au comportement problématique. Ce comportement explosif a complètement remis en question ma relation au groupe et ma relation individuelle avec chaque élève. Malgré mes expériences professionnelles diverses, j’ai beaucoup tâtonné, cherché, j’ai été bien malmenée : j’ai beaucoup douté. Les solutions trouvées peu à peu l’ont été grâce au groupe-classe qui subissait lui aussi la situation chaotique. C’est ensemble que nous avons réussi à accueillir cet enfant : le regard et les paroles des enfants, mes recherches et trouvailles pédagogiques. Nous avons été à l’écoute, les uns des autres, nous avons beaucoup parlé. L’enfant a trouvé sa place et le groupe s’en est trouvé renforcé : beaucoup d’empathie, d’attentions de part et d’autre.
Denis : Je pense à plusieurs modalités qui pourraient être intéressantes dans ce genre de situation extrême, tout en sachant qu’elles risquent de ne pas fonctionner.
1) Les « ateliers d’empathie Agsas » en collectif, et avec l’enfant, sur une périodicité régulière, ritualisée, avec une formulation qui commence par « Que peut ressentir quelqu’un qui … » (qui n’y arrive pas/qui se sent différent/qui se sent seul/ qui n’a pas la même vie que les autres, etc.)
2) La lecture de textes mythologiques, inspiré du travail de Serge Boimare, car il y a des émotions, des actes, des sentiments, souvent forts, dans la mythologie qui peuvent résonner chez ces enfants-gouffres, mais de façon indirecte, en passant par des personnages.
3) Il y a aussi tout ce qui tourne autour du corps : le faire agir dans des activités de classe, en classe ou dans d’autres espaces. Laisser le corps exprimer ce qui est en nous, plus que le cérébral. En allant même sur des expressions fortes qui soulagent.
Cyrille : Passer par le corps, c’est intéressant, car à l’école, le corps est très absent.
Daphné : Je pense qu’il faut les faire avancer quand même sur le plan des apprentissages. Pour cela, ce qui va être central c’est de cultiver le lien avec cet enfant, même si ce lien est très fragile. Et comme le dit Cyrille, l’objectif va être de le garder au maximum dans le groupe.
Eve : Le groupe contient. Faire marcher l’intelligence collective, par exemple avec le conseil de classe.
Denis : Je me demande s’il ne faut pas aussi profiter de ces quelques moments où l’enfant est un peu disponible et calme pour parler avec lui : Qu’est-ce qui te pose problème ? Qu’est-ce qu’on peut faire ensemble ? Quelles sont tes envies, tes besoins ?
Cyrille : Oui, j’essaie parfois de le faire, c’est du lien, mais ça ne marche pas tout le temps, évidemment. Ou parfois pas du tout.
Daphné : Ces enfants peuvent ne jamais avoir eu ce genre d’échanges avec leurs parents. Nous pouvons semer des graines… mais avec beaucoup d’humilité car elles pousseront (peut-être) dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans… ou jamais !
Denis : Je ne suis pas trop dans le volontarisme. Je suis plutôt dans les « petites graines », comme tu le dis. Par exemple, très prochainement, je vais mener un moment de théâtre-forum avec 12 élèves. Nous allons travailler sur des situations difficiles de vie relatées par ces enfants, nous allons les théâtraliser et travailler sur comment faire évoluer ces situations parfois lourdes. Il y a beaucoup d’enfants volontaires pour y participer, en expliquant chacun pourquoi ils le souhaitent. Ce qui va émerger et qui n’est pas prévisible, ce sont ces petites graines-là, tout en sachant que leurs problèmes ne seront pas réglés.
Eve : On a du mal à imaginer leurs problèmes, car on se réfère toujours à notre enfance. En tant qu’enfant, je n’avais pas conscience qu’il y avait des choses qui n’allaient pas.
Denis : Ça pose la question de l’écart entre notre propre enfance et scolarité et celle de nombreux élèves de nos classes, qui ne sont pas de la même génération, pas de la même époque, pas du même univers.
Je voudrais aussi parler de la famille : ce qui est frappant, c’est tous ces enfants, pour lesquels on va essayer de trouver des solutions, des aides dans la classe et hors de la classe, sachant que ces enfants-là sont surtout le réceptacle d’un héritage familial. Parfois, je me dis que ce n’est pas l’enfant qui doit être suivi par un CMP, mais toute la famille. Donc, j’ai cette question : en envisageant qu’il n’y ait pas de possibilités d’alliance avec les parents, que pouvons-nous faire, nous enseignants, pour quand même faire alliance, au moins indirectement ?
Aude : Un psychologue scolaire m’avait parlé de « rencontre salvatrice », au sens fort de rencontre. Cette rencontre entre un enfant en souffrance et son enseignant·e n’est pas un acte thérapeutique, mais une rencontre entre un enfant et un autre adulte que les parents, dans un cadre très défini et protecteur, l’école. Et cette rencontre pédagogique peut générer une certaine résilience, cette capacité à faire face à une situation difficile et à trouver un certain équilibre à court terme ou à long terme (résilience au sens proposé par Boris Cyrulnik).
Eve : Il faut peut-être mener un travail de chercheur : tu extériorises la question, tu analyses le problème et tu cherches, en toi, avec lui. C’est une recherche dans le domaine du lien. C’est une manière de prendre du recul, de nous détacher au maximum.
Denis : Comment associer la famille à cette recherche ?
Eve : Souvent les parents sont coopérants, on peut discuter avec eux, mais ce n’est pas suivi d’effets.
Cyrille : C’est un peu insoluble. Ce qui est vraiment problématique, c’est tout ce qu’a construit l’enfant-gouffre pendant ses premières années de vie. Nous arrivons un peu tard quand il arrive à l’école.
Denis : J’ai une idée par rapport à cette idée de chercheur. Nous pourrions collecter des éléments de la vie de cet enfant : sur sa situation familiale, son habitat, ses conditions de vie. Et peut-être que ces éléments pourraient être des supports dans la classe d’« ateliers d’interrogation collective ». Par exemple, pourquoi parfois les parents se séparent ; pourquoi parfois les adultes ont plusieurs activités à la suite ; pourquoi parfois des frères et sœurs n’ont pas les mêmes parents. Des questions que pourraient se poser des élèves au regard de leur vie. Ça pourrait peut-être permettre à ces enfants, dont nous parlons aujourd’hui, d’être reconnus, de trouver une place, de se sentir moins seuls, moins a-normaux.
Eve : C’est une manière de ne pas passer obligatoirement par le parent, avec qui il y a souvent de l’incompréhension.
Cyrille : J’y crois beaucoup, car ce sont là les enfants qui ouvriraient les yeux sur leurs problématiques.
Daphné : Les élèves pourraient ensuite proposer eux aussi des sujets.
Cyrille : C’est de la métacognition en fait. Ça pousserait les enfants à prendre du recul sur ce qu’il se passe à la maison, pour se demander ce qui permet, ou pas, à un enfant de s’épanouir à l’école. Le tout, en répondant à des questions qu’ils peuvent se poser, mais en se décentrant quand même pour faire attention à ce qu’ils ressentent.
C’est délicat mais ça me semble bénéfique qu’ils développent un regard critique sur leurs parents et leur éducation.
D’ailleurs, je me dit souvent qu’il faudrait « éduquer » les parents le plus tôt possible, voire même quand ils ont … 9 ou 10 ans. Quand ils sont nos élèves, quoi !