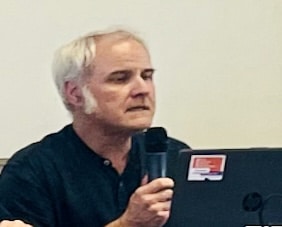
L’APSES organise un colloque « Jeunesse , territoires et violences : un éclairage des sciences sociales ». Quel en est le cadre et quels en sont les axes ?
Les drames qui frappent la jeunesse donnent lieu à un traitement médiatique souvent au pied levé et à des interprétations qui sont souvent simplistes et simplificatrices, alors que les connaissances établies par la recherche en sciences sociales donnent un certain nombre d’éclairages permettant de comprendre le contexte et la genèse de cette violence exacerbée. Il s’agit alors de se doter d’outils scientifiques pour mieux comprendre ce phénomène en dehors de toute agitation médiatique et politique. Ce qui a donné lieu à l’organisation de ce colloque FSU-Apses.
Quels éclairages apporte la recherche en sciences sociales ?
Lorsque l’on fait la sociologie des catégories de jeunes impliqués dans des violences ce qui est le plus marquant, c’est que ces jeunes se ressemblent : ils ont des caractéristiques socio-économiques extrêmement proches. Ainsi, la norme de masculinité hégémonique pousse certains jeunes garçons des classes populaires à chercher à s’affirmer à travers la bagarre, les muscles, la provocation.
Ces jeunes des classes populaires, qu’ils habitent dans les quartiers populaires ou dans les zones rurales, ont souvent le sentiment d’être relégués dans des zones où les politiques publiques sont insuffisantes pour assurer un avenir professionnel stable à Ceux qui restent [1], les moins diplômés, les moins dotés en capital scolaire et culturel, les plus touchés par la destruction de l’emploi non-qualifié. Déserts médicaux, faiblesse de l’offre de services publics (transports en commun, poste, écoles fermées ou enseignants non remplacés) caractérisent tant les campagnes que les quartiers populaires. Ces jeunes, parce qu’ils n’ont rien, ou pas grand-chose, comme le disent Isabelle Coutant et Yvon Atonga[2], sont également les plus enclins à défendre le nom de leur rue, leur quartier ou leur village.
Au-delà de ces ressemblances entre les jeunes ruraux et urbains, la sociologie des bandes et des rivalités de quartier[3] permet de comprendre que ces phénomènes sont anciens, mais qu’il existe plusieurs types de violences auxquels sont confrontés les jeunes : embrouille, narcotrafic, crimes racistes n’ont pas les mêmes ressorts.
Ensuite, la sociologie de la ruralité, tant chez Benoît Coquard que chez Yaëlle Amsellem-Mainguy, permet de rendre compte des hiérarchies qui structurent des rapports sociaux chez Ceux qui restent, également quand il s’agit des Filles du Coin [4].
Enfin, l’analyse de la fabrique de l’information par l’extrême-droite ainsi que sa diffusion dans des médias sociaux et les médias d’information en continu montrent combien la diffusion d’un imaginaire raciste, au-delà des cercles traditionnels des identitaires fait son chemin dans les esprits. Ceux qui se nourrissent de moins en moins d’articles critiques et de reportages deviennent alors plus perméables aux discours haineux qui sont propagés. Car ils se sentent menacés et que l’extrême droite leur donne des mots et une rhétorique pour exprimer leur rejet de l’autre. Or, très souvent, ceux qui adhèrent à cette idéologie, ces « petits-moyens [5]» sont dans des positions sociales dominées et ils ont peur de perdre le peu qu’ils ont réussi à se constituer comme patrimoine, comme respectabilité, souvent matérialisés dans un capital d’autochtonie qui joue un rôle crucial dans l’intégration de ceux qui ne disposent pas de beaucoup de capital culturel ou social.
Quel rôle peuvent jouer les SES ?
Les SES, parce qu’elles sont un enseignement de sciences sociales qui touche tous les élèves de seconde générale et technologique et près de la moitié des élèves de première générale peuvent permettre aux lycéen·nes d’accéder à des notions et à des mécanismes qui ont été établis par les sciences sociales : processus de socialisation, inégalités sociales, inégalités de genre, etc. Les SES, a fortiori quand elles ne sont pas cloisonnées par champ disciplinaire, permettent aux élèves de comprendre les mécanismes par lesquels un phénomène économique peut avoir des conséquences sociales et politiques.
Pour pouvoir assumer ce rôle au mieux, nous avons besoin de conditions propices d’enseignement. C’est pourquoi nous réclamons notamment des dédoublements définis nationalement afin de former les élèves aux méthodes des sciences sociales. Nous demandons aussi un enseignement davantage pluraliste, notamment en économie. Les SES ont, comme d’autres sciences humaines et sociales enseignées au lycée, un rôle majeur à jouer dans la construction de l’esprit critique de l’élève, futur citoyen, qui doit découvrir les différentes manières de s’informer et de concevoir un problème. Cela ne peut se faire sans reconnaître que les sciences sociales sont pluriparadigmatiques et cette spécificité échappe à tous ceux qui voudraient les faire reposer sur un consensus mainstream.
Des programmes qui répondent à ces enjeux de société ?
Les SES permettent aux élèves d’appréhender ces enjeux de société à travers notamment l’étude de la déviance, des inégalités du rôle de l’Ecole. Cependant les modifications successives de nos programmes et le récent allègement du programme de l’examen amoindrissent ce rôle de formation à la citoyenneté en particulier à travers le manque de pluralisme qui s’instille progressivement dans les programmes.
Ainsi, le colloque Apses de mars 2024 « Les SES et les enjeux environnementaux » à Paris-Dauphine a montré que les programmes actuels sont biaisés et orientés, ne fut-ce que dans le choix des concepts : le capital naturel est étudié en terminale, pas le patrimoine commun, qui désigne pourtant, sous un autre angle, la même chose, non pas en tant que ressource utilisable mais comme richesse à préserver.
Il en ressort que les programmes de SES pourraient être bien meilleurs s’ils étaient davantage problématisés et que les chapitres étaient organisés autour d’objets d’études que les sciences sociales dans leur ensemble pourraient éclairer. Pour l’APSES, ce sont ces conditions qui permettraient aux élèves de mieux comprendre les questions sociales vives, de leur donner la capacité de raisonner de manière transversale tout en adoptant une démarche scientifique et ainsi de jouer un rôle central dans la formation citoyenne et l’acquisition d’une culture générale. Fort de ces constants, nous disons au Ministère de l’Education nationale : « Faites confiance aux enseignants du secondaire ! » En effet, il sera plus que nécessaire, lors de l’élaboration de futurs programmes de SES, que l’expertise de terrain des professeurs soit à nouveau reconnue, comme lorsque les groupes d’experts comportaient jusqu’à 20 enseignants du secondaire ! Car la citoyenneté passe par la connaissance. Ainsi l’appauvrissement des savoirs enseignés en sciences sociales est une menace pour la démocratie.
Le rôle que jouent les SES dans l’éducation à la citoyenneté est-il menacé ?
La question de l’émancipation des citoyens par l’accès aux sciences sociales est inhérente aux sociétés démocratiques, qui reposent sur l’implication de citoyens éclairés dans la société qu’ils se doivent de comprendre. Chaque heure de cours en SES, discipline qui n’apparaît qu’au lycée dans le cursus des élèves, apporte un regard nouveau sur les sociétés dans laquelle ils vivent. Les élèves semblent d’ailleurs l’apprécier puisque la spécialité SES est l’une des plus plébiscitées. Pour autant, nous pouvons identifier plusieurs facteurs qui peuvent menacer l’éducation à la citoyenneté à travers les SES.
D’abord, pour pouvoir former nos élèves, il nous faut du temps et des moyens. De ce point de la vue, la réforme Blanquer ne l’a pas permis, bien au contraire puisqu’elle a mis fin aux dédoublements nationalement définis, aux dispositifs d’accompagnement personnalisés tout en demandant aux enseignants de traiter des programmes très lourds, toujours cloisonnés et peu problématisés. D’après une enquête de l’APSES, les enseignants de SES ont perdu 14% d’heures d’enseignement alors que l’effectif d’élèves qui suit un enseignement de SES a augmenté de 21%. Grâce à la mobilisation de l’APSES et des collègues de SES, nous avons obtenu un allégement du programme d’examen du baccalauréat mais qui n’est pas sans conséquence sur la formation de nos élèves puisque les chapitres traitant de la justice sociale, du rôle de l’école et des crises financières ne sont plus exigés comme des connaissances à maitriser pour l’examen.
Ensuite, la formation à la citoyenneté ne peut pas se faire qu’en SES. C’est pour cela que nous valorisons les projets interdisciplinaires pour permettre aux élèves de trouver de la cohérence entre les différentes disciplines (histoire-géographie, mathématiques etc…). La nouvelle organisation du lycée général, qui a mis fin aux séries ne permet quasiment plus ce travail avec nos collègues d’autres disciplines. L’APSES défend le retour à des séries mais rénovées pour permettre une cohérence d’ensemble au sein des parcours scolaires de nos élèves.
Enfin, certainement la menace la plus importante est celle des pressions extérieures. En effet, nous sommes très inquiets cependant des nombreuses attaques subies par les SES, car ce sont des attaques contre la formation des citoyens, donc contre la démocratie. Notre liberté pédagogique doit rester intacte, car elle est la seule garante d’un enseignement de qualité adapté aux élèves que l’on a en face de soi. Certains collègues ont été menacés par des parents dits « vigilants » et attaqués jusqu’en commission des Affaires Culturelles à l’Assemblée Nationale. Aurait-on oublié la mécanique désastreuse qui a conduit à l’assassinat de Samuel Paty ? Sans climat de sérénité et de confiance, il ne peut y avoir d’enseignement.
Propos recueillis par Djéhanne Gani
[1] Ceux qui restent, Faire sa vie dans les campagnes en déclin, Benoît Coquard, La Découverte, 2019.
[2] Petit Frère, Isabelle Coutant et Yvon Atonga, Seuil, 2024.
[3] Y’a embrouille, sociologie des rivalités de quartier, Marwan Mohammed, L’Harmattan, 2024
[4] Les Filles du coin. Vivre et grandir en milieu rural.Yaëlle Amsellem-Mainguy, Presses de Sce Po,2023
[5] La France des » petits-moyens « , Enquête sur la banlieue pavillonnaire, Marie Cartier, Isabelle Coutant, Olivier Masclet, Yasmine Siblot, La Découverte, 2008.











