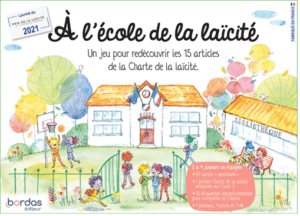
Un déclic face à l’urgence d’agir
Interrogé sur l’origine de À l’école de la laïcité, Daniel Fischer revient sur l’assassinat de Samuel Paty en octobre 2020. Ce drame a provoqué un véritable séisme dans la communauté éducative. Formateur à l’INSPE, il se souvient : « Nous étions tous sidérés. Il fallait accompagner nos étudiants, souvent professeurs stagiaires, qui allaient devoir expliquer ce qu’est la laïcité à leurs élèves. »
Historien moderniste, Daniel Fischer s’est alors rappelé le “Jeu de la Révolution française” qui, inspiré du célèbre jeu de l’oie, initiait les citoyens aux nouvelles valeurs républicaines à la fin du XVIIIe siècle. Ce modèle lui a inspiré l’idée d’un jeu de société dédié à la compréhension de la laïcité. Avec ses étudiants, il décide donc de se lancer dans un projet collaboratif pour créer un outil pédagogique qui permettrait de réexplorer la charte de la laïcité de manière ludique, interactive et accessible.

L’intérêt de la ludicisation pour aborder un sujet sensible
Pour Daniel Fischer, choisir le jeu comme support pédagogique n’est pas anodin. Aborder la laïcité de façon ludique permet de contourner une approche théorique descendante, souvent mal perçue par les élèves. Il explique : « Tant qu’on reste magistral et purement théorique, on n’arrive pas à engager nos élèves sur ce sujet. Avec le jeu, on peut stimuler leur intérêt tout en les aidant à se forger une compréhension active des principes de la laïcité. »
Le jeu repose sur un plateau inspiré du jeu de l’oie. Les élèves avancent sur le parcours en répondant à des questions, chacune associée à un des 15 articles de la charte de la laïcité. L’objectif : reconstituer collectivement la charte en obtenant des réponses correctes : « Cette approche favorise l’adhésion, car les élèves choisissent de répondre et participent activement à leur apprentissage. ». L’aspect collaboratif du jeu est également central : il évite une logique compétitive tout en renforçant la compréhension collective des valeurs de la laïcité.
Deux principales modalités d’utilisation en classe
La mise en œuvre pédagogique de À l’école de la laïcité peut s’adapter à différents contextes et contraintes. Daniel Fischer explique que deux approches principales émergent souvent dans les classes.
La première consiste à faire jouer les élèves en petits groupes. Chaque équipe, composée de quatre à six élèves, dispose de sa propre boîte de jeu. Cette configuration permet aux élèves de progresser de manière autonome, tout en laissant à l’enseignant la possibilité d’intervenir ponctuellement pour clarifier certaines questions complexes. Ce format s’inscrit idéalement dans une séance de 40 à 50 minutes, correspondant à une heure de cours habituelle.
La seconde modalité propose une expérience collective. Dans ce cas, l’ensemble de la classe participe à une partie unique, avec le plateau de jeu projeté au tableau à l’aide d’un visualiseur. L’enseignant joue alors un rôle de maître du jeu, déplaçant les pions et animant les échanges. Les élèves sont répartis en équipes qui collaborent pour répondre aux questions et avancer sur le plateau, favorisant une dynamique de classe interactive et engageante. Cette méthode, tout en conservant une approche structurée, permet à l’enseignant de stimuler des discussions plus larges autour des principes de la laïcité.
Certaines déclinaisons plus originales ont également vu le jour, comme l’utilisation des questions du jeu sous forme de rituels quotidiens dans les jours précédant le 9 décembre, journée nationale de la laïcité.

Un enseignement de la laïcité encore marqué par de nombreux défis
Daniel Fischer souligne par ailleurs les défis que pose l’enseignement de la laïcité dans le contexte actuel, marqué par des tensions géopolitiques et la montée de l’antisémitisme : « Nos élèves et étudiants préfèrent souvent éviter le sujet, tant il peut être perçu comme complexe ou source de controverses. »
Pour autant, il reste optimiste et insiste sur la nécessité d’aborder ces questions avec rigueur et ouverture. Il rappelle que la laïcité n’est pas une valeur, mais un principe organisateur qui permet de garantir les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. Il encourage également à parler davantage des faits religieux pour mieux informer les élèves : « Lorsqu’on évite un sujet, on ouvre la porte aux réinterprétations et aux instrumentalisations. Il est essentiel d’éclairer nos élèves sur ces questions pour renforcer leur compréhension et leur esprit critique. »
Enfin, il insiste sur l’importance d’une approche non dogmatique : « Il faut accueillir la parole des élèves, même quand elle exprime des convictions religieuses, tout en leur rappelant que la religion n’est qu’une composante de leur identité parmi d’autres. Ce dialogue est essentiel pour leur permettre d’adhérer pleinement aux principes de la laïcité. »
Propos recueillis par Mickaël Bertrand
Ressource complémentaire : présentation du jeu par Daniel Fischer











