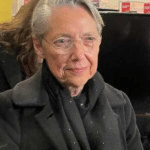L’enseignement de l’histoire en général et l’intégration dans cet enseignement des récits des minorités : ces questions très débattues ne sont nullement une particularité française. Dans Histoires nationales et narrations minoritaires (Septentrion presses universitaires, 2024), dix-neuf chercheurs analysent comment évoluent ces enjeux dans divers cadres nationaux, principalement en Europe. Sans être exhaustif, ce panorama apporte une série d’éclairages sur la fonction identitaire que certains – pas seulement les gouvernements – assignent à l’histoire et sur la nécessité de préserver son caractère de savoir critique et émancipateur. Autant d’enseignements à garder à l’esprit dans un contexte politique français mouvant et incertain. Les historiens Piero S. Colla, Bénédicte Girault et Sébastien Ledoux, qui ont codirigé cet ouvrage, répondent à nos questions.
L’enseignement de l’histoire en général et l’intégration dans cet enseignement des récits des minorités : ces questions très débattues ne sont nullement une particularité française. Dans Histoires nationales et narrations minoritaires (Septentrion presses universitaires, 2024), dix-neuf chercheurs analysent comment évoluent ces enjeux dans divers cadres nationaux, principalement en Europe. Sans être exhaustif, ce panorama apporte une série d’éclairages sur la fonction identitaire que certains – pas seulement les gouvernements – assignent à l’histoire et sur la nécessité de préserver son caractère de savoir critique et émancipateur. Autant d’enseignements à garder à l’esprit dans un contexte politique français mouvant et incertain. Les historiens Piero S. Colla, Bénédicte Girault et Sébastien Ledoux, qui ont codirigé cet ouvrage, répondent à nos questions.
L’article introductif de ce livre fait état d’un « tournant» qui, à partir des décennies 1980 et 1990, a mené l’enseignement de l’histoire dans les pays occidentaux à intégrer des narrations minoritaires, puis d’un contrecoup menant à « renationaliser » cet enseignement. Est-ce aujourd’hui une tendance générale ?
Piero Colla. On peut affirmer que la tendance s’est renforcée au cours de la dernière décennie. Certaines causes externes – la crise migratoire des années 2015-2016, l’inquiétude face à la progression de l’islam politique, et l’affirmation électorale de formations nationales-populistes, à l’Ouest comme à l’Est – y ont contribué. Dans de nombreux cas – en Hongrie, en Italie, mais aussi en Europe du Nord et au Benelux – ces formations manifestent un intérêt particulier pour le rôle de l’école et pour le recours à la symbolique des racines, des mythes des origines que l’histoire scolaire peut incarner ou relayer. Deux exemples récents pointent directement dans ce sens : la revendication en 2019 par le gouvernement flamand d’un « canon » de l’histoire de la Flandre comme base du programme d’histoire, en Belgique, et l’initiative très récente du ministre de l’Éducation du gouvernement Meloni, en Italie, d’entamer la réécriture des programmes d’histoire pour installer « l’identité italienne » et ses symboles au centre des programmes. Une commission vient d’être installée avec une mission de ce type. J’ajouterais cependant que les conséquences pratiques et éducatives de cette « nationalisation » imaginaire sont encore entourées de beaucoup de confusion. La nostalgie des « romans nationaux » n’a pas encore trouvé une rhétorique univoque, une technologie didactique, pour s’exprimer, et le public visé n’est certainement plus celui d’il y a cinquante ou cent ans… Pour cette raison, les stratégies de « renationalisation » auxquelles nous allons assister vont probablement suivre des chemins différents du passé. Souvent – au passage – elles vont se saisir de l’éducation civique, de la rhétorique des « valeurs », plutôt que d’un imaginaire historique dont l’école semble avoir perdu le monopole.
Le nouveau regard porté, notamment en France, sur l’histoire coloniale, consistant à intégrer de plus en plus dans l’enseignement les récits des minorités, a-t-il vraiment la fonction réparatrice qu’on lui attribue ? Ne risque-t-il pas, involontairement, de stimuler une concurrence identitaire ?
Sébastien Ledoux. Je ferais déjà une distinction entre fonction inclusive et fonction réparatrice sur cet enjeu de la prise en compte des narrations minoritaires au sein de l’histoire enseignée. La réparation – qui va souvent de pair avec une pathologisation problématique de la lecture du passé – reste une donnée aléatoire. On peut juste observer qu’elle est devenue depuis trente ans une forme rhétorique des politiques du passé, et ce à l’échelle mondiale. En revanche, l’inclusion des points de vue des minorités a été portée – en tout cas en France – par différentes évolutions historiographiques amenant un décentrement salutaire du référent national à partir des années 1970 avec l’histoire locale/régionale, puis avec l’histoire des persécutions à l’encontre des Juifs sous Vichy, et enfin avec l’histoire coloniale et la prise en compte des minorités colonisées. La question d’un récit scolaire plus inclusif à l’égard des minorités a donc été favorisée par des nouveaux travaux scientifiques qui ont permis une complexification du passé tout en réduisant l’invisibilisation de groupes minoritaires au sein d’une société qui était en effet plurielle, et dont nous sommes les héritiers. Qu’il y ait des phénomènes de concurrences identitaires est inévitable, l’essentiel est d’articuler l’enseignement de l’histoire aux travaux de recherches pour éviter tout cloisonnement dogmatique, qu’il soit de type nationaliste ou minoritaire.
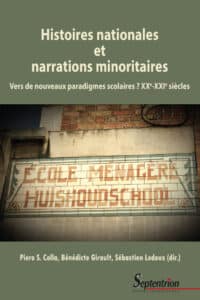 Cette intégration des récits minoritaires et des « questions vives » (esclavage, colonisation et décolonisation, guerre d’Algérie…) dans les programmes de l’enseignement français est progressive mais réelle. Alors comment expliquer que l’impression inverse perdure et ne cesse d’être relayée dans le débat public par des non-experts ?
Cette intégration des récits minoritaires et des « questions vives » (esclavage, colonisation et décolonisation, guerre d’Algérie…) dans les programmes de l’enseignement français est progressive mais réelle. Alors comment expliquer que l’impression inverse perdure et ne cesse d’être relayée dans le débat public par des non-experts ?
Sébastien Ledoux. Les débats publics sont déconnectés des évolutions réelles des programmes qui sont le plus souvent simplifiées ou ignorées. La définition même des « questions vives » que vous utilisez comprend d’ailleurs cet élément : une forte médiatisation de ces enjeux scolaires impliquant l’intervention de nombreux acteurs qui ne connaissent pas les faits mais utilisent ce sujet comme un moyen de prendre position et de se visibiliser dans un espace médiatique toujours à la recherche d’éléments clivants. Pour autant, il faut se méfier d’une vision linéaire de l’inclusion scolaire des récits minoritaires. En 2019, les programmes initiaux de lycée prévoyaient de mentionner l’histoire de l’esclavage en France uniquement dans le cadre de l’abolition de 1848, alors que la traite était étudiée par le cas portugais et la société esclavagiste par le cas états-unien. On revenait ainsi au roman national abolitionniste qui avait, pendant des décennies, invisibilisé auprès des élèves deux siècles de pratiques esclavagistes construisant durablement des imaginaires raciaux infériorisant les populations noires. Il a fallu l’intervention écrite de différents chercheurs du Comité pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage (mis en place après la « loi Taubira » de 2001), de Christiane Taubira et de Jean-Marc Ayrault, nouveau président de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage (FME) auprès du ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, pour voir intégrer un thème sur les ports de traite en France. Les processus d’inclusion scolaire des minorités ne sont donc jamais irréversibles.
A l’inverse, pourquoi toute introduction nouvelle dans les programmes d’éléments relatifs à l’histoire extra-européenne et à celle des minorités déclenche-t-elle, comme on n’a cessé de le voir en France de manière quasi automatique, des réactions outrancières sur le thème de la désagrégation nationale ?
Bénédicte Girault. On voit parfois dans cette situation une spécificité française du rapport de l’école – et plus largement de la société – à l’histoire, comme passé et comme discipline. Il ne s’agit pourtant pas d’une exception française et le problème se pose dans bien d’autres pays en des termes souvent comparables et avec la même outrance comme le montrent dans notre ouvrage les exemples du Québec, des États-Unis, ou plus proches de nous, du Tyrol du sud ou de la Pologne. Cette sensibilité de l’opinion publique à l’histoire enseignée s’explique par la fonction d’intégration nationale qui lui est prêtée depuis le XIXe siècle. L’angoisse exprimée devant la dissolution de l’histoire nationale au profit d’une histoire prenant en compte les minorités et ouverte sur le monde relève le plus souvent d’analyses sommaires qui dissimulent des présupposés sans rapport avec l’argumentation scientifique et des fantasmes sans lien avec le contenu réel de l’enseignement dans les collèges et les lycées. Les débats sur les programmes scolaires mettent presque toujours en avant la question des contenus et de leur résonance politique – mobilisant des oppositions caricaturales, comme le choix entre Louis XIV ou l’Afrique médiévale –, alors que la réflexion devrait porter sur les formes concrètes de l’enseignement de l’histoire et leur portée intellectuelle.
L’idée que l’enseignement de l’histoire serait défectueux, voire témoignerait d’une « faillite » est ancienne mais revient de manière récurrente dans le débat public sur le ton de l’affirmation péremptoire. Comment expliquez-vous ce phénomène et sa durabilité ?
Piero Colla. Les attentes qui pèsent sur l’enseignement scolaire de l’histoire sont souvent démesurées et peu réalistes, et dérivent d’une sorte d’illusion d’ingénierie sociale, comme si l’école était effectivement la « fabrique » de la conscience nationale – et non un reflet de ses évolutions. Si l’on identifie la tâche de l’école à la transmission d’une mémoire collective impérative, tout indice de la dispersion de cette mémoire, voire du relâchement du pacte de citoyenneté lui est automatiquement imputé. C’est une forme de distorsion cognitive dont témoignent, aussi, les débats sur l’incapacité de l’école à préserver la langue nationale, ou les bonnes manières…
Vous déplorez l’incapacité des politiques à concevoir la discipline scolaire de l’histoire autrement que comme une fabrique d’identité. Mais quelles que soient ses variantes, plus ou moins ouvertes aux minorités, plus ou moins respectueuses d’une approche scientifique, n’est-elle pas justement et toujours cela : en même temps qu’une transmission de savoirs, une fabrique d’identité ?
Piero Colla. Cette dualité est une contradiction – ou plutôt une forme de plasticité – dont il faut que les acteurs prennent conscience, pour en faire un usage intelligent. L’usage identitaire risque d’être une impasse, un point aveugle pour les pratiques d’enseignement, et à ce propos, je pousserais le raisonnement au-delà de la simple déconstruction critique des « romans nationaux », centrés sur l’Etat-nation. Au cours des dernières décennies, nous avons assisté, sous la bannière de la réhabilitation de la place des minorités dans le récit légitime, institué, à l’émergence de récits minoritaires (régionaux ou macro-régionaux) plus exclusifs et intolérants que les récits nationaux eux-mêmes. Le cas du « canon » de Flandre – qui fait complètement l’impasse sur l’histoire de la Belgique, sa légitimité en tant que nation – ou les programmes utilisés dans la région autonome italienne du Süd Tirol, où l’histoire italienne est délibérément ignorée, ou encore les relents auto-référentiels des programmes de certaines communautés autonomes en Espagne, montrent que le réflexe identitaire, la capacité à « inventer » des mythes d’origine à partir de l’histoire, n’est en aucun cas l’apanage des États-nations.
Ce qui témoigne de l’inanité d’une approche dogmatique de la question : l’histoire « identitaire » n’est ni bonne ni mauvaise en soi, elle est à l’image de ce qu’une communauté politique demande presque spontanément à l’école. L’école imaginée lors des grandes ruptures historiques de l’histoire – révolutions russe, américaine, Risorgimento italien ou le récit épique des nations issues de la décolonisation – se fonde aussi, dans la majorité des cas, sur une histoire « identitaire », utilisée comme un faire-valoir. Mais il ne s’agit pas de l’histoire des historiens en tant que communauté scientifique, il s’agit du ciment d’une communauté en train de s’inventer. On peut toujours discuter de sa nécessité, de sa pertinence. Mais tant que l’on garde à l’esprit cette différence entre registres, qui tient à la polysémie même de l’histoire – que l’on peut entendre comme outil d’acculturation civique, comme science ou comme récit – il est plus facile de démêler les controverses, et s’en extraire.
Un article du livre consacré aux enseignements d’intégration des migrants, en France et en Allemagne, est très critique envers la prétention à inculquer de manière infantilisante un « catéchisme républicain » à des personnes en situation personnelle et administrative précaire. Mais cette critique vise aussi l’insistance sur l’égalité hommes-femmes et sur la tolérance, notamment envers l’homosexualité. N’est-ce pas pourtant un impératif de loyauté vis-à-vis des migrants que d’exposer certains principes non négociables du pays d’accueil ?
Piero Colla. A-t-on le droit, en tant que citoyen, de s’extraire du respect – au niveau de ses convictions intimes – de certains « principes non négociables », et qui en définirait les limites ? La Constitution italienne, par exemple, définit depuis 1946 de manière restrictive la famille comme une « société naturelle fondée sur le mariage » : s’agit-il d’un dogme, d’une croyance « obligatoire » pour tous ? Mais la vraie question n’est pas là. Elle tourne autour de la généralisation à l’échelle de l’Europe des cours d’éducation à la citoyenneté pour les nouveaux arrivants, et au fait de considérer l’enseignement de ces valeurs comme une obligation dans le cadre d’une sorte de démarche de ré-acculturation, visant les nouveaux migrants, assignés a priori à des croyances différentes voire « dangereuses ». L’infantilisation, cela se réfère à une situation et à une relation entre acteurs, non au contenu même du « cathéchisme républicain ». Ceci dit, exposer certaines normes fondamentales, et les droits et devoirs qui en découlent, à qui pourrait les ignorer relève effectivement des responsabilités de l’Etat d’accueil. C’est du moins mon avis, mais il faudrait, sur ce point précis, interpeller l’autrice de l’article. [Emma Fiedler, NDLR]
Vous mentionnez le rôle normatif des institutions européennes dans la reconnaissance de la diversité et des droits des minorités dans l’histoire enseignée. Mais ce rôle n’est-il pas purement théorique, donc illusoire ?
Piero Colla Il est vrai que les institutions européennes ou des institutions transnationales qui se penchent depuis les années 1950 sur l’histoire enseignée à l’école, comme le Conseil de l’Europe n’ont pas des prérogatives normatives qui les habilitent à légiférer sur l’organisation de l’enseignement de base. Ces prérogatives existent, en revanche, au niveau de la formation professionnelle. Cependant, et ce depuis une bonne vingtaine d’années, les sujets que vous évoquez ont fait l’objet de prises de position communes : résolutions du Parlement européen, actes législatifs arrêtés au niveau de l’Union Européenne (UE). Elles relèvent aussi, si l’on songe à l’UE, de la définition des « compétences » fondamentales, en matière de citoyenneté, qui s’imposent comme une référence normative acceptée par la totalité des Etats membres, et ont été effectivement intégrées dans les curricula nationaux, pratiquement sans exception. Il ne s’agit donc pas d’une influence politique immédiate, mais de recommandations dont on a pu constater l’impact au niveau des pratiques et dans les cultures professionnelles.
Deux exemples tirés du livre. En Turquie, l’histoire scolaire est entièrement sous le contrôle du parti au pouvoir, qui nomme les auteurs des programmes et valide les manuels. En Pologne, la narration imposée à partir de 2015 par les conservateurs occulte l’antisémitisme de la société polonaise et va même jusqu’à faire un délit d’assigner à l’État ou à la nation une coresponsabilité dans les crimes nazis. L’histoire enseignée est-elle condamnée à subir les prescriptions gouvernementales ?
Sébastien Ledoux. A partir du moment où elle est investie d’une capacité à naturaliser et perpétuer un régime politique et l’idéologie qu’il porte, l’histoire enseignée se trouve sous surveillance, voire l’objet d’instrumentalisations du passé. On pourrait croire – confortablement – que de telles instrumentalisations sont l’apanage des dictatures ou des régimes totalitaires. Comme on le voit dans cet ouvrage à travers plusieurs exemples, cette tentation n’échappe pas non plus aux régimes démocratiques qui peuvent non seulement prescrire une écriture scolaire de l’histoire mais parfois, par le biais de la justice, mettre en cause la liberté des historiens, ce qui s’est passé ces dernières années dans les deux pays que vous citez.
Piero Colla. Une esquisse de réponse à la dernière question peut être extraite d’autres chapitres du livre. Ils offrent un bon aperçu sur les résistances et sur les lignes de tension – intellectuelles, sociales, voire transnationales – qui ont entraîné les pouvoirs politiques à reconsidérer leurs positions vis-à-vis de l’histoire légitime, consignée dans les programmes. Souvent, avec succès. Les États et leurs gouvernements n’ont pas toujours été les promoteurs de la prise en compte des génocides du XXe siècle, ou du racisme, ou encore de l’expérience des minorités. S’ils n’ont pas non plus arrêté cette dynamique, on devrait parler d’une négociation, d’un jeu de forces, où différents acteurs et stratégies s’affrontent. Qui décide, en dernière instance ? Certes, l’État-nation détient « le dernier mot » dans des systèmes très centralisés, mais dans nombre d’autres contextes, le contenu des programmes est fixé à d’autres échelles : administration, organisations socioprofessionnelles, experts, pouvoirs locaux. En Italie, par exemple, les indicazioni nazionali (plutôt des recommandations que des programmes, laissés à l’interprétation des districts scolaires locaux) – que le gouvernement Meloni a aujourd’hui en ligne de mire – ont été rédigés par un comité d’experts composé d’historiens. Elles sont en vigueur depuis 12 ans.
Votre livre a été écrit avant les développements récents sur la scène politique française. Quels sont les points de résistance et les lignes de défense possibles face à un gouvernement qui – hypothèse de moins en moins théorique – voudrait réviser l’enseignement de l’histoire dans un sens ouvertement nationaliste ?
Bénédicte Girault. C’est précisément l’objet de la conclusion du livre, rédigée par Patrick Garcia. Face à une révision nationaliste des programmes qui se focaliserait sur certains objets comme les grandes dates et les grands hommes qui auraient « fait la France », les leviers de résistance sont dans la discipline historique elle-même. Les enseignants disposent d’une formation scientifique qui leur permet de déjouer le piège d’un roman national imposé en intégrant les minorités et en développant l’esprit critique à l’instar de l’entreprise collective, coordonnée par Patrick Boucheron, de l’Histoire mondiale de la France (Seuil, 2017) qui revisitait les dates du roman national dans cette perspective. Résister, c’est ne pas céder à la fonction identitaire que certains continuent à vouloir assigner à l’histoire. L’histoire est un savoir critique et émancipateur, et c’est l’attachement à ces finalités intellectuelles qui est le meilleur rempart en continuant à donner aux élèves les clés pour comprendre la complexité du réel en prenant en compte la diversité des acteurs sans céder à la facilité des récits simplificateurs.
Propos recueillis par Luc Cédelle