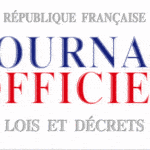Depuis 2019, une question de grammaire à l’oral de l’EAF oblige élèves et professeur.es à faire de la langue un objet d’étude au lycée comme au collège. Quelle place réserver à cet enseignement dans des programmes écrasants ? Selon Charlotte Gattulli, professeure au lycée George Sand à La Chatre dans l’Indre, « les élèves redoutent la litanie d’exercices, hors contexte, qui suit la leçon imposée par le professeur. » Comment échapper alors au sentiment d’inutilité, de contrainte et d’ennui ? Pour l’enseignante, le défi est bel et bien de rendre l’apprentissage actif, réflexif, créatif, de désacraliser la grammaire, de favoriser le travail entre pairs : d’envisager que l’apprentissage de la langue puisse lui aussi relever de la pédagogie de projet ?
En quoi l’étude de la langue vous semble-t-elle souvent poser des difficultés au lycée ?

Vous commencez par une réflexion collective sur la notion de langue abordée : comment menez-vous cette étape ? quels vous apparaissent les intérêts de cette phase d’échange ?
Cette première étape est importante et elle se fonde sur une liberté totale de parole. Le but est d’échanger sur l’intérêt d’étudier encore certains points de langue. L’écoute entre pairs se met en place et la variété des points de vue devient alors intéressante, prouvant aux uns et aux autres les écueils, les forces, les niveaux de compréhension par rapport à la notion de langue abordée. L’intérêt est de faire émerger par les apprenants une réflexion sur leur propre niveau, leurs difficultés.
Les élèves sont aussi amenés à produire des ressources numériques sur les notions abordées : selon quel dispositif ?
J’ai choisi de ne pas enfermer les élèves dans des consignes trop strictes. Par contre, je me suis tenue à la disposition de chaque groupe afin d’aiguiller si besoin, de vérifier certaines recherches, de jouer parfois le rôle de médiateur. La modalité de travail est celle d’un travail de groupe, l’idée est de reproduire le débat interprétatif sur la notion de grammaire abordée.
Le podcast produit prend même une forme théâtralisée : quels vous semblent les intérêts de faire ainsi parler les élèves à la place des notions ?
Faire parler les élèves, c’est rendre concrètes des notions qui peuvent leur paraître abstraites. C’est aussi une manière de contextualiser, de créer des situations de vie dans lesquelles ils seront amenés à retrouver, à réinvestir ces notions (autre que dans la pure rédaction littéraire ou à l’épreuve orale du baccalauréat). J’ai en effet certains groupes qui ont enregistré un « dîner en famille », ou encore « un jeu radiophonique » autour de leur notion. Enfin, c’est libérer la parole des élèves et lui donner de l’importance dans le contexte de l’apprentissage.
Il est assez rare d’associer enseignement de la grammaire et pédagogie de projet : à la lumière de vos expériences, en quoi cette démarche vous semble-t-elle pertinente ?
C’est une autre manière d’aborder la « grammaire », cela permet aussi de la désacraliser, de la rendre accessible, de « jouer » avec les notions pour mieux de se les approprier. L’intérêt du projet est que les élèves sont acteurs de leur apprentissage. Le projet entre pairs permet aussi l’effet tutorat. Je crois que le travail de reformulation, voire la création d’un “scenario” est une étape dans le processus d’apprentissage.
Quels conseils donneriez-vous à des collègues tenté.es d’adopter une telle démarche ?
Je crois qu’il faut oser se lancer, faire confiance aux élèves qui sont remplis de belles idées. Et même si certains sont réfractaires (il peut y en avoir, il ne faut pas se leurrer), l’effet de groupe permet l’émulation.
Propos recueillis par Jean-Michel Le Baut
Exemple de podcast théâtralisé sur le lexique
Le travail de la langue au collège par Elodie Lahaye
Quand les élèves de Cécile Rullon enseignent la grammaire