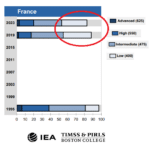Vous imaginiez voir un documentaire consacré au grand peintre italien ? Détrompez-vous ! A 84 ans, le réalisateur Alain Cavalier nous joue un de ses tours d’éternel galopin. De sa caméra légère, il filme le cheval, nommé Le Caravage, dans l’intimité de la relation de travail avec son maître, Bartabas, le créateur du Théâtre équestre Zingaro. Au-delà de la fascination exercée par la complicité énigmatique entre le cavalier et l’animal, le cinéaste, tout en discrétion et attention, capte au plus près les forces corporelles et sensibles déployées par la bête, les ressorts d’intuition et d’intelligence mis en œuvre par l’écuyer. L’absence de commentaires laisse toute sa place au déploiement de notre imaginaire de spectateurs, confrontés à la vision du cheminement de la création en gestation. Dans son épure et sa simplicité, « Le Caravage » donne à voir ce qu’il faut de patience et de rigueur pour inventer des figures équestres, et laisse deviner ce qu’il faut de maîtrise et d’imagination pour les transformer en une création artistique accomplie. Une sacrée leçon de vie.
Proximité physique, frémissement animal
 D’emblée, les gros plans de la tête du cheval (grand œil humide, poil frémissant) envahissent l’écran et nous plongent dans une proximité physique, complétée par d’autres plans sur ses pattes bichonnées par une jeune palefrenière en pantalon et chaussettes montantes multicolores. Nous sommes dans son box, devinant la présence d’autres chevaux : son pelage brossé, sa crinière tressée, il est mené par Bartabas (à peine reconnaissable, en capuche noire) vers leur lieu de travail. Evoluant sur la piste du Fort d’Aubervilliers, il est dans un premier temps cadré au niveau des pattes et du bas ventre tandis que nous ne distinguons que les jambes du cavalier. Visiblement, le cinéaste –que nous avons entendu en voix off dire ‘bonjour’ à la cantonade- a décidé de se taire et de filmer ‘à hauteur de cheval’, du point de vue de la bête, en quelque sorte.
D’emblée, les gros plans de la tête du cheval (grand œil humide, poil frémissant) envahissent l’écran et nous plongent dans une proximité physique, complétée par d’autres plans sur ses pattes bichonnées par une jeune palefrenière en pantalon et chaussettes montantes multicolores. Nous sommes dans son box, devinant la présence d’autres chevaux : son pelage brossé, sa crinière tressée, il est mené par Bartabas (à peine reconnaissable, en capuche noire) vers leur lieu de travail. Evoluant sur la piste du Fort d’Aubervilliers, il est dans un premier temps cadré au niveau des pattes et du bas ventre tandis que nous ne distinguons que les jambes du cavalier. Visiblement, le cinéaste –que nous avons entendu en voix off dire ‘bonjour’ à la cantonade- a décidé de se taire et de filmer ‘à hauteur de cheval’, du point de vue de la bête, en quelque sorte.
Si les préparatifs et les exercices se signalent par la variété des sons captés (cliquetis du harnais, frottement des sabots, hennissements, souffles de la respiration), les mots murmurés par le cavalier à l’adresse de sa monture préférée demeurent inaudibles. Nous percevons, en revanche, les effets de cette complicité sur les mouvements du cheval, du trot au galop et aux pas de danse, en une chorégraphie en devenir, dans ses balbutiements et ses recherches, jusqu’à ce corps fumant après la rudesse de l’effort, couché au sol, qui s’ébroue, se frotte le dos et roule sur lui-même à plusieurs reprises.
Rites et arabesques, complicité secrète
Petit à petit, les exercices et leur rituel se précisent et prennent sens sous nos yeux. La répétition n’exclut pas des variantes et l’émergence d’arabesques plus complexes. De la régularité des séances de travail, comme du renouvellement du bichonnage du cheval par de jeunes palefreniers zélés, naît la grâce de ‘figures’ équestres, faites de la précision, de la variété et des changements de rythme des pas de l’animal, tandis que les ‘bruits de bouche’ de la bête mêlés aux murmures indistincts de l’homme se conjuguent en un bruissement sonore, signe d’une communication secrète. Parfois, le cavalier, la tête sous le cou de sa monture, ébauche quelque geste doux comme une caresse et appuie sa main en un mouvement circulaire autour de l’œil, dans un silence que la durée du plan souligne.
Seules deux séquences viennent rompre cette routine apparente et cette intimité quotidienne des répétitions. Elles nous laissent alors entrevoir des ‘aperçus’ du spectacle à venir. Des chevaux au galop derrière un écran en transparence devant lequel des jeunes gens, comme nus en collant couleur chair, échevelés et affolés, ou sauvages en liberté, caracolent et se roulent par terre. Plus tard, l’écuyer, altier et droit sur son cheval nous donne la vision d’une chorégraphie légère et gracieuse, découpée dans l’ossature d’un cirque dont tout le reste aurait disparu, le décor et les spectateurs.
Le documentaire est ainsi construit, dans ce va-et-vient entre le box de préparation et la piste de répétition, de façon à ce qu’émerge devant nous la poésie du quotidien. Et, sur un signe infime au code indéchiffrable, tout à coup, le cheval esquisse quelques pas de danse ou se tient sur ses pattes de devant, la tête relevée devant son écuyer, lui-même debout, immobile.
« Le Caravage » ne nous livre pas de ‘sale petit secret’ sur les coulisses du Théâtre Zingaro. Il nous invite à mesurer l’ampleur du travail fourni en amont de l’acte de création et le long processus qui y conduit, fondé en particulier sur cette étrange entente créatrice, difficilement cernable, entre l’homme et l’animal.
Simplicité du geste cinématographique
Pour ce faire, Alain Cavalier choisit la simplicité extrême d’un dispositif léger : une petite caméra, une proximité ‘physique’ avec son sujet, un refus du commentaire, un filmage quotidien et prolongé. Des partis-pris qui permettent de saisir les infinies variations et progressions d’une création en cours. Le dispositif rencontre cependant ses propres limites lorsque Le Caravage s’approche de la caméra et, d’un coup de langue, recouvre, pour une poignée de secondes, l’objectif d’un ‘brouillard’ obstruant, une intervention dont le filmeur s’amuse et commente l’audace en voix off. Même si le documentaire se termine sur cette révolte soudaine du sujet contre le cameraman, il révèle l’extraordinaire foi dans les capacités du cinéma à saisir des processus invisibles (l’acte de création, la relation entre l’écuyer et sa monture, la complexité du rapport entre le domptage et la liberté…). Alain Cavalier souligne la difficulté de l’épreuve, à ses yeux : ‘Le duo Bartabas-Le Caravage, j’ai ramé avant de le filmer correctement. Il est fait de rythmes et mélodies musculaires qu’il faut capter à la seconde. J’étais jaloux de l’aisance de Bartabas sur sa monture, j’étais navré de mes mains pataudes sur ma caméra’. Réjouissons-nous : le cinéaste gagne avec brio la course d’obstacles.
Samra Bonvoisin
« Le Caravage », film d’Alain Cavalier-sortie en salle le 28 octobre 2015