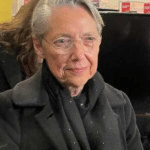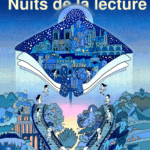Par François Jarraud
Samedi 11 décembre, l’Association des Enseignants et Chercheurs en Sciences de l’Education tenait congrès à Paris. C’était l’occasion pour les chercheurs de s’interroger sur leur place dans un paysage universitaire en recomposition et donc sur leur identité.
 Se retrouver pour ses quarante ans, c’est toujours un prétexte… C’est avec ces mots que Patricia Remoussenard et Richard Wittorski, au nom du conseil d’administration de l’AECSE (association des enseignants et chercheurs en sciences de l’éducation), ouvre la séance dans un lieu symbolique : l’amphi Durkheim de la Sorbonne. Mais au-delà du plaisir de se retrouver, c’est l’occasion de poser un regard rétrospectif (et prospectif) sur la construction des sciences de l’Education. Avec une question multiple qui va traverser la journée : quelle est la place des sciences de l’Education, quelle crédibilité, et quelle spécificité ?
Se retrouver pour ses quarante ans, c’est toujours un prétexte… C’est avec ces mots que Patricia Remoussenard et Richard Wittorski, au nom du conseil d’administration de l’AECSE (association des enseignants et chercheurs en sciences de l’éducation), ouvre la séance dans un lieu symbolique : l’amphi Durkheim de la Sorbonne. Mais au-delà du plaisir de se retrouver, c’est l’occasion de poser un regard rétrospectif (et prospectif) sur la construction des sciences de l’Education. Avec une question multiple qui va traverser la journée : quelle est la place des sciences de l’Education, quelle crédibilité, et quelle spécificité ?
On a beau n’avoir que quarante ans, on ne se rappelle pas forcément tout. Une première table-ronde, composée de Nassera Hedjerassi, Françoise Laot, Marie-Clotilde Pirot et Pascale Ponté, présente donc quelques traces d’histoire. Selon elles, l’émergence des sciences de l’éducation est directement liée avec une certaine institutionnalisation de « l’éducation nouvelle », dans les années 1950, avec par exemple la création du laboratoire de Psychopédagogie de l’ENS St Cloud par Gaston Mialaret, l’Institut pédagogique national (IPN, 1956) ancêtre de l’INRP, ou l’Institut de formation des adultes (Bertrand Schwartz, 1963). Dans les années 50, les première rencontres internationales ont lieu pour définir les méthodologies de recherche et de recueil de données d’une « psychopédagogie expérimentale ».
En 1968, un colloque à Amiens se penche sur « l’école nouvelle », la formation des maîtres et des recherches en éducation. Les « sciences de l’Education » cherchent leur chemin, entre psychopédagogie et sociologie. Une maîtrise en sciences de l’Education est créée en 1967. Ses cours s’adressent prioritairement aux formateurs d’adultes, d’enseignants ou d’animateurs socio-éducatifs. A Nanterre, Vincennes, Toulouse, Lyon, de nouveaux enseignements sont ouverts. Chateau, Debesse, Wittwer et Mialaret posent les jalons de l’Association des Enseignants Chercheurs en Sciences de l’Education (AECSE), de 1968 à 1972, dont le premier président est Michel Debeauvais.
Une association de chercheurs en sciences de l’éducation, à quoi ça sert ?
 A la tribune, plusieurs anciens responsables de l’association ont pris place. Michel Debeauvais prend plaisir à souligner les anecdotes de l’histoire commune, notamment lorsqu’en 1968, l’INRP s’est déclarée insurrectionnelle décrétant en assemblée générale du ministère. « C’était de la folie pure et nous étions quelques-uns à nous en inquiéter ». Un « Comité d’Action pour l’Innovation et la Recherche en éducation » (CAIRE) avait même été créé, avec un discours militant, qui devait durer un an et demi…Il raconte les premiers congrès internationaux, organisés en famille, sans aucun financement. Et c’est Gaston Mialaret, « fédérateur des différents courants qui nous traversaient », qui lui succédera.
A la tribune, plusieurs anciens responsables de l’association ont pris place. Michel Debeauvais prend plaisir à souligner les anecdotes de l’histoire commune, notamment lorsqu’en 1968, l’INRP s’est déclarée insurrectionnelle décrétant en assemblée générale du ministère. « C’était de la folie pure et nous étions quelques-uns à nous en inquiéter ». Un « Comité d’Action pour l’Innovation et la Recherche en éducation » (CAIRE) avait même été créé, avec un discours militant, qui devait durer un an et demi…Il raconte les premiers congrès internationaux, organisés en famille, sans aucun financement. Et c’est Gaston Mialaret, « fédérateur des différents courants qui nous traversaient », qui lui succédera.
« Appartenir à une association de spécialistes, explique Brigitte Alberto, a contribué à m’inscrire dans un champ de recherche mieux identifié, à pouvoir partager les questions et sortir des égocentrismes qui nous guettent. On devient co-responsable d’un ensemble social qui dépasse nos propres laboratoires, qui structure les collectifs scientifiques si nécessaires. » Elle pointe cependant la difficulté à faire histoire, à articuler la recherche et la formation, à discuter les modèles de recherche et à savoir préparer les « passages de relais ». « Etre fier de ce qu’on a déjà fait, et trouver la force de le dépasser… Le défi de la quarantaine ? » s’amuse-t-elle
« Dans les années 80, nous nous sentions fragiles et menacés. » poursuit Michèle Guigue. Cette crainte lui parait dépassée, si on regarde les effectifs universitaires, mais réelle quand on observe les réorganisations universitaires en marche avec les PRES. « Notre pouvoir est limité, mais nous pouvons créer des carrefours entre disciplines, filières de formation et institutions en tensions. Encore faut-il que nous sachions mieux ce que nous avons en commun… ». Gaston Mialaret se rappelle des questions qu’il posait au ministère sur les débouchés des filières « Sciences de l’Education », auxquelles il n’a jamais eu de réponse, et la vieille question qu’il a toujours eu à traiter : les sciences d’éducation ne sont-elles qu’un carrefour entre différentes disciplines, ou ont-elles un coeur en commun ? « Ne pas être monodisciplinaire, par les temps qui courent, me semble être un atout » reprend-on à la tribune. « Nous avons aujourd’hui des nouvelles générations qui s’appuient sur des connaissances spécifiques, explique R. Wittorski à partir de son parcours personnel. « Peut-être ne savons-nous pas encore le rendre très visible ? »
 « Ce problème se pose dans toutes les sciences sociales, en psychologie ou en sociologie » reprend Michel Debeauvais en citant la nécessaire « percolation » entre la recherche et ses applications, par le travail commun. « Pluri, inter et trans-disciplinarité sont une caractéristique de notre milieu, mais ce corps de connaissance n’est pas encore suffisamment explicité ni visible. Depuis quarante ans, la question du sens, des finalités et de la valeurs de nos recherches nous traverse, avec le défi de la place à trouver dans le contexte international. » « Nous devons nous attacher à cartographier nos travaux, faire savoir ce que nous sommes de manière compréhensible de l’extérieur, insiste P. Remoussenard.
« Ce problème se pose dans toutes les sciences sociales, en psychologie ou en sociologie » reprend Michel Debeauvais en citant la nécessaire « percolation » entre la recherche et ses applications, par le travail commun. « Pluri, inter et trans-disciplinarité sont une caractéristique de notre milieu, mais ce corps de connaissance n’est pas encore suffisamment explicité ni visible. Depuis quarante ans, la question du sens, des finalités et de la valeurs de nos recherches nous traverse, avec le défi de la place à trouver dans le contexte international. » « Nous devons nous attacher à cartographier nos travaux, faire savoir ce que nous sommes de manière compréhensible de l’extérieur, insiste P. Remoussenard.
Même s’il n’est pas sur le même champ de travail, Alain Kiyindou raconte à quel point son association, qui rassemble les professionnels français des sciences de l’information et de la communication (InfoCom), se pose les mêmes questions : « comme vous, nous ne savons pas tout à fait comment on doit appeler les enseignants de notre disciplinie, et nous nous posons la question de définir notre spécificité disciplinaire, au-delà de notre position de carrefour. Comme vous, notre discipline et nos recherches évoluent au fur et à mesure des évolutions de société. Nous avons donc sans doute à gagner à nouer des alliances ». Un ange passe dans la salle, de cette proximité entre InfoCom et sciences de l’Education. Les anciens auraient-ils apprécié ce rapprochement ? Qu’on s’en réjouisse ou qu’on s’en émeuve, une coincidence troublante : c’est justement un spécialiste de la communication, Yves Winkin, qui vient de rédiger pour le ministère le rapport qui prévoit la dissolution de l’INRP dans l’ENS, et qui invite fortement les chercheurs en éducation à « s’extravertir » et à trouver les ressorts du « bonheur à l’école »…
Ingrid Gogolin conclut la matinée, de son point de vue de responsable d’institutions internationales de chercheurs en éducation. Elle invite à dépasser les interrogations identitaires pour être en mesure d’affronter la complexité du monde. L’investissement dans l’accompagnement des jeunes chercheurs en est un aspect important, de même que l’internationalisation du champ de recherche. « Nous devons communiquer avec l’extérieur, répondre mieux aux questions qu’on nous pose lorsqu’on interroge la qualité de nos recherches, nous n’existons pas que pour nous ! ».
Et demain ?
Comment s’articulent les instances et les acteurs ? Qui peut être un interlocuteur crédible pour les pouvoirs publics ? Ce sont les questions posées par Patricia Remoussenard au nom de l’association, aux invités de la table-ronde de l’après-midi.
 C’est en rendant hommage à l’action essentielle de Jacky Beillerot qui Paul Durning (Paris Ouest) insiste sur les trois rôles que doivent jouer les chercheurs français en sciences de l’éducation : faire connaître les travaux étrangers, diffuser les autres approches scientifiques qui participent à « expliquer la réalité », en sachant construire des modèles complexes, et faire le lien avec les pratiques professionnelles. Ce sont ces trois dimensions qui peuvent les aider à devenir des interlocuteurs crédibles pour les pouvoirs politiques. Ils doivent donc être à même de travailler avec de jeunes étudiants comme avec les professionnels de l’éducation et de la santé, en formation initiale comme en formation continue, sans oublier de réfléchir aux questions éthiques dans le champ sciences de l’Education, qui envahissent l’espace.
C’est en rendant hommage à l’action essentielle de Jacky Beillerot qui Paul Durning (Paris Ouest) insiste sur les trois rôles que doivent jouer les chercheurs français en sciences de l’éducation : faire connaître les travaux étrangers, diffuser les autres approches scientifiques qui participent à « expliquer la réalité », en sachant construire des modèles complexes, et faire le lien avec les pratiques professionnelles. Ce sont ces trois dimensions qui peuvent les aider à devenir des interlocuteurs crédibles pour les pouvoirs politiques. Ils doivent donc être à même de travailler avec de jeunes étudiants comme avec les professionnels de l’éducation et de la santé, en formation initiale comme en formation continue, sans oublier de réfléchir aux questions éthiques dans le champ sciences de l’Education, qui envahissent l’espace.
Pour Marguerite Altet (université de Nantes), des concepts nouveaux apparaissent sans arrêt (rapport au savoir, interactions entre enseignement et apprentissage…), qui amènent les sciences de l’Education à travailler sur des « zones frontières », de manière pluri-disciplinaire, en structurant des réseaux (OPEN, RESEDA…). « Quand les sciences de l’Education ont été créées, c’était pour former les enseignants et les formateurs. Quand la formation est menacée, l’utilité sociale des sciences de l’Education n’a plus beaucoup de sens… ». Elle insiste aussi sur « la place à prendre dans le domaine de la pédagogie universitaire, qui est aujourd’hui une urgence », avant d’inviter la salle à davantage publier dans les revue anglophones, « pour y faire valoir nos entrées spécifiques face à l’inflation des discours sur les bonnes pratiques ».
Patrick Rayou (université Paris 8) entend nourrir le débat de réflexions personnelles : « nous avons des difficultés à nous situer entre société savante et lobying politique, parce que malgré l’importance de nos travaux, la méfiance, voire la tentation d’instrumentalisation est grande », surtout lorsque le politique persiste dans sa volonté de légiférer dans l’urgence médiatique. Il rappelle les méfiances du monde universitaire pour les questions pédagogiques et pratiques. Il cite le symbole de la dissolution de l’INRP dans l’ENS, mais refuse de cultiver une position surplombante : pour de multiples raisons, « l’INRP n’a pas pu jouer son rôle d’impulsion et de coordination de la recherche en éducation, le PIREF lui-même est mort-né, ce qui ne nous facilité pas la tâche ». Pour lui, les vrais réseaux utiles sont « les réseaux artisanaux que nous fabriquons, souvent hors de structures bureaucratiques : cultivons-les dans nos moments de rencontres, en clarifiant avec exigence nos modèles de recherches. »
Jean-Marie Barbier (CNAM), en tant que responsable du CNU (70e section) et ancien responsable de l’AECSE, invite à ne plus « réclamer la reconnaissance, mais à occuper les positions qui le permettent », notamment en « disant des choses d’un intérêt suffisamment général pour qu’elles soient reprises au-delà de notre univers, dans les créneaux de transformation du système. Prenons des initiatives qui soient attendues par les acteurs, et nous seront entendus ! »
Cela doit, pense-t-il, conduire à des stratégies de « double-reconnaissance », sur le terrain scientifique comme sur le terrain professionnel. Il martèle : « Conduisons des travaux scientifiques sur des questions qui soient des enjeux sociaux, et nous serons reconnus ». Exigence de qualité ne veut pas dire académisation : « Beaucoup trop de nos travaux ont un statut epistémologique ambigu. Distinguons davantage ce qui vise à comprendre les pratiques et ce qui vise à les modifier ! » provoque-t-il. « Il faut certes produire des savoirs, mas aussi produire des outils générateurs de savoirs ». Il est normal que nos objets scientifiques soient construits culturellement, mais cela n’est pas une raison pour que nous refusions de nous confronter aux anglo-saxons ou aux allemands. »
 L’évaluation, justement… Joël Lebeaume (Cachan) siège désormais à l’AERES, chargée d’évaluer les équipes de recherches, ce qui est une nouveauté pour le champ des sciences de l’Education. L’AERES, explique-t-il, évalue les établissements, les unités de recherche et les formations universitaires, « en renvoyant une image aussi fidèle que possible des activités de recherche pour aider les équipes à développer des stratégies locales », dans une logique de site et non dans une logique strictement disciplinaire. Mais « cette évaluation peut crisper », notamment avec la notation des équipes, qui peut fermer des portes (lorsque la notation est inférieure à A) pour participer aux laboratoires d’excellence ouvrant droit à de nouveaux financements. J. Lebeaume refuse cependant de considérer que l’approche de l’AERES soit « normative », pensant au contraire qu’elle aide les laboratoires à se « poser les bonnes questions » sur ce qu’ils produisent, que ce soit des concepts ou des outils…
L’évaluation, justement… Joël Lebeaume (Cachan) siège désormais à l’AERES, chargée d’évaluer les équipes de recherches, ce qui est une nouveauté pour le champ des sciences de l’Education. L’AERES, explique-t-il, évalue les établissements, les unités de recherche et les formations universitaires, « en renvoyant une image aussi fidèle que possible des activités de recherche pour aider les équipes à développer des stratégies locales », dans une logique de site et non dans une logique strictement disciplinaire. Mais « cette évaluation peut crisper », notamment avec la notation des équipes, qui peut fermer des portes (lorsque la notation est inférieure à A) pour participer aux laboratoires d’excellence ouvrant droit à de nouveaux financements. J. Lebeaume refuse cependant de considérer que l’approche de l’AERES soit « normative », pensant au contraire qu’elle aide les laboratoires à se « poser les bonnes questions » sur ce qu’ils produisent, que ce soit des concepts ou des outils…
Il conclut avec une belle métaphore : « Contrairement à un champ électrique à la polarité simple, le champ des sciences de l’éducation est multipolaire et fragmenté. C’est structurant si l’un n’ignore pas l’autre, si on repère bien ce qu’on fait et ce qu’on ne fait pas ». Les grandes mutations ouvrent des questions nouvelles, qui peuvent modifier les positionnements des équipes de recherche. L’AECSE peut-être le lieu d’analyse des questions nouvelles : « ainsi, Pisa nous montre que les résultats de nos élèves en sciences sont médiocres, malgré l’avancée de nos recherches en didactique des sciences. Sans doute avons-nous à traiter de nouvelles questions pour comprendre pourquoi nous n’arrivons pas à donner une culture scientifique de base à tous ».
Gilles Baillat, en tant que président de la conférence des directeurs d’IUFM, souligne une ambiguité : « les IUFM n’ont jamais été des facultés de sciences d’éducation ». Cependant, aujourd’hui, la masterisation change la donne : en devenant des composantes de l’université, chargées exclusivement de masters, « nous avons à résoudre une question compliquée, puisque une minorité de nos universitaires viennent des sciences de l’Education. Nous sommes dans un champ de pratiques, la formation des enseignants, dont il n’a jamais été dit en France qu’elle doive relever d’un champ scientifique ». Chaque discipline est sensée y faire des apports, avec une tension entre la mission de formation et les ressorts qui doivent la structurer : la « professionnalité » des enseignants reste toujours à définir.
C’est pourquoi la conférence des directeurs d’IUFM appelle à reposer la question d’un grand organisme de recherche pilotant le champ, « pour ne pas refaire dans dix ans le bilan du discrédit sur nos disciplines ». Pour y contribuer, la CDIUFM a décidé de se doter d’une commission scientifique pouvant permettre d’y travailler.
La journée a vite passé, et les appels à mieux organiser le champ de la recherche en éducation ont donc été multiples, même s’ils sont restés dans le ton feutré et poli qui sied à tout échange entre universitaires… Effet de tribunes ou véritable préoccupation qui va diffuser dans les nombreux laboratoires dont l’AECSE est en train de finir la cartographie et les spécialités ? En tout cas, les débats de la journée ont largement repris les questions que posait il y a quelques mois David Bridges à la clôture de la session genevoise de l’AREF : « «Notre discipline est caractérisée par une prolifération de paradigmes qui en fait un domaine dans lequel il n’existe que peu de consensus quant à ce que sont la recherche et la science et ce à quoi elles devraient ressembler» disait-il. Les chercheurs en éducation ont-ils les moyens et l’envie de s’y attaquer ? Un sacré chantier pour les quarante ans à veniir, et la future direction de l’AECSE.
Le site de l’AECSE
|
Sur le site du Café
|