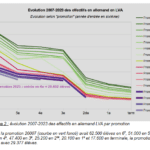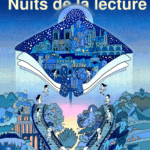Par François Jarraud
JP Astolfi réconcilie savoirs disciplinaires et constructivisme
De tous les livres, quelques uns émergent. C’est le cas de celui de Jean-Pierre Astolfi. D’abord par le style clair au service d’une pensée dense et ruche. Ensuite par les efforts développés par l’auteur et l’éditeur pour la mettre au service du lecteur : des résumés réguliers, un commentaire de synthèse par double page. Enfin par la thèse. CE que nous propose JP Astolfi c’est de dépasser le clivage connaissances disciplinaires – sciences de l’éducation. Il montre qu’une véritable transmission des premières utilise obligatoirement le constructivisme. Mais il montre aussi que les vrais savoirs sont emplis de saveurs et qu’ils devraient être le svrais moteurs de l’enseignement.
Entretien avec Jean-Pierre Astolfi
Remarquablement écrit, d’une grande densité et en même temps d’une grande clarté, votre ouvrage mène une réflexion de fond sur l’enseignement. Le moment vous semble-t-il opportun ?
 Merci d’abord pour le compliment toujours agréable à entendre, mais pour moi le souci de l’écriture n’est pas une coquetterie gratuite. Comment convaincre de recentrer l’école sur la saveur du savoir et le plaisir d’apprendre, si on promeut cette idée dans une écriture indigeste et pesante, comme c’est hélas souvent le cas dans la littérature pédagogique ?
Merci d’abord pour le compliment toujours agréable à entendre, mais pour moi le souci de l’écriture n’est pas une coquetterie gratuite. Comment convaincre de recentrer l’école sur la saveur du savoir et le plaisir d’apprendre, si on promeut cette idée dans une écriture indigeste et pesante, comme c’est hélas souvent le cas dans la littérature pédagogique ?
Nous sommes à un moment historique où certaines questions centrales ne peuvent être esquivées, mais où les choix de politique éducative risquent de s’opérer à « bas bruit », sans grands remous, si l’on n’appelle pas les choses par leur nom. Ce moment actuel est celui d’un très grand décalage entre des acquis considérables sur les apprentissages et les didactiques depuis les années 80, appuyés de très nombreuses recherches et publications internationales, et le maintien d’une représentation très conservatrice sur ce qu’est l’acte d’apprendre.
On n’est jamais sûr que le moment soit le plus opportun, mais je souhaite sortir de la crainte si fréquente qui conduit à taire certaines choses telles qu’on les pense… parce qu’elles pour-raient faire le jeu de l’adversaire ! Je ne vois pas au nom de quoi il faudrait abandonner la question du savoir aux « rétronovateurs ».
L’ouvrage réhabilite les savoirs disciplinaires. Vous dites même que ce sont des « sa-voirs extraordinaires qui font entrer dans des interprétations du monde inouïes ». On a pourtant l’impression que la transmission des savoirs disciplinaires est à la mode actuellement et que cette transmission se marie bien avec l’ennui. Comment vous positionnez vous par rapport à ceux qui revendiquent cette transmission ?
Le problème essentiel est sans doute que malgré leur modèle de formation très disciplinaire, les enseignants (je parle d’abord ici de ceux du secondaire) n’ont qu’une très vague idée de ce qu’est vraiment leur discipline. Ils la voient comme un ensemble de contenus platement posi-tifs (des définitions, des formules, des règles…), et non pas comme un mode de questionne-ment spécifique rendu possible par les concepts originaux que la communauté des chercheurs a construits contre le sens commun.
Les disciplines sont trop souvent vues comme des enfermements du savoir dans des frontières artificielles, alors qu’elles consistent à « chausser des lunettes » différentes selon la façon dont on questionne le monde. C’est pourquoi je parle de savoirs « extra-ordinaires ». Si les professeurs eux-mêmes ont une telle conception de leur discipline, on se doute de ce que cela va donner pour les élèves… Il y a quelques années, le philosophe Dominique Lecourt avait été chargé de réfléchir à la façon dont on pourrait inclure dans la formation universitaire des éléments relatifs à l’histoire et à l’épistémologie des disciplines. Ça a fait plouf !
En fait, il y a une ambiguïté fondamentale avec le mot « transmission ». Tout dépend de quoi l’on parle… Il faut toujours revenir à Gaston Bachelard pour qui « l’enseignement des résultats de la science n’est jamais un enseignement scientifique ». On pourrait traduire cela dans le langage contemporain, en rappelant que l’élève ne dispose pas d’un port USB sur sa tempe, qui permettrait une transmission de l’information entre la tête du professeur et la sienne. Ap-prendre suppose une reconstruction personnelle par chaque apprenant (élève ou adulte) de ce qui a été déjà été construit par les disciplines mais qui lui est encore étranger. Et qui dit re-construction, dit d’abord déconstruction, c’est-à-dire une réorganisation mentale lente et com-plexe de tout un système de représentations qui vient de loin.
Pourtant, l’ensemble de la scolarité vise bel et bien la transmission générationnelle d’une culture, mais il s’agit d’une transmission culturelle et sociale qui n’est pas la somme de toutes les petites transmissions cognitives individuelles telles qu’on les suppose.
Vous défendez le constructivisme, vous dites même qu’il ne devrait pas être objet de débat. Pourtant il l’est…
Le constructivisme, c’est justement l’opposé de la transmission. Et j’insiste d’ailleurs dans le livre sur le fait qu’il y a trois constructivismes pour le prix d’un seul (!) :
? un constructivisme épistémologique, qui fait renoncer à envisager le savoir d’une disci-pline comme une collection de faits, de données, de formules, de résultats, de règles… Tous les grands épistémologues du XXe siècle sont constructivistes (Bachelard, Canguil-hem, Foucault, Popper, Kuhn, Feyerabend…). Cela n’a pas empêché les débats les plus vifs sur la nature de ce constructivisme, mais sans que personne ne propose de retomber dans les ornières de l’empirisme et du positivisme, que l’école pratique pourtant au quoti-dien !
? un constructivisme psychologique, qui fait envisager l’acte d’apprendre comme un sys-tème de pensée en évolution permanente, avec ses progrès, ses réorganisations mentales et ses ruptures, tout au long de l’enfance, de la scolarité, et finalement de la vie. Tous les psychologues du XXe siècle ont également été constructivistes (Piaget, Wallon, Bruner, Vygotski, Leontiev, Ausubel…), ce qui là aussi a suscité de multiples débats théoriques car ils sont loin d’avoir tous été d’accord entre eux. Pourtant, nulle part dans le monde, on ne trouve de « théorie de l’imprégnation conceptuelle »… et c’est pourtant cette théorie qui légitime implicitement bien des pratiques scolaires ;
? un constructivisme pédagogique, qui s’appuie sur les deux précédents pour remettre en question le fonctionnement de la forme scolaire dominante. Ce troisième champ s’organise autour de dispositifs variés, qui empruntent aussi bien aux  propositions an-ciennes et récentes des pédagogues, qu’aux mouvements pédagogiques et aux didactiques des disciplines. Mais dans ce troisième champ, il n’y a plus aucun consensus. Je cite Phi-lippe Perrenoud, qui demande de façon faussement ingénue : « Etes-vous pour ou contre la gravitation universelle ? ». Pour montrer bien sûr l’absurdité de la question, mais aussi pour souligner que ce qui est impossible pour les sciences devient possible dès qu’il s’agit d’éducation ! Sa conclusion, que je partage, est que lorsque les enseignants seront formés comme des experts en processus d’apprentissage, le constructivisme fera partie de leur culture de base. Ce ne sera plus une question d’opinion mais relèvera d’un savoir profes-sionnel partagé. Qu’un professeur puisse ne pas être constructiviste… paraîtra alors aussi anachronique qu’un médecin qui nierait le rôle des bactéries ou un physicien la loi de la gravitation universelle ! Cela favorisera d’ailleurs d’authentiques débats sur les questions d’apprentissage, car aujourd’hui, l’effet premier des altercations médiatiques de façade est de rendre impossible le débat. Plus que l’effet, c’est peut-être même le but recherché, puisqu’il laisse à chacun le droit de penser ce qu’il veut…
propositions an-ciennes et récentes des pédagogues, qu’aux mouvements pédagogiques et aux didactiques des disciplines. Mais dans ce troisième champ, il n’y a plus aucun consensus. Je cite Phi-lippe Perrenoud, qui demande de façon faussement ingénue : « Etes-vous pour ou contre la gravitation universelle ? ». Pour montrer bien sûr l’absurdité de la question, mais aussi pour souligner que ce qui est impossible pour les sciences devient possible dès qu’il s’agit d’éducation ! Sa conclusion, que je partage, est que lorsque les enseignants seront formés comme des experts en processus d’apprentissage, le constructivisme fera partie de leur culture de base. Ce ne sera plus une question d’opinion mais relèvera d’un savoir profes-sionnel partagé. Qu’un professeur puisse ne pas être constructiviste… paraîtra alors aussi anachronique qu’un médecin qui nierait le rôle des bactéries ou un physicien la loi de la gravitation universelle ! Cela favorisera d’ailleurs d’authentiques débats sur les questions d’apprentissage, car aujourd’hui, l’effet premier des altercations médiatiques de façade est de rendre impossible le débat. Plus que l’effet, c’est peut-être même le but recherché, puisqu’il laisse à chacun le droit de penser ce qu’il veut…
Qu’est ce qui pourrait rendre les savoirs « savoureux » ? Qu’est ce qui pousse un en-fant à apprendre ?
Si chaque discipline développe des savoirs « extra-ordinaires », c’est parce qu’elle renverse la table de nos certitudes, parce qu’elle propose des interprétations imprévues, voire sidérantes sur tous les objets de la connaissance. Ce qui fait obstacle aux apprentissages scolaires, ce n’est pas tant nos ignorances que la surabondance de nos explications immédiates sur tout et n’importe quoi. C’est le principe même des discussions type « café du commerce » (pas café pédagogique bien sûr… !), dans lesquelles chacun a un avis sur tout et le défend mordicus. Nous fonctionnons quotidiennement avec ce genre de « savoirs privés », souvent suffisants d’ailleurs pour vivre, décider, choisir…
L’école exige une rupture avec ce fonctionnement spontané de la pensée, chaque discipline introduisant des outils théoriques nouveaux. Ceux-ci produisent en nous des « insights », c’est-à-dire des sortes d’illuminations soudaines, de renversements de perspectives (eurê-ka… !). Avec Bachelard toujours, on peut ainsi définir chaque discipline comme une « philosophie du non » : non, le soleil ne tourne pas autour de la terre ! non, le déplacement d’un mobile ne suppose pas nécessairement l’existence d’une force ! non, il n’y a pas de génération spontanée des êtres vivants, etc.
Dans l’introduction du livre, j’ai proposé une petite liste personnelle de ces moments d’insight où j’ai vécu une bascule de mes évidences sur les sujets les plus divers… Tantôt, il s’agit de situations concrètes qui donnent brusquement de la « chair » à une connaissance restée jus-que-là squelettique, c’est-à-dire déclarative et dépourvue d’investissement personnel. Mais le plus souvent, c’est l’irruption d’une dimension théorique imprévue qui réorganise en profondeur nos perceptions. Livrez-vous à l’exercice sur vous-même, vous verrez que c’est assez jubilatoire. Or, le plus souvent, il ne reste rien à l’école de ce que les disciplines peuvent avoir de « décoiffant » ! Exit alors le désir d’apprendre…, bonjour la monotonie et l’ennui scolaire dont les élèves parlent dès qu’on leur permet de s’exprimer.
Quel dispositif un enseignant peut-il mettre en place pour donner du goût aux savoirs ?
Pour vous répondre, il faudrait que je reprenne l’ensemble des analyses et propositions développées dans l’ouvrage ! Comment faire ? Je crois essentiel de dire d’emblée qu’il ne s’agit pas de proposer une « pédagogie de l’extrême », super-exigeante pour les professeurs comme pour les élèves, cherchant à surprendre à chaque instant ! Loin de toute « Ushuaia pédagogi-que » donc, il s’agit plutôt de ne pas oublier que nos apprentissages essentiels relèvent d’une transformation de nos savoirs disponibles plutôt que d’une acquisition de « savoirs tout neufs », même s’il n’y a pas d’exclusive entre les uns et les autres. Il n’y a pas non plus de méthodes toutes faites pour y parvenir, et c’est peut-être tant mieux !
Je préfère parler de « révolutions minuscules » ou de « petits moments magiques », qui bous-culent les certitudes et qui « boostent » la réflexion des élèves. Surtout, qui leur fassent vivre concrètement, dans différentes disciplines et sur des exemples limités, l’expérience de ce qu’un savoir disciplinaire produit comme surprise et inspiration. Je repense ici à ce que Louis Legrand appelait une « pédagogie de l’étonnement » et Georges Snyders « la joie à l’école ».
Par exemple, je me souviens d’un cours de chimie où les élèves étaient invités à « corriger » un texte de Lavoisier, c’est-à-dire à le réécrire en respectant le vocabulaire de la physique d’aujourd’hui. À l’époque, la distinction entre corps simple et élément n’était pas encore sta-bilisée, et ils ont été très surpris de découvrir sous la plume du savant certaines expressions fautives qui ressemblent aux leurs. Du coup, puisque même Lavoisier s’est trompé, leurs er-reurs changent de statut. La leçon prend une signification nouvelle en leur permettant d’accéder au cœur de la chimie bien davantage qu’avec des définitions et des exercices formels.
Je pense aussi à des élèves de collège peinant pour rédiger un court récit, et à qui on fait pren-dre conscience que si le « texte premier » qu’ils jettent sur le papier (et c’est à dessein que je n’emploie pas le mot « brouillon » !) n’est pas très satisfaisant, c’est parce qu’il correspond davantage à de l’oral transcrit qu’à de l’écrit véritable. Ils découvrent avec étonnement que l’écrit se travaille comme une sorte de « langue seconde ».
Bref, d’une façon ou d’une autre, il s’agit de voir comment on peut remonter des réponses, disponibles comme des « faits », à un mode de questionnement qui en restitue le sens. Je me souviens de ma propre surprise en entendant un mathématicien expliquer que ce qu’on croît être la formule de la surface du trapèze, n’est qu’en réalité que celle de la surface d’un rectangle équivalent ! Car la surface du trapèze, on ne sait pas la calculer directement, et on ne la trouve qu’en bricolant la banale formule de la surface du rectangle : S = L x l. Il en va de même pour celle de la surface du cercle.
L’école, comme institution, peut-elle passer des petits plats ou n’est elle outillée que pour faire la cantine ?
C’est une vraie question, connue dans l’histoire de l’éducation sous le nom de « forme sco-laire ». La forme moderne de l’école, introduite par Saint Jean-Baptiste de la Salle avant d’être « républicanisée » par Jules Ferry, a permis de rompre avec les apprentissages qui étaient jusque là intégrés à la vie familiale, sociale et professionnelle (comme le compagnon-nage), mais dont la rencontre par les enfants était largement due au hasard des circonstances et des opportunités. L’effet bénéfique fut de rendre programmables des contenus d’enseignement jusque là aléatoires, mais avec pour contrepartie négative de les couper de la « vraie vie ». De telle sorte que ce qui s’est gagné en efficience risque en permanence de faire perdre la question du sens.
La forme scolaire tend ainsi à transformer toutes les disciplines scolaires en « grammaires formelles » des savoirs. L’école crée ainsi de l’enseignable, sous forme de gammes d’exercices, de problèmes, d’activités, de contrôles évaluatifs standardisés… qui servent au-tant à « occuper les heures » qu’à promouvoir une éducation intellectuelle. C’est sans doute cela qu’en reprenant votre formule, on peut appeler la cantine !
 Il faut certainement accepter pour une part cette façon dont s’est construite l’histoire de l’école, parce que c’est la rançon de la généralisation de l’enseignement. Les notions de forme scolaire et de « transposition didactique » montrent qu’il est sans doute illusoire de penser que les disciplines scolaires puissent être un fidèle reflet épistémique des disciplines académiques. Elles nous obligent à la modestie en comprenant mieux les raisons d’une certaine « viscosité » des formes d’enseignement. Mais ce n’est pas une raison pour totalement renoncer. Si sur certains aspects, on arrive à faire comprendre aux élèves d’où viennent les savoirs, comment ils se sont construits, à quelles questions ils apportent des réponses, ce sera déjà bien. Ils se-ront mieux en mesure de comprendre que d’autres contenus d’enseignement, qui leur sont proposés sans cet éclairage, ont pu être élaborés suivant des modalités comparables, mais ail-leurs et par d’autres. Et il n’est pas forcément si négatif que certaines questions restent ouver-tes…
Il faut certainement accepter pour une part cette façon dont s’est construite l’histoire de l’école, parce que c’est la rançon de la généralisation de l’enseignement. Les notions de forme scolaire et de « transposition didactique » montrent qu’il est sans doute illusoire de penser que les disciplines scolaires puissent être un fidèle reflet épistémique des disciplines académiques. Elles nous obligent à la modestie en comprenant mieux les raisons d’une certaine « viscosité » des formes d’enseignement. Mais ce n’est pas une raison pour totalement renoncer. Si sur certains aspects, on arrive à faire comprendre aux élèves d’où viennent les savoirs, comment ils se sont construits, à quelles questions ils apportent des réponses, ce sera déjà bien. Ils se-ront mieux en mesure de comprendre que d’autres contenus d’enseignement, qui leur sont proposés sans cet éclairage, ont pu être élaborés suivant des modalités comparables, mais ail-leurs et par d’autres. Et il n’est pas forcément si négatif que certaines questions restent ouver-tes…
Dans les initiatives récentes, il y a le soutien pédagogique, l’accompagnement pédago-gique. Cela vous semble-t-il participer d’une bonne cuisine éducative ?
Toutes ces nouvelles modalités pédagogiques dont on voit le développement en dehors du temps scolaire proprement dit, peuvent effectivement être des aides efficaces, mais à la condi-tion qu’elles jouent effectivement sur la saveur des savoirs, sur le rapport au savoir. Le risque est ici celui d’un ersatz du constructivisme, que dans un ouvrage précédent, j’avais appelé le « Canada dry » de l’apprentissage.
Je pense qu’on fait ainsi plus de mal que de bien à l’idée constructiviste, dont il importe de bien identifier les dérives fréquentes pour les passer au crible critique. Car évidemment les anti-pédagogues s’engouffrent dans la brèche ! Il ne faut pas hésiter à dire que bien des prati-ques ont une certaine allure de questionnement pédagogique et de dialogue participatif, mais que la ressemblance reste superficielle. C’est pourquoi j’ai tenté au chapitre 4 de lister différents ingrédients de ce que j’ai appelé de la « fausse monnaie constructiviste ». Le risque est avéré de remplacer alors une adhésion réelle au modèle constructiviste, par un discours de surface « pédagogiquement correct », sans que les pratiques effectives évoluent réellement.
Je dis cela d’une façon tranquille, aucunement dénonciatrice, dans le respect des personnes. Car de telles dérives sont d’abord dues à la prégnance d’une représentation sociale aussi mas-sive que résistante, mais qui reste invisible parce qu’elle se présente comme frappée au coin du bon sens. Aucune surenchère maximaliste ni idéologique n’est donc ici de mise. Il faut plutôt encourager et capitaliser au contraire toutes les tentatives, même modestes, pour ac-compagner un changement de paradigme didactique qui se cherche encore.
Jean-Pierre Astolfi
professeur de sciences de l’ éducation à l’Université de Rouen
Entretien : François Jarraud
 Jean-Pierre Astolfi, La saveur des savoirs. Disciplines et plaisir d’apprendre, Paris ESF, 2008, 252 pages.
Jean-Pierre Astolfi, La saveur des savoirs. Disciplines et plaisir d’apprendre, Paris ESF, 2008, 252 pages.
Changez d’école par la coopération : Entretien avec Sylvain Connac
« Que nous faut-il pour rompre avec la ségrégation scolaire, la violence des jeunes et le consumérisme des parents ? Oser penser autrement ». C’est à cette possibilité de renouveau, sérieuse, armée d’une pratique expérimentée longuement, appuyée sur des bases théoriques débattues, que nous invite le livre de Sylvain Connac, « Apprendre avec les pédagogies innovantes ». Il nous accorde un entretien.
Peut-on apprendre par la coopération et de la coopération ? Sylvain Connac qui bénéficie d’une d’une longue pratique de terrain, dans un milieu socialement défavorisé, et d’une rare capacité à confronter les apports théoriques aux faits, pense que oui. Pour lui, la démarche coopérative a à voir avec la construction des connaissances. Elle transmet en même temps des valeurs sociales qui sont celles d’une société démocratique. C’est ce qu’il montre dans son livre « Apprendre avec les pédagogies coopératives » (ESF ).
Votre ouvrage est tout à fait original puisqu’il est à la fois théorique et très pratique. Commençons peut-être par la théorie. Vous arrivez à faire le lien entre Freinet et la recherche moderne sur la mémoire, le cerveau. Peut-on associer les deux ?
 Merci d’avoir relevé qu’effectivement une de mes intentions était d’associer dans ce travail les données théoriques et scientifiques à celles issues de la pratique. L’un de mes premiers guides en matière de pédagogie, Hamid Aït Saïd, faisait vivre des projets autour de cette maxime : « Faire de l’action la base de nos réflexions et de la réflexion un des moteurs de l’action. » Je pense qu’en effet, il y a tout intérêt à éclairer nos pratiques enseignantes de ce que la culture pédagogique a pu développer. Il s’agit de ne pas avoir à reproduire sans cesse le labeur de Sisyphe. Au moins depuis Rousseau et les pédagogues de l’Education Nouvelle (de J.H. Pestalozzi à Ph. Meirieu), des savoirs pédagogiques ont pu être stabilisés. Ce serait dommage et stérile de s’en passer en tentant d’occulter les expériences de nos aînés.
Merci d’avoir relevé qu’effectivement une de mes intentions était d’associer dans ce travail les données théoriques et scientifiques à celles issues de la pratique. L’un de mes premiers guides en matière de pédagogie, Hamid Aït Saïd, faisait vivre des projets autour de cette maxime : « Faire de l’action la base de nos réflexions et de la réflexion un des moteurs de l’action. » Je pense qu’en effet, il y a tout intérêt à éclairer nos pratiques enseignantes de ce que la culture pédagogique a pu développer. Il s’agit de ne pas avoir à reproduire sans cesse le labeur de Sisyphe. Au moins depuis Rousseau et les pédagogues de l’Education Nouvelle (de J.H. Pestalozzi à Ph. Meirieu), des savoirs pédagogiques ont pu être stabilisés. Ce serait dommage et stérile de s’en passer en tentant d’occulter les expériences de nos aînés.
En même temps, l’agir pédagogique ne peut se satisfaire de conduites à tenir, tant l’acte est complexe et nécessite remises en questions et adaptations. Mais c’est justement parce qu’aucune méthode ne peut se vanter d’être en mesure de correspondre à tous les contextes, que l’on a une nouvelle fois tout intérêt à s’appuyer sur ces savoirs pédagogiques. Ils vont permettre de dépasser rapidement les problématiques des premières fois pour optimiser l’impact de nos projets.
Se priver de la culture pédagogique, c’est tenter de recréer soi-même ce que l’humanité a construit sur plusieurs millénaires ; s’y appuyer, c’est se donner les moyens de poursuivre le travail et faciliter les apprentissages des enfants ou des jeunes avec qui l’on travaille.
La chance que nous avons depuis un peu plus d’une dizaine d’années, est que nous voyons arriver de nouvelles données pouvant contribuer, à leur tour, à l’étayage des pratiques pédagogiques. Je pense notamment aux apports de la psychologie cognitive et de la neuroscience. Ces disciplines rendent accessibles des informations non disponibles sans les outils scientifiques modernes, en particulier concernant le fonctionnement du cerveau. Or, quoi de plus important pour un enseignant que d’être au clair avec cette organisation biologique ? Nous touchons même ici un domaine de formation qui pourrait devenir souverain par rapport à tous les autres champs puisque c’est à partir de lui que tout le reste devient possible.
Dans quelle mesure ce qu’on sait maintenant du fonctionnement cérébral conforte les pédagogies coopératives ?
Les réponses à cette question ne sont pas encore toutes fournies, non pas en raison d’un déficit de recherches, mais plutôt parce qu’elles ne sont pas encore toutes parvenues à s’accorder. Toutefois, il est possible de dégager quelques « invariants » qui, parce qu’ils ne s’y attachent pas spécifiquement, ne valident pas les pédagogies coopératives mais entrent en cohérence avec le projet éducatif qu’ils véhiculent. En voici quelques-uns :
– Le cerveau est le produit de l’utilisation qu’on en fait. Plus les enfants font des expériences diversifiées, plus leur cerveau s’enrichit d’empreintes qui pourront être développées plus tard. En même temps, deux choses à mobilisations similaires apprises l’une après l’autre se neutralisent, ce qui interroge le rythme traditionnel de l’enchaînement des cours. Les pédagogies coopératives développent des approches qui tendent à prendre en compte les rythmes d’apprentissage des élèves, notamment par l’usage des plans de travail qui fournissent à chacun des activités qu’ils peuvent conduire de manière autonome. Une autre piste concerne les situations de coopération reconnues comme permettant une forte mobilisation intellectuelle, d’ailleurs plus dense chez le tuteur.
 – L’activité cérébrale se réduit de 50% sur des sujets subissant des situations de stress. Sur une longue période, on remarque une modification structurelle dans le cerveau : le système de récompense du corps ne fonctionne plus correctement. Le stress est donc un facteur qui nuit à la longue au cerveau. Miser sur l’ambiance, sur l’espace et le temps peut donc générer un très haut rendement, l’enseignant ayant d’abord à construire un environnement respectueux. La classe coopérative dispose d’un certain nombre d’institutions visant à écouter les conflits afin d’épurer les tensions, non dans une optique de pacification, mais de permission à la concentration, pour mieux permettre la rencontre aux savoirs.
– L’activité cérébrale se réduit de 50% sur des sujets subissant des situations de stress. Sur une longue période, on remarque une modification structurelle dans le cerveau : le système de récompense du corps ne fonctionne plus correctement. Le stress est donc un facteur qui nuit à la longue au cerveau. Miser sur l’ambiance, sur l’espace et le temps peut donc générer un très haut rendement, l’enseignant ayant d’abord à construire un environnement respectueux. La classe coopérative dispose d’un certain nombre d’institutions visant à écouter les conflits afin d’épurer les tensions, non dans une optique de pacification, mais de permission à la concentration, pour mieux permettre la rencontre aux savoirs.
– Les écoles gagnent à être des lieux riches, qui éveillent à la curiosité du monde, nourrissent l’intérêt des enfants et stimulent leurs dispositions à l’effort. La forme la plus appropriée semble être le travail libre dans le silence, période de grande concentration. Les pédagogies coopératives permettent ces espaces de travail libre, liberté déterminée moins dans la nature des connaissances à acquérir que dans la forme du travail à engager. Les enfants ont la possibilité de choisir la plupart de leurs modalités d’actions : s’ils vont travailler seuls ou avec d’autres, avec ou sans l’enseignant, à partir d’outils informatiques, de fiches ou de manuels, … Ce travail libre ne se conçoit pas dans un environnement pauvre en ressources et sollicitations. C’est pour cela qu’un des enjeux de réussite est l’enrichissement de la classe, afin que la posture de retrait de l’enseignant ne rime pas avec un amoindrissement des apprentissages scolaires.
– Les performances d’apprentissage ont été mesurées lors d’un cours libre et lors d’un cours frontal. Les résultats sont étonnants, aucune différence n’a été relevée. Pourtant, les élèves qui ont profité du cours frontal ne sont pas les mêmes que ceux qui ont profité du cours libre. Certains profitent davantage d’un système que de l’autre et inversement. Une des richesses de la classe coopérative est qu’elle permet toutes latitudes en matière de formes d’action. C’est en quelque sorte l’espace privilégié de la pédagogie différenciée. Tout y est matériellement envisageable, ce qui laisse aux élèves le choix des approches et donc de celle qui leur correspond le mieux.
Les « méthodes actives » sont très connues. Est-ce la même chose que les pédagogies coopératives ?
Qui dit méthode active ne dit pas nécessairement pédagogie coopérative.
D’abord parce qu’on n’aborde pas une méthode valable pour un enseignement précis. Il s’agit plutôt d’un espace organisé et enrichi de telle manière que les élèves soient au minimum en situation d’ennui et d’inactivité. Il est très difficile de prévoir ce qu’ils vont en faire, tant le principe est de s’appuyer sur le caractère complexe et aléatoire du vivant.
Ensuite parce que ce qui demeure au centre de ces approches est la permission quasi permanente de travailler à plusieurs, de demander de l’aide ou de la proposer. Les pédagogies actives, bien que développant la plupart du temps de l’interaction entre l’enfant et son milieu, se contentent de cette activité pour accroître la portée pédagogique du projet. Les pédagogies coopératives développent en plus l’idée que c’est en enseignant que l’on apprend le mieux, en grande partie parce qu’on est alors en position de mobilisation de ses propres connaissances. S’engage alors le processus d’adaptation à un contexte de transfert, ce qui ancre davantage la connaissance (ou la compétence), et qui a notamment pour impact d’en renforcer le caractère durable.
En plus de permettre aux élèves d’agir, les pédagogies coopératives les invitent à faire acte d’enseignement.
L’ouvrage est très concret avec de nombreuses fiches et des documents de travail. D’où viennent tous ces outils ?
La plupart des outils proposés par ce livre sont issus d’autres ouvrages principalement écrits par des praticiens de mouvements pédagogiques tels que l’ICEM et son chantier Outils, l’OCCE, les associations de Pédagogie Institutionnelle, le réseau Marelle. Quelques outils proviennent de pays étrangers, je pense ici au message clair importé des travaux de Danielle Jasmin au Québec. Une partie de mon projet était de rassembler dans un même volume tout ce qui nous avait été proposé dans une foule d’autres.
Ces outils ont ensuite fait l’objet d’une adaptation dans divers contextes d’enseignement, pour beaucoup en Zone d’Education Prioritaire. Les échanges entre enseignants « coopérateurs » auxquels j’ai pu participer ont été l’occasion d’en travailler la pertinence, tant du point de vue de la mise en place que de celui de l’éthique d’usage qu’il convenait de développer.
Peut-on dire des pédagogies coopératives qu’elles sont efficaces ?
Voici un nouveau champ qui m’intéresse fortement de travailler. Peu de recherches ont creusé l’impact des pédagogies coopératives sur les apprentissages. On a pu mettre en avant dans cet ouvrage plusieurs études qui valorisent la référence à la coopération, on aurait pu également aborder les travaux de l’équipe Théodile sur le suivi de l’école Freinet de Mons-en-Barœul et ceux de la DEP sur l’impact des classes multi-âges sur les résultats aux évaluations nationales. En particulier, il serait passionnant de s’intéresser de manière scientifique au devenir des élèves une fois entrés au collège, tant au sujet de leur adaptation à de nouvelles formes e travail que du point de vue des acquisitions scolaires.
 Les données en notre possession sont avant tout empiriques. D’un côté, elles montrent des élèves motivés par l’école, y prenant la plupart du temps un plaisir évident, travaillant autour de projets favorisant une forte exposition aux savoirs et, somme toute, fournissant des produits d’évaluations plutôt satisfaisant au regard de ce que l’école attend en terme d’acquisitions. D’un autre, elles témoignent de passages au collège plutôt sereins, sans de réelles difficultés d’adaptation au système ou de niveau scolaire.
Les données en notre possession sont avant tout empiriques. D’un côté, elles montrent des élèves motivés par l’école, y prenant la plupart du temps un plaisir évident, travaillant autour de projets favorisant une forte exposition aux savoirs et, somme toute, fournissant des produits d’évaluations plutôt satisfaisant au regard de ce que l’école attend en terme d’acquisitions. D’un autre, elles témoignent de passages au collège plutôt sereins, sans de réelles difficultés d’adaptation au système ou de niveau scolaire.
Mais disons de suite que le contraire serait étonnant ! Au sein d’une classe coopérative, nous rencontrons des élèves qui évoluent dans un espace organisé et cohérent, respectant leurs profils individuels, favorisant un traitement non-violent des conflits, permettant d’optimiser au mieux le temps scolaire, le tout dans un milieu qui les charge en sollicitations intellectuelles et culturelles.
Oui mais il y a la question de l’individualisation. N’est ce pas en contradiction avec des démarches coopératives ?
J’ai envie de dire que l’individualisation serait une partie des pédagogies coopératives. Travailler seul, à partir de travaux qui correspondent à notre profil, est une des opportunités de la classe coopérative. Heureusement, il y en a beaucoup d’autres ! Je n’ai rien contre les programmes d’enseignement par ordinateur, mais à usage exclusif, ils privent leurs utilisateurs d’une des caractéristiques de l’être humain : l’interrelation. En plus de ne pas apprendre seul, on gagne à apprendre à plusieurs.
C’est certainement pour tout cela que l’on parle plutôt de personnalisation des apprentissages : on y trouve tout autant qu’avec l’individualisation ce souci de prendre en compte les caractéristiques de chaque enfant, mais on permet en même temps un fonctionnement systémique au sein de la classe. C’est justement la multiplicité des opportunités offertes aux élèves qui va leur permettre :
– d’abord d’en trouver une qui correspondra mieux que les autres,
– ensuite d’effectuer des transferts entre ce qui a été construit une première fois et les situations nouvelles qui se présentent,
– enfin de rendre la classe vivante, pas uniquement orientée vers la quête des intérêts individuels mais aussi vers le souci du collectif et des bénéfices à vivre à plusieurs.
Quel avenir donnez-vous à ces pédagogies ?
On pourrait aussi se demander quelles raisons en ont empêché un avènement plus précoce !
Je pense que les pédagogies coopératives ont de l’avenir, si l’on souhaite faire de l’école une véritable institution d’équité sociale.
Dans un premier temps parce qu’il est indéniable que si davantage d’élèves d’une classe sont en situation d’activité et que ce travail est en grande partie coloré de plaisir de faire et de réussir, alors les acquisitions en seront améliorées. Pour ne prendre que l’exemple très médiatisé de l’apprentissage de la lecture, nous sommes très loin des 15% d’élèves qui quittent les classes coopératives sans s’être rendus autonomes dans la lecture de textes inconnus.
Dans un deuxième temps, parce qu’elles garantissent à tous les élèves, pas seulement une catégorie, de bénéficier des avantages de la coopération. Que l’on soit considéré comme « au niveau », au-dessus de ce niveau ou en-dessous, la structure de la classe coopérative permet à chacun d’effectuer un travail qui lui correspond, sans être freiné par le rythme des autres.
Dans un troisième temps, parce qu’elles ne nécessitent pas une formation professionnelle plus intense, ne demandent pas un investissement plus important. En revanche, il convient sans aucun doute de l’orienter davantage vers de l’analyse de pratiques, l’organisation d’une structure de classe à partir de laquelle les élèves pourront évoluer, la maîtrise d’outils pédagogiques précis, et le développement des convictions qui attribuent à chaque enseignant, à chaque éducateur, un réel impact et une réelle responsabilité dans le projet pédagogique qu’ils font vivre.
C’est en résumé ce que cet ouvrage tente de véhiculer.
 Sylvain Connac
Sylvain Connac
S Connac, Apprendre avec les pédagogies coopératives, ESF, 2009.
Entretien : François Jarraud
Le Café pédagogique a demandé à Sylvain Connac de prolonger son ouvrage en ouvrant, sur le site du Café, un blog qui puisse faire lien avec les lecteurs. Nous y attendons vos questions et vos réactions. Mais aussi vos expériences, vos suggestions, vos projets.
http://cafepedagogique.net/communautes/cooperation/default.aspx
Comment naissent les inégalités d’apprentissage ?
 De tous les livres qui nous nourrissent, ceux qui doivent nous être les plus chers sont ceux qui nous bousculent. Et l’ouvrage d’Elisabeth Bautier et de Patrick Rayou sur « Les inégalités d’apprentissage » est de ceux-là. Ecoutons-les. « Il n’est évidemment pas de notre propos ici de porter un jugement négatif sur les conduites de classe des enseignants… Il apparaît cependant que les évolutions en cours qui remanient assez profondément les contenus curriculaires, en particulier par l’affaiblissement des savoirs disciplinaires au profit de la valorisation des démarches de construction des savoirs, des compétences cognitives et langagières complexes, conduisent les enseignants à mettre en place des dispositifs d’apprentissage plus opaques, moins maitrisables pour eux-mêmes ».
De tous les livres qui nous nourrissent, ceux qui doivent nous être les plus chers sont ceux qui nous bousculent. Et l’ouvrage d’Elisabeth Bautier et de Patrick Rayou sur « Les inégalités d’apprentissage » est de ceux-là. Ecoutons-les. « Il n’est évidemment pas de notre propos ici de porter un jugement négatif sur les conduites de classe des enseignants… Il apparaît cependant que les évolutions en cours qui remanient assez profondément les contenus curriculaires, en particulier par l’affaiblissement des savoirs disciplinaires au profit de la valorisation des démarches de construction des savoirs, des compétences cognitives et langagières complexes, conduisent les enseignants à mettre en place des dispositifs d’apprentissage plus opaques, moins maitrisables pour eux-mêmes ».
E Bautier et P Rayou donnent quelques exemples de cours où le débat l’emporte sur les savoirs, où « les élèves font et apprennent peu ». Ils mettent en évidence dans ces exemples l’importance des « malentendus » qui naissent de pratiques mal maîtrisées, « le travail interprétatif de l’élève qui risque de lui masquer les significations à construire… La notion de malentendu socio-cognitif permet de considérer les difficultés et différences d’apprentissage comme des constructions conjointes de l’enseignant et de l’élève… Interviennent dans cette interprétation les habitudes langagières, cognitives et relationnelles des élèves mais aussi la façon dont l’élève comprend son métier d’élève, ce que signifie pour lui travailler à l’école ».
L’ouvrage se garde bien de vanter le retour à un enseignement explicite dont on a vu dans le passé les effets sociaux dévastateurs. Mais il souligne que les malentendus frappent les enfants des milieux sociaux les plus éloignés de la culture scolaire, c’est-à-dire défavorisés. Pour eux, « l’introduction sans étayages particuliers de modèles d’éducation centrés sur l’élève, voire sur l’enfant, est très pénalisante pour ceux qui manquent des informations et des prérequis nécessaires à la prise en charge de soi, de ses études, de ses apprentissages ». Ce qu’ils mettent en question c’est la formation des enseignants, qui s’intéresse peu aux apprentissages, leur isolement ensuite qui pousse à la constitution de « vulgates » pédagogiques qui entretiennent les malentendus. Leurs travaux s’appuient sur ceux de S Bonnery dont nous avons déjà rendu compte.
Assistons-nous à l’enterrement du constructivisme ? L’avertissement ne vaut pas condamnation. Par ces apports, qui nous invitent à prendre davantage la posture de l’observateur en classe, à penser aux pré-requis, aux étapes intermédiaires, E Bautier et P Rayou nous font heureusement réfléchir. Il reste que leur ouvrage, qui n’est pas d’un abord facile, manque d’exemples. Il nous semble aussi que, dans le secondaire, le modèle dominant est encore le cours magistral frontal et non l’excès d’activités. Il y a aussi une limite que les auteurs ne devraient pas franchir. Si la recherche de la motivation et du jeu ne sont pas suffisants à la transmission des connaissances, la recherche de l’ennui n’est pas efficace ! E Bautier et P Rayou se gardent bien de nous donner des solutions et de vanter un modèle éducatif. Ils critiquent les dysfonctionnements d’un modèle qui est sans doute moins installé qu’ils le croient. Et ce faisant ils lui rendent service.
Elisabeth Bautier, Patrick Rayou, Les inégalités d’apprentissage, Puf, Paris, 2009, 172 p.
Bautier : Dépister les malentendus
Rayou : le travail de l’élève doit être au coeur
Bonnery : Comprendre l’échec scolaire
|
Sur le site du Café
|