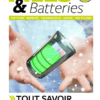Le contrôle de Stanislas : des témoignages d’homophobie dans les PV de l’Inspection Générale
« Vous êtes la mieux placée pour nous éclairer » dit Paul Vannier en s’adressant à Caroline Pascal, Dgesco, ancienne cheffe des Inspecteurs Généraux. La commission veut sonder les critères qui déclenchent une inspection académique ou générale. Le co-rapporteur Paul Vannier énumère une série de témoignages de propos homophobes présents dans les procès-verbaux du rapport de l’Inspection générale de la part de plusieurs personnels. Il souligne et s’étonne que la seule citation d’élève du rapport « blanchisse l’institution » des différentes violences pourtant présentes dans les PV. La Dgesco, Caroline Pascal explique la méthode collégiale des Inspecteurs généraux : à la vue « de l’ensemble, les Inspecteurs Généraux n’avaient pas considéré qu’il montrait la une caractéristique d’homophobie caractérisée ». Après avoir dit « nous n’avons extrait aucun témoignage qui permettait de dire que l’établissement avait un comportement homophobe », elle parle de quatre ou cinq témoignages d’homophobie. Mais pour elle, « ces mentions n’ont pas été considérées comme la trace d’une homophobie institutionnelle de l’établissement » mais « le signe de ce climat genré condamné dans le rapport ».

« Est-ce qu’il existe un pilotage ou des modalités de pilotage » des violences commises par un personnel de l’Education nationale demande la co-rapporteure Violette Spillebout (Renaissance) avec insistance lors de l’audition ? Suit un court silence, puis une réponse, il y a un renvoi aux responsabilités individuelles, celle du chef d’établissement, le signalement les faits établissements dont environ 20% sont transmis au ministère, ensuite suivis.
En 2023-2024, 1198 faits de violences commises par des adultes sur des élèves ont été signalés dans les établissements publics. Parmi ces faits, 24% concernent des violences sexuelles, tandis que les autres se répartissent à égalité entre violences physiques et verbales. Christophe Peyrel, chef du service de défense et de sécurité, a admis ne pas être en mesure de fournir des informations sur le suivi judiciaire ou administratif de ces signalements. L’État ne centralise pas ces données, ce qui rend impossibles une remontée et une centralisation des informations nécessaires à leur traitement. L’application « faits établissements » et « l’organisation du ministère ne permet[ent] pas aujourd’hui d’assurer un tel suivi » a-t-il concédé.
Des sanctions disciplinaires dans l’enseignement public
L’audition a révélé une absence de centralisation des données concernant les mesures compensatoires prises par les autorités académiques. « Nous n’avons pas d’élément chiffrés sur les mesures compensatoires prises par les autorités académiques » répond à une question un chef de service, « les seuls éléments statistiques concernent les sanctions disciplinaires quand elles ont été prises » précise-t-il. Entre 2021 et 2023, 146 sanctions pour « incorrection, violence et insulte » et 31 pour « violences sexuelles et sexistes » ont été prononcées dans le premier degré. Dans le second degré, ces chiffres sont respectivement de 172 et 131. En 2023, 9 personnels du premier degré et 37 du second degré ont été radiés.
Des limites de ces données
Cependant les données récoltées ne permettent pas de distinguer si les victimes sont des élèves ou des personnels. Il y a là, même dans les établissements publics, un angle mort ou un impensé sur le suivi des signalements et donc de la protection des enfants. Entre 2021 à 2023, les services du ministère comptent des sanctions disciplinaires de différents types pour des faits commis contre élèves et d’autres personnels. Dans le premier degré, entre 2021 et 2023, il y 146 sanctions de type « incorrection, violence et insulte », 31 de « violences sexuelles et sexistes » et « mœurs ». Dans le second degré, 172 sanctions pour « incorrections, violence, insulte » et 131 pour violences sexistes et sexuelles. En 2023, 9 personnels du 1er degré et 37 du Second degré dans l’enseignement publics ont été radiés. Une enquête pour recenser les procédures disciplinaires est en cours dans l’enseignement privé sous contrat, car la gestion des cas est entièrement déconcentrée.
« Environ 10% des cas ont une traduction disciplinaire » relève le co-rapporteur Paul Vannier (LFI). Qu’en est-il des suites judiciaires ? A force d’acharnement de la commission, le chef de service admet l’absence de protocolisation : « Ce que je me dois de vous dire, cette fluidité entre les Parquets et l’Institution au niveau national ou académique de fluidité n’est pas systématique ».
Réparties entre les compétences des académies, des recteurs, des Parquets, des référents dans les services académiques, « il n’y a pas de recensement centralisé de l’ensemble des signalements » dira-t-il.
Un décret à venir « Faits établissements » pour les lycées privés sous contrat
L’audition a mis en lumière l’absence de contrôle de l’État dans les établissements privés catholiques sous contrat. Un décret, prévu pour être publié dans un ou deux mois, imposera la déclaration des « faits établissements » dans ces établissements. Au nom du principe de la liberté d’organisation, l’application n’avait été jusque-là que proposée et non imposée. La co-rapporteure Violette Spillebout (Renaissance) souligne aussi les limites de ce progrès qui « accélère un processus qui était en préparation depuis longtemps, pour utiliser un logiciel de signalement qui existe dans le public et de l’étendre dans le privé […] en revanche, on se rend compte que les modalités de pilotage au niveau régional, national ne sont pas abouties ».

« Nous sommes au début de ces procédures de contrôles, et potentiellement de sanction » a déclaré Marine Camiade, la Directrice des Affaires Financières. Les contrôles des établissements privés sous contrat sont inégaux. Le député Paul Vannier (LFI) souligne qu’un seul contrôle a été effectué sur 1132 ces six dernières années dans l’académie de Nantes, tandis que tous les établissements de l’académie de Martinique ont été contrôlés en 2023 ou encore que les deux lycées qui ont subi un retrait de contrat sont les lycées musulmans. Dans une réponse, le DAJ confirme que la décision de rupture du contrat d’association relève d’une décision du préfet. Une gradation est possible, rappelle la DAF : procédure disciplinaire, mise en demeure.
Un dialogue avec le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique (SGEC) : une pratique sans cadre juridique
Lors de l’audition, il a été question du « dialogue », du lien plus approfondi entretenu par le Ministère avec le réseau catholique qui représente 96% des établissements sous contrat. Guillaume Odinet, le directeur aux affaires juridiques précise : « Ce dialogue n’amène à aucun moment l’Etat à partager sa compétence ou l’exercice de sa compétence avec le Secrétariat général de l’enseignement catholique ». La « laïcité, n’empêche pas de dialoguer » dira-t-il. Ni de contrôler ?
Djéhanne Gani
* Mme Caroline Pascal, directrice générale de l’enseignement scolaire (Dgesco), M. Jean Hubac, chef du service de l’accompagnement des politiques éducatives, M. Boris Melmoux-Eude, directeur général des ressources humaines (DGRH), M. Laurent Belleguic, sous-directeur des personnels enseignants, d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale, Mme Marine Camiade, directrice des affaires financières (DAF), M. Lionel Leycuras, sous-directeur de l’enseignement privé, M. Guillaume Odinet, directeur des affaires juridiques (DAJ), Mme Marie Noémie Privet, sous-directrice des affaires juridiques de l’enseignement scolaire, de la jeunesse et des sports, M. Christophe Peyrel, chef du service de défense et de sécurité, et Mme Adeline Joffre, adjointe au chef du service
Dans Le Café pédagogique
Bétharram : « On m’a demandé de me taire ». Cette professeure raconte
L’après Bétharram : la parole se libère
Bétharram : du silence ministériel au pas de vague institutionnel
Bétharram : les députés Vannier et Spillebout saisissent le procureur