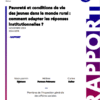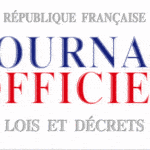Connaissez-vous Mazamet « la capitale » du massif de la montagne noire dans le Tarn ? Cette ville a longtemps vécu de l’industrie du délainage et de la mégisserie (tannage des peaux pour la production de cuir textile). « C’est une ville qui est relativement excentrée dans l’académie de Toulouse. Elle est frontalière avec l’académie de Montpellier, même si l’Occitanie est commune maintenant aux deux académies. C’est aussi un bassin structurel qui a été dédié à la tannerie et au cuir, mais qui s’est complètement écroulé dans les années 80-90. Il reste d’ailleurs des vestiges d’une époque florissante où l’on voit encore dans la ville des grandes maisons de propriétaires très luxueuses qui sont complètement abandonnées et des entrepôts qui paraissent délaissés. Il y a toute une industrie dont il reste la trace. Mais on est quand même dans un lycée qui a un des plus faibles IPS de l’académie. » explique Armel Briend, professeur d’Arts appliqués au lycée Marie-Antoinette Riess de Mazamet. Dans cet établissement réside l’unique filière maroquinerie de l’Académie. Et si le CAP maroquinerie existe depuis 1966, la filière a bien failli disparaître si elle n’avait pas été réinvestie par une équipe de trois enseignantes toutes venues du monde professionnel de la maroquinerie.
Après un BTS modélisme industriel à Nîmes puis une licence en habillement Aude Miélet, la plus ancienne de l’équipe a été modéliste gradueuse pour des sociétés privées. Après avoir passé le CAPLP Génie industriel textiles et cuir, elle a commencé à enseigner à Nice. « Là, on était cinq collègues et on a remonté une filière mode et vêtements qui était un peu à l’abandon, Un peu comme cela a été le cas à Mazamet pour la maroquinerie ». De retour en métropole, après un poste en Outre-Mer, Aude Miélet a participé à un groupe de travail académique et a décidé d’une reconversion dans la filière maroquinerie. « Mais le projet, ce n’était pas que de changer de discipline. Avec l’inspectrice de l’époque, on avait fait un état des lieux et c’était catastrophique. Il n’y avait quasiment plus d’élèves en maroquinerie. En parallèle, la filière mode vêtements à Mazamet allait peut-être fermer. Tout le monde a fait en sorte qu’elle ne ferme pas, mais elle a quand même fermé. Et ça allait être le cas pour la filière maroquinerie, parce que malgré que ce soit l’unique formation dans l’académie, il n’y avait quasiment plus d’élèves. Il y avait trois classes, mais il y avait une vingtaine d’élèves en bac pro. Du coup, pendant ma reconversion, j’ai appris le métier parce que ce n’est pas la même matière, ce ne sont pas les mêmes outils. C’est un peu similaire au niveau de tout ce qui est conception, logiciel, etc. Mais c’est quand même très différent. Il y a pas mal de compétences transversales. Par conséquent, j’ai fait beaucoup de stages en entreprise et j’ai rencontré Ingrid. Elle a quitté l’entreprise et elle a démarré en tant qu’enseignante sur le remplacement d’une collègue contractuelle ».
Ingrid Albert est d’ailleurs une ancienne élève du BEP puis du bac pro métiers du cuir du lycée de Mazamet. Elle a ensuite obtenu un BTS métiers de la mode, chaussure et maroquinerie. Avant l’obtention de son BTS elle était déjà employée en CDD dans une entreprise de Mazamet pour laquelle elle travaillait l’été. Son contrat s’est ensuite transformé en CDI. « Professionnellement, j’avais envie d’évoluer, d’avoir d’autres objectifs aussi. Et je me suis très bien entendue avec Aude. J’ai commencé par effectuer des remplacements au lycée. Il y avait un besoin sur le CAP Maroquinerie parce que les professionnels avaient du mal à recruter. On a donc ouvert le CAP maroquinerie en alternance pour un peu plus cibler le public adulte en reconversion » explique Ingrid Albert.
Le CAP maroquinerie
Aude poursuit : « On s’est donc retrouvées toutes les deux à gérer le bac pro et à tout rénover, c’est-à-dire à revoir tous les produits, les dossiers techniques, les supports pédagogiques. C’est un peu une époque compliquée parce qu’il y avait la fermeture de la filière mode vêtements.On se met à la place des collègues : c’est difficile de subir une fermeture de filière. On s’est donc retrouvées avec des ateliers à vider, à déménager, à trier, On peut dire que nous n’avons pas chômé cette année-là. On a trié tout le cuir. C’était une filière qui était un peu à l’abandon depuis une quinzaine d’années, voire plus, dans le sens où dans le stock, rien n’était à jour, ni compté, ni trié. Les cours étaient des photocopies de photocopies de cours tapés à la machine à écrire. C’était vraiment très poussiéreux, très vieillot. Il y avait tout à refaire. Donc, on a retroussé nos manches et puis on s’est mises au travail. Et ça s’est très bien passé parce qu’on a, l’année d’après, eu des groupes complets sur chaque niveau de classe. Sur le CAP les entreprises ont suivi et ont embauché en apprentissage. Il n’y en a pas beaucoup, mais il y avait eu un ou deux contrats d’apprentissage sur les terminales Bac Pro. C’est prestigieux de démarrer avec des entreprises qui sous-traitent pour des grandes marques françaises de Luxe. Et donc, ça a fait un peu effet boule de neige. La filière à Mazamet s’est fait beaucoup connaître ».
Clotilde Gimalac les a rejointes il y a 3 ans lors de l’ouverture de la FCIL. Elle aussi est titulaire d’un bac pro métiers de la mode maroquinerie du lycée de Mazamet puis d’un BTS métier de la mode chaussures et maroquinerie. Elle a ensuite travaillé pour un atelier sous-traitant de marques prestigieuses. « J’ai eu la chance de travailler dans une équipe qui faisait les lancements des modèles dans l’entreprise. Ça a été très enrichissant parce que j’ai pu apprendre tous les savoir-faire de chaque maison. Ensuite, je me suis lancée un an à mon compte pendant lequel je me suis occupée de tout ce qui était achat, conception, gestion des points de vente. Ensuite, mon ancienne professeure du lycée de Mazamet m’a contactée pour me proposer de devenir professeure ». Plus récemment arrivé, Christophe Maison enseigne depuis dix ans dans le secteur de la maroquinerie.
Deux sur quatre se trouvent sur des postes à profils spécifiques, Ingrid est stagiaire cette année et Christophe est détaché. Ils enseignent aujourd’hui aux 6 classes qui s’étendent du CAP au BTS. Les préparations de cours sont mutualisées et partagées sur un drive commun qui comprend aussi « tout ce qui est administratif, tout ce qui est lié à la filière et au développement du plateau technique. On a tout en commun. Comme ça, dès qu’on fait des petites corrections, tout le monde en profite et on est permutable sur chaque niveau de classe à tout moment. On maîtrise tous les niveaux de formation. Si jamais il y en a un ou une qui est malade ou qui a une formation, ça permet aussi aux élèves de boucler les cours et de pouvoir tenir correctement les progressions » explique Aude.
Pour elle, il était important d’avoir les trois niveaux de formations. « Avec un CAP, on travaille sur la production. À l’issue des bacs pro, on travaille sur la production et on a quelques compétences en développement de modèles, mais ça ne permet pas de faire le travail de prototype. Avec un BTS, on est censé être, au moins pendant les cinq premières années, assistant prototypiste avant de pouvoir être prototypiste ». Pour Armel, un.e ouvrièr.e en maroquinerie « a une dimension incroyable de compétences qu’il faut maîtriser, sans une reconnaissance suffisante au niveau salarial. En fait là, on est sur des métiers d’art et d’artisanat. Il y a une vraie connaissance pratique et technique qui est assez incroyable pour une rémunération ultra faible par les industries du luxe ». Aude confirme « qu’en confection industrielle, on démarre au SMIC. Même si c’est un métier, les ouvrier.es sont artisan.es à la production. Mais c’est très industriel, c’est l’usine, je ne sais pas pourquoi on utilise ce mot d’artisan, parce que non ! C’est du travail à la chaîne, même s’il y a de la polyvalence qui arrive sur les lignes de production. Pour moi le terme d’artisan c’est plus une personne qui travaille seule à son compte ».
Un changement de paradigme pour la maroquinerie
Pendant longtemps, la maroquinerie, et plus généralement les métiers de la mode, ont été sous la tutelle de l’inspection des arts appliqués. Aujourd’hui, la filière est supervisée par l’inspection des sciences et techniques industrielles . « Ce qui n’est pas rien au niveau idéologique. Cela signifie aussi que la dimension de conception n’est plus au cœur de la formation. On est vraiment centré sur la dimension de production. Cela montre quand même une logique nouvelle dans la relation à ces métiers. Cette bascule, s’est faite très récemment vers 2020. C’est très récent. Et c’est quand même dans l’accompagnement des réformes actuelles. Il faut avoir en tête que c’est un changement de paradigme quand même » commente Armel. « D’ailleurs, le référentiel du CAP a été complètement refait. Une épreuve dans laquelle il y avait une partie en art appliqué, a disparu. Le bac pro, va bientôt être rénové. Il l’a été récemment pour les métiers de la conception et de la couture. Tout le côté artistique, qu’il y avait sur l’épreuve de projet U33, qui a aussi un bac pro mode vêtement, a disparu. Donc on est vraiment sur de la confection industrielle » complète Aude.
Armel qui a enseigné dans un autre lycée professionnel découvre l’épreuve de bac intitulée le 120 heures. : « durant cette épreuve, les élèves doivent réaliser une pièce de maroquinerie. Il y a une amorce d’art appliqué de 10 heures, qui montre le maintien d’une légère enveloppe de conception au départ. Mais du coup, ça veut dire que là, on est vraiment sur une épreuve qui s’inscrit dans le temps, ce qui est très riche pour nos élèves mais qui est aux antipodes des conseils pédagogiques qui nous sont parfois prodigués. Ce qui prouve que le développement d’une activité dans des temporalités longues est possible au LP ».
Liens avec les industriels de la région
Au-delà d’avoir remonté une filière qui périclitait, l’équipe s’investit auprès des industriels de la région. « Il y a deux ans, nous avons fait des formations pour une entreprise qui est à proximité du lycée. Nous avons formé 2 groupes de 12 employé.es aux bases de la maroquinerie. Nous nous sommes formées sur une référence d’un modèle. Puis nous avons préparé les futurs employé.es à être prêt.es à intervenir directement sur la vraie production. Nous avons aussi monté une FCIL dont nous avons rédigé les référentiels car la région manquait de prototypistes. Dans les entreprises du bassin, beaucoup partaient à la retraite ou travaillaient en heure supplémentaire. Donc il y avait un besoin de ce côté-là. Nous avons eu un petit groupe. Nous avons demandé une dotation à la Région pour de nouvelles machines à coudre puisqu’on avait quand même un plateau technique très vieillot de ce côté-là ».
Aujourd’hui le plateau technique a été en partie réaménagé et rénové. C’est un open space de 850 m2 à l’intérieur desquels il y a plusieurs plateaux techniques de travail. Pour Ingrid, c’est l’un des plus beaux de France, qui comprend même la seule découpeuse numérique pour le cuir de l’ Académie. Il permet de recevoir 4 groupes de travail en même temps. Malheureusement le temps manque à l’équipe pour assurer toutes les demandes de formation des professionnels avec qui l’équipe a tissé un solide réseau. Armel explique que lors de sa reconversion, Aude a fait des stages dans le bassin de Mazamet mais aussi dans celui de Graulhet « deux bassins importants dans l’histoire du cuir dans le Tarn. Elle s’est alors aperçue que les professionnels du coin ne se connaissaient tout simplement pas. Et au fur et à mesure des réunions, des jurys d’examens et des rencontres, le contact s’est établi entre eux ». Aude confirme avoir fait se rencontrer beaucoup de professionnels : « Aujourd’hui, nous sommes invités dans l’association Graulhet le cuir et dans beaucoup d’autres endroits. Nous continuons à faire du lien ».
Une évolution
Pour Ingrid ce manque de lien s’explique aussi par le fait que : « La maroquinerie, c’est un métier un peu méconnu, toujours resté en cachette. Les fabricants se sont toujours cachés pour fabriquer, pour cacher ce savoir-faire qui est non partagé, qui est transmis qu’entre petits cercles, etc. Mais on peut voir que depuis ces deux dernières années, le métier devient bien plus connu en France. D’ailleurs, il y a d’autres formations qui ont ouvert. Et chez les professionnels, il y a des grandes améliorations. Comme par exemple, l’utilisation des colles chimiques, qui sont délaissées pour celles à base d’eau. Il y a un changement, une évolution. Et comme c’était un peu archaïque dans tous les sens, il va falloir quelques années, je pense, avant de refaire évoluer tout ça ». Pour Armel, « la question initiale est celle du cuir et de la tannerie, qui ne sont pas un domaine très écologique par nature. Il y avait aussi quelque chose qui devait être un peu tu dans le contexte actuel. C’est bien d’abord la question animale qui est derrière, la question du traitement des déchets, c’est-à-dire de la peau. Les choses changent puisqu’il y a des déchets qui sont valorisés aujourd’hui et qui ne l’étaient pas avant comme les peaux de poissons par exemple. J’ai l’impression que c’est en train de bouger progressivement ».
Pour Clotilde : « il faut compter que le cuir, ça vient d’un être vivant. Avant d’arriver à la matière cuir, les maroquiniers ont énormément conscience du travail nécessaire dans la phase de tannage, et des heures et des heures qu’il y a pour faire le cuir. Donc l’idée du upcycling est inhérente au métier ». Ingrid précise que « le terme d’upcycling, désigne la revalorisation des matériaux qui sont laissés en stock dormant dans les maroquineries. Ces matériaux n’étaient pas revalorisés jusqu’à ce que les écoles et les entreprises s’y intéressent. Les sociétés viennent maintenant racheter directement les stocks dormants, dans les entreprises. Cela revalorise cette matière-là ».
Aude confirme qu’« il y a eu pas mal de choses de faites dans l’industrie de transformation des peaux en cuir. Il y a même des stations d’épuration en interne dans les tanneries et les mégisseries. Il y a eu un gros travail de fait en amont. Cela fait 5 ans que la maroquinerie a vraiment le vent en poupe et que les ateliers se réorganisent. Ils revoient un peu leur fonctionnement, leur méthode culturelle de transmission des savoir-faire en interne et garde leurs traces écrites. Parce qu’avant, on montrait, on expliquait, et les gens passaient toute une carrière derrière leur établi. Du coup, il faut trouver des solutions qui se mettent à la page. C’est pour cela que nous avons aussi notre rôle à jouer pour aider les entreprises à se développer et à monter en compétence. Il était important d’avoir les trois niveaux de formation au lycée afin d’aider certaines entreprises à passer le cap de l’informatique, de la découpe numérique et de tout ce qui est communication avec des dossiers techniques normalisés. Nous formons les élèves à ces compétences et nous espérons que leur recrutement dans les entreprises fera effet dans les années à venir. Nous sommes enseignantes pour la formation, pour le savoir-faire au niveau national et au-delà, et surtout pour accompagner nos élèves du mieux que nous pouvons pour l’obtention de leur diplôme et leur insertions professionnelle. Cela fait partie des objectifs, il faut le dire ».
Caroline Renson
Pour prolonger la visite :
Lien France 3 de visite des ateliers du lycée
Présentation de la filière par les élèves