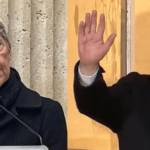Dans cette chronique, l’historien Claude Lelièvre revient sur le sujet cher aux libéraux et à la droite de la désectorisation. Il en souligne les enjeux, et notamment celui de la liberté des plus privilégiés au détriment des autres.
Dans cette chronique, l’historien Claude Lelièvre revient sur le sujet cher aux libéraux et à la droite de la désectorisation. Il en souligne les enjeux, et notamment celui de la liberté des plus privilégiés au détriment des autres.
Il y a tout juste soixante ans, la circulaire du 5 janvier 1965 organise les « districts » du second cycle de l’enseignement secondaire à la suite de celle du 3 mars 1963 qui avait défini les « secteurs » du premier cycle.
Service public de l’intérêt général national vs service public du public
Une circulaire en date du 11 février 1965 met en évidence que « l’objectif majeur de la réforme de l’enseignement est que les élèves de toutes les classes de troisième soient dirigés vers les types d’établissements et de sections conformes à leurs aptitudes […]. Toutefois la création de cette structure nouvelle n’a pas seulement pour but d’assurer la satisfaction légitime de préférences individuelles justifiées : elle doit aussi préparer l’avenir par la mise en place progressive d’une répartition des adolescents conforme à un équilibre souhaitable entre les différents types d’enseignement de second cycle, en se fondant sur les travaux préparatoires accomplis par les commissions du V° Plan ».
L’Éducation nationale « gaullienne » est fondée sur le principe du service public (de l’«intérêt général », national) qui n’est pas confondu avec le service du public (de l’intérêt de chacun, pris isolément). Elle est dans la filiation directe de la problématique déjà avancée sous Guizot durant les années 1830 (l’« éducation nationale » comme «service public») doit-il l’emporter sur le « principe commercial » cher aux libéraux (le « consumérisme scolaire », entendu comme « service du public »).
Vision libérale, un marché libre de l’enseignement pour de consommateurs d’école
Cela est particulièrement net si on met en regard une prise de position très forte contre la « sectorisation », celle d’Alain Madelin, formulée très clairement dès 1984 dans son essai Pour libérer l’école. En bon libéral, Alain Madelin considère qu’il faut sortir de la logique de l’offre pour laisser s’imposer la logique des consommateurs : « L’éducation de l’avenir est une éducation dirigée d’en bas, par la demande. Or la demande suppose le choix, la liberté, la concurrence, la pluralité de choix » (p.100). Concrètement, il propose de développer une politique de « l’allocation scolaire » qui consisterait à distribuer un fonds de ressources à chaque utilisateur : « Seule l’introduction de l’allocation scolaire, dans le système éducatif, peut permettre l’émergence d’un véritable ‘consumérisme scolaire’ grâce à la traduction immédiate sur le ‘marché libre de l’enseignement’ des besoins, des attentes et des demandes des ‘consommateurs d’école’ » (p.169). Signe des temps (de notre temps ?), Alain Madelin est réapparu récemment sur certains « plateaux-télé ».
De la « liberté »
La « Plateforme pour gouverner ensemble », qui réunit les candidats de l’UDF et du RPR en vue des législatives du printemps 1986, met en bonne place la réalisation d’« une école de la liberté » : « la liberté pour chaque parent de choisir l’école de ses enfants implique que soient progressivement modifiées les dispositions, notamment en matière de désectorisation, qui font actuellement obstacle à une réelle pluralité et à une réelle diversité des établissements d’enseignement ».
Les élections sont favorables à la droite. Le nouveau Premier ministre, Jacques Chirac, indique dès le 24 avril 1986 au congrès de la Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public ( PEEP ) que « la liberté » sera assurée par des mesures prises « très vite » pour permettre « le choix de l’école au sein même du secteur public ».
Mais le ministre de l’Éducation nationale dans le nouveau gouvernement dirigé par Jacques Chirac, René Monory, est foncièrement un pragmatique, et un élu local très bon connaisseur des réalités urbaines et rurales. Il se méfie en l’occurrence des solutions de principe qui occultent parfois des difficultés réelles d’application. René Monory entend donc « se hâter lentement, et avec circonspection ». Concrètement, la désectorisation n’est pas imposée aux départements ruraux, qui n’y sont pas pour la plupart favorables. Dans les zones urbaines, on évite de permettre des mouvements trop prononcés, en excluant le plus souvent possible les établissements les plus demandés des zones de « libre choix ». Enfin, une grande prudence est de mise à Paris : seuls quatre secteurs situés dans les arrondissements périphériques (12è, 14è, 18è et 20è arrondissements) sont concernés.
Désectorisation, le choix de Bayrou
Bis repetita quelques années plus tard. A l’approche des élections législatives du printemps 1993, le principe de la désectorisation est réaffirmé publiquement par les partis de droite. Le programme « Union pour la France » qui rassemble les candidats de l’UDF et du RPR indique qu’il convient d’ « assurer le libre choix des parents dans le cadre d’une évaluation transparente. Les parents doivent pouvoir choisir l’école de leurs enfants ».
Les élections sont gagnées par la droite, et François Bayrou devient ministre de l’Éducation nationale dans le gouvernement Balladur. Il considère sans doute, à l’instar de René Monory en 1986, qu’il est urgent d’attendre en matière de désectorisation. C’est en tout cas ce qui ressort de son intervention du 2 mai 1993 : « L’extension de la liberté de choix, par les familles, de l’établissement scolaire de leurs enfants est une idée juste. Cela doit permettre d’offrir à tout le monde les avantages jusqu’ici réservés aux plus favorisés, à ceux qui ont des relations ou les moyens de bâtir une stratégie de réussite pour leurs enfants. C’est inacceptable démocratiquement et c’est pourquoi la plate-forme de gouvernement de la majorité s’engageait à élargir la liberté des parents. Mais ce n’est pas une question urgente et elle ne sera pas mise à l’ordre du jour pour la rentrée prochaine. Là encore, il convient de mener des expériences et de voir ensuite comment on peut faire évoluer le système ».
Désectorisation
A l’inverse, Alain Madelin continue son combat de toujours. Lorsque, le 2 avril 2001, Alain Madelin lance sa campagne en vue des présidentielles, le premier de ses six engagements pour « le choix de la nouvelle France » est de « libérer l’école et supprimer la carte scolaire ». Le document du colloque organisé en septembre 1999 par le parti d’Alain Madelin, Démocratie libérale, montrait déjà clairement quelle était l’ambition retenue : « donner davantage d’autonomie aux établissements, davantage de liberté et de responsabilité aux acteurs du système éducatif, rendre aux parents la liberté de choisir l’école de leurs enfants : on ne propose pas une énième réforme du système éducatif, comme ce fut la tentation au cours des dernières années, mais une méthode de changement pour une révolution tranquille ».
Alors, la « sectorisation » ou la « désectorisation » ? La « réforme » de l’Education nationale ou la « révolution » (tranquille) libérale ? Où en est-on ? Où va-t-on ?
Claude Lelièvre