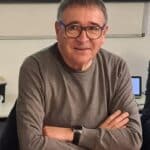Nedjib Sidi Moussa est historien, docteur en sciences politiques. Il est aussi enseignant contractuel. Dans son livre « Le remplaçant », il décrit la réalité d’un professeur contractuel, précaire, exerçant en banlieue. Il décrit sa réalité. Un livre qui, selon Laurence De Cock qui nous en rend compte, « nous rappelle la nécessaire acceptation de nos fragilités, de nos échecs, de notre impuissance mais aussi de notre utilité sociale ». « Le remplaçant est un manifeste pour la modestie professionnelle et un appel au sursaut de celles et ceux qui détournent le regard, s’installent dans le déni, mobilisent le métier à des fins de rentabilité personnelle en épousant les logiques de la néolibéralisation de l’école ».

Prof {précaire} en banlieue
De cette expérience, il fait un livre : Le remplaçant, journal d’un prof {précaire} de banlieue, L’échappée. On ne compte plus tous les livres qui, à chaque rentrée, nous font connaître à coups de gros tapage médiatique l’expérience miraculeuse de telle institutrice, les déboires d’un prof infiltré, l’analyse faussement distante d’une professeure qui a tenu chez les petits sauvages. Bref, le grand déballage d’egos qui peuplent les plateaux des chaînes d’information continue avant de disparaître dans les limbes de l’oubli.
Mais Nedjib Sidi Moussa n’est pas de ceux et celles-là. Parce qu’il dit quelque-chose de l’école, de ses dysfonctionnements comme de ce qui la fait tenir, et qu’il le dit bien.
On lit Le remplaçant comme si on avait mis la main sur un carnet intime tombé d’une poche dans le métro. C’est d’abord un journal qui consigne jour par jour les étapes d’une année scolaire jalonnée par la découverte du monde du collège, par les vacations acceptées à l’université pour maintenir l’impression d’avoir encore quelque-chose à y faire, et par les quelques écrits de recherche qu’il faut aussi honorer pour garder la tête haute. C’est un journal qui dit ceci : j’écris pour tenir. Quand il met sa casquette (plutôt son chapeau) de remplaçant, Nedjib Sidi Moussa est pour ses collégiennes et collégiens un prof normal : celui qu’on n’écoute pas toujours, qu’on essaie de rendre fou, mais qui sait répondre à toutes les questions ; celui qui gronde, félicite, se sait trop laxiste mais n’arrive pas à punir ; mais Nedjib Sidi Moussa est aussi un prof différent parce qu’ils ont vu sur Google qu’il écrivait des livres mais aussi parce que son nom évoque spontanément, pour ses élèves de banlieues, une proximité culturelle – même si lui met un point d’honneur à ne rien dévoiler de sa vie ou de son histoire privée.
En revanche, pour ses collègues titulaires, Nedjib Sidi Moussa n’est jamais un prof normal. « Vous êtes le nouveau prof de techno ? », lui demande un collègue. Quand d’autres ne le saluent même pas. La possibilité d’un dialogue n’existe que chez celles et ceux qui sont dans la même situation que lui ou dont le patronyme révèle une origine partagée. Parmi les affronts, on retiendra le jour de la dictée du Brevet que Nedjib Sidi Moussa s’amuse à faire et ce professeur de français qui, après coup, lui demande s’il peut la regarder pour s’étonner de l’absence de fautes ….
Nedjib Sidi Moussa travaille sept jours sur sept. Il ne dort presque pas, passant ses nuits sous Redbull pour réussir cumuler toutes ses activités. Debout à l’aube. Métros, collège, métros encore, université, studio. Il touche 2000 euros par mois. Et Il ne sait pas si ni où il sera affecté l’année suivante. Il aimerait enseigner en lycée. Mais, au rectorat, on pratique l’entretien collectif d’embauche, c’est-à-dire une séance de signatures de contrats pour obéir dans l’urgence aux injonctions ministérielles de ne pas laisser de classes sans élèves. Une dame qui ne doit pas non plus trop se sentir à sa place le regarde avec un demi-sourire et lui promet qu’elle va regarder ce qu’elle peut faire. Ce qu’elle n’a sans doute jamais fait.
Nedjib Sidid Moussa est une petite main de l’Éducation nationale. Cela ne lui fera pas injure de le dire, à lui qui milite pour la révolution internationale des travailleuses et travailleurs. Il est l’un d’eux. C’est dur, rugueux, injuste, souvent révoltant mais les mots qu’il tire de cette expérience en font aussi une activité pleine de dignité.
Enseigner, rester soi, résister
Devant ses étudiants il est parfois tellement fatigué qu’il perd ses mots, s’embrouille dans ses notes. Le lendemain, face aux collégiens, il sermonne, slalome entre les questions d’élèves souvent très éloignées de l’objet du cours. Tantôt le prof est attendri, parfois désespéré, irrité, à bout … Nedjib Sidi Moussa revisite sa vie à l’aune de ses métiers. Comment étais-je enfant ? Quels étaient mes rêves ? Pourquoi mes étudiants ne sont-ils pas en colère comme je pouvais l’être ?
Ce faisant, il donne à voir une dimension souvent tue du métier : son effet-miroir, c’est-à-dire comment ce métier renvoie à notre propre trajectoire, rejoue nos angoisses, nous bouscule intimement. Nedjib Sidi Moussa est fils d’une famille algérienne de Messalistes, c’est-à-dire de militants indépendantistes en conflit avec le FLN, violemment réprimés et désormais occultés de la mémoire officielle du nationalisme algérien. Il se sent dépositaire de cette illégitimité, de cette histoire de fantômes encore interdite en Algérie. C’est cet héritage qu’il charrie lorsqu’il se heurte aux militants antiracistes qu’il trouve trop manichéens, trop obsédés par la « race » – quand il revendique d’abord son appartenance de « classe ». C’est ce même héritage encore qu’il charrie dans le monde universitaire si frileux face au militantisme, installé dans son ronronnement petit bourgeois. C’est tout cet héritage enfin qu’il charrie lorsqu’il enseigne, se désole que les enfants d’origine maghrébine l’interrogent sur sa religion tandis qu’il les rêve en génération révoltée. Nedjib Sidi Moussa n’est à sa place nulle part et c’est cet inconfort qui nourrit son journal et touche juste.
Cet inconfort ne nous définit-il pas toutes et tous qui tentons de résister dans une institution maltraitée et maltraitante ? En un sens, ce livre nous rappelle la nécessaire acceptation de nos fragilités, de nos échecs, de notre impuissance mais aussi de notre utilité sociale. Le remplaçant est un manifeste pour la modestie professionnelle et un appel au sursaut de celles et ceux qui détournent le regard, s’installent dans le déni, mobilisent le métier à des fins de rentabilité personnelle en épousant les logiques de la néolibéralisation de l’école. Ce journal d’un prof {précaire} de banlieue est donc davantage qu’une réflexion intime sur un métier socialement méprisé ou l’expression d’un désenchantement : il dépose une expérience singulière pour rappeler que la réponse ne pourra être que collective.
Laurence De Cock