" Ce qui m’intéresse, c’est l’histoire de l’éducation « par le bas », à travers le travail des maîtres dans les classes". Dans son dernier livre, « L’école et l’écriture obligatoire », Anne-Marie Chartier, enseignante-chercheuse et maîtresse de conférences au service d’Histoire de l’éducation de l’INRP, analyse l’évolution de la place de l’écriture dans notre société et les enjeux qui en découlent. Un livre qui vient compléter un premier volet, « l’école et l’écriture obligatoire ».
Ce livre paraît à la suite de « L’école et la lecture obligatoire », de quoi s’agit-il ?
 Dans les deux cas, j’ai essayé de résoudre des énigmes qui ne souciaient que moi. S’agissant de la lecture, je n’arrivais pas à me figurer ce qu’avait pu être la capacité à « lire seulement ». D’après les historiens, ce savoir lire sans savoir écrire avait duré au moins deux siècles partout en Europe. Pour certains psychologues avec qui j’en avais parlé, « lire seulement », c’était au mieux réciter par cœur, une pseudo alphabétisation. Lors de mes recherches, j’ai découvert que c’était un peu comme déchiffrer et relire des partitions quand on n’est pas capable de lire la musique à vue. C’est moins bien que lire couramment la musique, mais c’est bien plus que mémoriser des mélodies seulement à l’oreille.
Dans les deux cas, j’ai essayé de résoudre des énigmes qui ne souciaient que moi. S’agissant de la lecture, je n’arrivais pas à me figurer ce qu’avait pu être la capacité à « lire seulement ». D’après les historiens, ce savoir lire sans savoir écrire avait duré au moins deux siècles partout en Europe. Pour certains psychologues avec qui j’en avais parlé, « lire seulement », c’était au mieux réciter par cœur, une pseudo alphabétisation. Lors de mes recherches, j’ai découvert que c’était un peu comme déchiffrer et relire des partitions quand on n’est pas capable de lire la musique à vue. C’est moins bien que lire couramment la musique, mais c’est bien plus que mémoriser des mélodies seulement à l’oreille.
La deuxième énigme était de comprendre pourquoi ce « lire seulement » avait disparu en une génération, au temps de Jules Ferry, semblait-il. C’est l’arrivée du papier bon marché et des plumes métalliques à partir de 1850-60 qui met peu à peu fin à cette situation. Les enfants peuvent alors tenir une plume vers cinq-six ans et apprendre en même temps à lire et écrire, chose impossible au temps de la plume d’oie. L’accélération est alors spectaculaire et les républicains imputent ce progrès aux lois d’obligation.
Enfin, je me suis demandé pourquoi les débats sur les méthodes de lecture tenaient si peu compte des interactions entre lecture et écriture. Pourquoi tant de recherches contemporaines ne concernaient-elles que l’apprentissage de la lecture ? D’où ce deuxième livre sur L’école et l’écriture obligatoire.
Quel est l’intérêt d’étudier l’évolution de l’écriture ?
Nous sommes en train de vivre une révolution du fait des nouvelles technologies numérisées. Comment cela va-t-il impacter l’école et les modes d’apprentissage ? Remonter dans l’histoire de la scolarisation de l’écriture permettait de voir comment d’autres innovations avaient produit des effets inattendus et comment les maîtres et maîtresses y avaient fait face. Ce qui m’intéresse, c’est l’histoire de l’éducation « par le bas », à travers le travail des maîtres dans les classes et non pas « par le haut » à la lecture des directives des ministres et des programmes imposés. Ces innovations technologiques concernent toute la société, les ministres n’y sont pour rien, mais comment l’école se les approprie-t-elle ? C’est ce qui m’intéresse dans les évolutions en cours. Le confinement dû à la pandémie a en quelque sorte constitué une situation expérimentale à grande échelle : que se passe-t-il quand les maîtres se trouvent réduits à communiquer à distance avec leurs élèves, par vidéos et écrits interposés ? Est-ce que l’écriture gagne ou perd face à l’image et au son ?
Votre recherche est très riche, sur quels matériaux s’appuie-t-elle ?
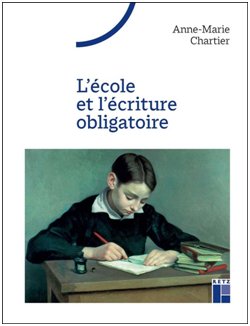 Pour répondre à mes questions, je devais réunir, à côté des directives officielles compilées par André Chervel dans « L’enseignement du français à l’école primaire », trois sortes de sources : descriptions de la situation matérielle des classes, témoignages de maîtres ou d’anciens élèves – des biographies autant que des romans et les traces laissées dans les cahiers d’élèves – j’en ai consulté plusieurs centaines. Évidemment, je n’ai pu constituer un échantillonnage statistique, car ces sources sont disparates, ponctuelles, de plus en plus rares quand on remonte dans le temps. Mais j’espère avoir trouvé de quoi documenter suffisamment une histoire « matérielle » de l’enseignement de l’écriture.
Pour répondre à mes questions, je devais réunir, à côté des directives officielles compilées par André Chervel dans « L’enseignement du français à l’école primaire », trois sortes de sources : descriptions de la situation matérielle des classes, témoignages de maîtres ou d’anciens élèves – des biographies autant que des romans et les traces laissées dans les cahiers d’élèves – j’en ai consulté plusieurs centaines. Évidemment, je n’ai pu constituer un échantillonnage statistique, car ces sources sont disparates, ponctuelles, de plus en plus rares quand on remonte dans le temps. Mais j’espère avoir trouvé de quoi documenter suffisamment une histoire « matérielle » de l’enseignement de l’écriture.
Apprendre à écrire, finalement qu’est-ce que cela signifie ? Quels enjeux dans l’acte d’écrire ?
J’ai découvert trois choses. D’abord que jusqu’à la Renaissance, les débutants apprenaient « seulement » à écrire – tracer des lettres et des mots, copier des phrases et des textes, puis traduire et composer, et que c’est en apprenant à écrire qu’ils apprenaient à lire. Ce savoir était réservé aux futurs clercs voués au latin et, dès le 14e siècle, aux marchands qui apprenaient le calcul écrit pour tenir des comptes en langue vernaculaire. Ensuite, que l’invention de Gutenberg a permis d’imaginer une alphabétisation de masse sur des textes imprimés, bien plus faciles à lire que l’écriture manuscrite, et c’est pourquoi ont été séparées d’une part la lecture de l’imprimé, d’où le « lire seulement », et d’autre part la lecture et l’écriture des manuscrits. Enfin, que pour apprendre à écrire en langue française, les maîtres avaient dû rompre avec les belles calligraphies des maîtres-écrivains pour inventer une pédagogie des écritures usuelles, nécessaires aux élèves privilégiés des collèges, mais aussi à la minorité des enfants du peuple qui devaient savoir calculer et lire ou copier les « papiers » de la vie sociale.
L’écrit est un marqueur social, et il semble que cela ne soit pas nouveau à la lecture de votre livre. Quelle est donc la finalité de l’écriture ?
Les finalités sont très marquées par des usages sociaux différents chez les élites et le peuple. Le grand basculement s’opère au cours du 19e siècle, quand les autorités issues des élites imposent aux écoles du peuple la culture scripturaire du secondaire. En un siècle, toutes les écritures socialement nécessaires auxquels tenaient les parents, comme la lecture- écriture des « papiers » – promesses de vente, testaments, baux, contrats, livres de comptes…, disparaissent peu à peu de l’école primaire au profit des exercices de grammaire, des dictées et des rédactions. Il ne reste que les problèmes longtemps référés aux calculs commerciaux et aux mesures agraires. Les maîtres n’apprendront pas le latin et les classiques, mais ils feront écrire et réciter l’histoire de France, La Fontaine et Victor Hugo. Alors que dans l’espace économique et social, les entreprises adoptent vers 1870 la sténographie, les machine à écrire et à calculer, les autorités scolaires s’efforcent d’adapter leur culture secondaire à l’école primaire. L’école de Jules Ferry est une « école libérale » qui promeut une culture gratuite, supposée réunir le peuple et les élites sous l’égide des mêmes valeurs morales, laïques, nationales et citoyennes, en rejetant à l’extérieur de l’école tous les savoirs nécessaires au monde du travail. Le dernier coup est porté dans les années 1970 quand la secondarisation obligatoire fait disparaître les problèmes au profit des maths modernes.
Qu’est-ce que cela nous dit de l’école ?
Tout le monde sait que les savoirs acquis à l’école se vérifient par écrit. Dans tous les examens, mais aussi dans les exercices et les devoirs. C’est donc à travers les savoirs d’écriture que se fait la réussite ou l’échec scolaire. Or, les disciplines d’écriture se trouvent en concurrence, certaines demandant la maîtrise d’écritures formelles comme les maths et les sciences, d’autres des écritures en « langue naturelle », telles que les sciences sociales, le français… On sait qu’elles ne pèsent pas le même poids dans les orientations scolaires. Cependant, dans la représentation commune, les professeurs de lettres semblent toujours ceux qui « apprennent à écrire » aux collégiens et lycéens, alors que toutes les matières sont concernées. C’est aussi vrai pour les évaluations nationales ou internationales qui testent des compétences à lire et écrire « hors littérature », c’est-à-dire à comprendre et raisonner sur des textes – documents informatifs ou narratifs – pour extraire et traiter des informations. Pour traiter de l’écriture dans l’école, il faut donc prendre en considérations ces multiples protocoles d’écriture qui relèvent de toutes les disciplines.
Propos recueillis par Lilia Ben Hamouda
Anne Marie Chartier, L’école et l’écriture obligatoire, Reyz éditeur, ISBN : 978-2-7256-3665-8, 25€.











