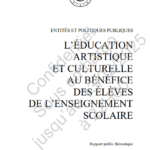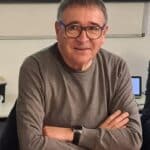Pour changer l’Ecole faut-il arrêter de légiférer et réglementer ? Spécialiste de l’enseignement de l’EPS en milieu difficile, Jacques Méard, professeur à la Haute école pédagogique de Lausanne, ose cette affirmation. « La rénovation passe davantage par une valorisation et une attention portée à ce qui se fait qu’à une volonté d’édicter des principes présentés comme novateurs et de les généraliser ». Nous poursuivons cette semaine l’entretien débuté la semaine dernière avec lui. Ses propositions amènent à réfléchir de façon très concrète à la façon dont l’élève peut attribuer du « sens » à ses apprentissages : le rôle de l’enseignant est déterminant !
D’après vous, l’EPS a-t-elle un rôle particulier dans l’éducation en milieu difficile ?
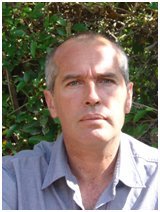 Du côté des élèves, l’EPS est une discipline qui a un atout considérable. D’une part, elle permet de construire, comme toutes les autres matières, des savoirs qui permettent de comprendre le monde, de se développer comme personne et comme citoyen cultivé, de poursuivre des objectifs à long terme, d’expérimenter et de mesurer les effets d’un travail, les effets de véritables apprentissages (quoi qu’en pensent les non spécialistes, les techniques corporelles, le règlement du rugby et les principes pour gérer sa vie physique sont des savoirs nobles) ; d’autre part, l’EPS est proche de la « vie » en ce sens qu’elle immerge l’enfant et l’adolescent dans des situations de plaisir intense, de sueur, de conflit avec d’autres, d’échanges et de projets partagés. Ces deux caractéristiques autorisent des expériences d’apprentissages véritables à des jeunes qui supportent mal les heures et les semaines où l’on doit rester assis face au tableau à écouter un enseignant parler. Ils sont confrontés aux questions d’acquisition mais aussi aux problèmes de sécurité pour soi et pour les autres, aux débats, aux regards des autres. Donc, l’EPS est le lieu privilégié pour apprendre des savoirs savants, techniques, des codes sociaux, des normes, une « culture inscrite dans le corps ».
Du côté des élèves, l’EPS est une discipline qui a un atout considérable. D’une part, elle permet de construire, comme toutes les autres matières, des savoirs qui permettent de comprendre le monde, de se développer comme personne et comme citoyen cultivé, de poursuivre des objectifs à long terme, d’expérimenter et de mesurer les effets d’un travail, les effets de véritables apprentissages (quoi qu’en pensent les non spécialistes, les techniques corporelles, le règlement du rugby et les principes pour gérer sa vie physique sont des savoirs nobles) ; d’autre part, l’EPS est proche de la « vie » en ce sens qu’elle immerge l’enfant et l’adolescent dans des situations de plaisir intense, de sueur, de conflit avec d’autres, d’échanges et de projets partagés. Ces deux caractéristiques autorisent des expériences d’apprentissages véritables à des jeunes qui supportent mal les heures et les semaines où l’on doit rester assis face au tableau à écouter un enseignant parler. Ils sont confrontés aux questions d’acquisition mais aussi aux problèmes de sécurité pour soi et pour les autres, aux débats, aux regards des autres. Donc, l’EPS est le lieu privilégié pour apprendre des savoirs savants, techniques, des codes sociaux, des normes, une « culture inscrite dans le corps ».
Du côté des enseignants, le fait que, dans cette discipline, ils partagent des lieux de travail et un matériel communs, le fait aussi qu’ils travaillent souvent « devant les collègues » (et non derrière la cloison de leur salle de classe), permettent de faire vivre un collectif de travail souvent plus dynamique que dans d’autres disciplines. Or ce « collectif de travail » est la condition pour éviter l’isolement, pour riposter dans des conditions de travail difficiles, pour exercer le travail en santé, face à des prescriptions institutionnelles et aussi parfois face à des « collectifs d’adolescents » qui « prennent la main » dans les transactions en classe.
Vos travaux récents ont-ils fait évoluer votre pensée ?
Nous avons prolongé ces travaux depuis cinq ans dans une équipe axée sur la prévention du décrochage scolaire. Sujet à la mode mais sujet néanmoins révélateur des problématiques que nous évoquons ici. Trois éléments ont complété nos travaux antérieurs. D’abord, il a été confirmé qu’aucun élève n’a envie d’apprendre tout le temps. Ce qui apparaît de façon indiscutable, c’est une volatilité des adhésions, des refus, des résistances, des enthousiasmes chez le jeune scolarisé. Au cours de la même leçon, un collégien peut vouloir progresser, retenir l’attention de l’enseignant, obtenir une bonne note, se reposer, plaisanter avec un copain, séduire telle autre, résoudre le problème posé par l’enseignant, se reposer, faire des efforts pour améliorer sa moyenne, briller en réalisant un exploit devant la classe. Cet enchevêtrement de motifs d’agir est même l’ordinaire du jeune scolarisé, surtout celui qui est à risque de décrochage. Des travaux récents (ceux de Jérôme Guérin, Olivier Vors et Nathalie Gal-Petitfaux, Jacques Saury) décrivent également cette multiplicité et cette indétermination des motifs qui tranchent avec la vision figée évoquée plus haut. Ces observations sont fondamentales car elles redonnent la main au professionnel qui, de toute évidence, peut y faire quelque chose.
Ce qui est apparu aussi dans ces derniers travaux concerne le fait que les élèves, dans les classes peu scolaires, sont souvent tiraillés entre les règles énoncées par l’enseignant et celles imposées par le collectif d’élèves. Par exemple, tel adolescent peut être intéressé, voire passionné par le travail scolaire à un moment donné. Mais il est absolument exclu qu’il manifeste cet intérêt, encore moins cet enthousiasme, sous peine de briser un tabou, d’être exclu du collectif. Idem pendant les moments de cours magistral dialogué où il peut être implicitement convenu que personne n’a le droit de participer aux échanges ni répondre spontanément aux questions posées, bref ne doit « jouer le jeu scolaire », sous peine de passer pour un « collabo ». Ce type de normes, repérées depuis longtemps en sociologie, agit à divers niveaux, vestimentaire, lexical, musical. Il existe donc ce qu’on pourrait appeler des « règles du métier d’élève » qui opèrent de façon continue et en concurrence avec celles énoncées par l’enseignant. C’est un facteur important de décrochage, essentiellement dans les classes où l’enseignant a du mal à faire adhérer les jeunes au travail et où, par choix ou par manque de professionnalisme, il n’installe pas de cadre consistant. Et ces règles du métier d’élève peuvent être dans certains cas très tyranniques, d’autant plus qu’elles sont difficiles à repérer et implicites, donc non négociables. L’élève à risque de décrochage est en quelque sorte coincé entre un système de règles scolaires énoncées et négociables et un autre système implicite et non négociable. Son activité est prise par un double impératif : participer aux apprentissages et ne rien exprimer de cette participation, avoir une coupe de cheveux acceptable par l’institution mais aussi par le collectif, travailler mais ne pas avoir de résultats excellents, etc.
Enfin, nos travaux récents pointent les liens entre les processus d’accrochage-décrochage du côté du jeune scolarisé et les processus d’accrochage-décrochage professionnel du côté de l’enseignant. Pour être simpliste, des élèves s’accrochent davantage avec un enseignant qui donne du sens, dont l’efficacité et la force des motifs emportent l’adhésion (et vice versa). C’est une évidence mais, là encore, le résultat saillant implique que l’acteur peut y faire quelque chose. Et les études menées permettent de décrypter l’intimité des processus de co-construction de sens. Au-delà des transactions négociées professeur-élèves que nous avions analysées précédemment, ce qui apparaît très clairement, ce sont les effets croisés du renforcement ou de la dégradation du sens de l’un et de l’autre.
Quel regard portez-vous sur les politiques scolaires menées actuellement qui concernent les milieux, les publics difficiles ?
Comme le montre Françoise Bruno, « les enseignants qui décrochent avec des élèves décrocheurs » sont ceux qui se retrouvent isolés face à la prescription. Rappelons-nous qu’il existe plus d’une vingtaine de textes officiels relatifs à la lutte contre le décrochage scolaire en France actuellement, prescriptions évidemment impossibles à suivre dans leur intégralité et avec lesquelles les équipes d’établissement composent. Or lorsque la réalité de cette « équipe » est virtuelle, lorsque les échanges sont rares entre collègues, lorsque la collaboration est inexistante, l’enseignant ne peut simplement pas répliquer. Autrement dit, quand à la vivacité et à la consistance des collectifs d’élèves dont je parlais plus haut ne fait pas écho un fort collectif d’adultes, l’enseignant est démuni, exposé seul en classe à des résistances et des handicaps insurmontables. Pour ces raisons, il y a un vrai problème de santé au travail chez la plupart de ces collègues. Et il faut dire que le microcosme de l’EPS échappe en grande partie heureusement à ce phénomène du fait de sa tradition corporative. Certains enseignants d’EPS sont isolés mais moins, me semble-t-il, que dans d’autres disciplines où l’on ferme la porte de sa classe en même temps qu’on jette le voile sur ses difficultés, sur son sentiment d’impuissance.
La multiplication des textes officiels participe donc d’après moi de la difficulté. Et l’on aurait envie de dire au législateur : arrêtez de prescrire, arrêtez de réformer. Laissez les travailleurs travailler car c’est dans le terrain que se trouvent les germes de l’école de demain et non dans des réorientations successives ou des réformettes dont la principale fonction semble être de mentionner les noms des Ministres qui les ont portées.
Votre jugement n’est-il pas caricatural ? Il faut bien rénover le système éducatif ?
En effet, mais à mon avis, cette rénovation passe davantage par une valorisation et une attention portée à ce qui se fait qu’à une volonté d’édicter des principes présentés comme novateurs et de les généraliser. Quand on se penche sur le travail effectif réalisé dans les établissements, en EPS et ailleurs, on est frappé d’une part des efforts, de l’inventivité des équipes, du pouvoir de réplique des enseignants, d’autre part des freins que représentent les directives répétées, des réformes incessantes qui désorganisent plus qu’elles n’apportent des ressources. Ma conviction et mon agacement sont renforcés par un sentiment de grande injustice faite aux acteurs de l’école. Je voudrais dire de façon sincère : il n’y a pas de problème scolaire en France. En effet, les problèmes dont on parle sont sociaux et l’on fait de façon incessante un procès à l’école française, on la compare avec un système éducatif révolu, on la met en concurrence avec d’autres systèmes étrangers. Or ces comparaisons me semblent infondées car les difficultés ne sont pas celles de l’école mais celles des zones où ont été concentrés les handicaps : la misère et son lot de réflexes identitaires et de tensions, l’immigration dense qui empêche l’intégration, la déconsidération, le spectacle continu d’inégalités croissantes, … Dans ce contexte, confronté aux contraintes liées à l’accueil de tous et à l’inclusion en classe ordinaire d’élèves autrefois relégués dans des filières particulières, l’enseignant en zone urbaine ou péri-urbaine déclassée, en tant qu’agent du service public, est « au guichet ». Plus que d’autres peut-être, c’est lui qui prend en pleine face la pauvreté, les frustrations, les tensions interculturelles, les problèmes de santé, la délinquance. Sur ce point, je ne vais pas être à la mode, je ne vais pas hurler avec les loups : l’école française résiste et réagit plutôt bien dans ce contexte.
Bien sûr, on peut s’inquiéter des tendances à réviser les exigences à la baisse, avec des élèves qui n’ont pas reçu à la naissance « la panoplie du bon élève », pour reprendre une expression de Philippe Meirieu. On peut regretter que des enseignants aient tendance à privilégier les attentes en termes comportementaux à l’école (au détriment d’attentes cognitives), ne parviennent pas à modifier le « rapport scolaire au savoir » de ces élèves, au sens de Bernard Charlot, Elisabeth Bautier et Jean-Yves Rochex. On peut également être navré des malentendus issus d’un rapport trop utilitariste au savoir avec ces classes difficiles. Mais je ne fais pas partie de ceux qui jetteront la pierre à ces collègues. Reprocher de ne pas mettre « les savoirs au centre » et dire « ce qu’il faudrait faire » à ceux qui, au sortir de l’ESPE, se retrouvent avec des classes difficiles (parfois les plus difficiles de l’établissement) dans une zone sensible, c’est-à-dire où se concentrent les contradictions et les injustices, cela revient à déplacer les responsabilités, à oublier que 10 kilomètres plus loin, des municipalités refusent de construire des logements sociaux, c’est-à-dire refusent de prendre en charge une partie de la « misère du monde ».
Pour terminer cet entretien, vous aviez participé à la rédaction des programmes des Lycées de 1999 et de 2000. Nous ne pouvons pas nous quitter sans vous demander votre vision des programmes actuels et l’orientation vers laquelle les futurs devraient aller ?
Je n’ai pas d’avis tranché sur cette question. En fait, je suis assez partagé : d’une part, je considère comme tout le monde qu’il est nécessaire d’avoir un cadre de travail et que ce cadre doit évoluer ; d’autre part, après des années d’approche en ergonomie et en psychologie du travail, je sais que les programmes n’impactent pas tellement les pratiques d’enseignement (contrairement aux textes relatifs aux examens), sauf à très long terme, et que, par ailleurs, le « travailleur » ne fait jamais exactement ce qui est prescrit » (dans aucun métier). Là encore, il me semble qu’il ne faut pas multiplier les directives, donner trop de coups de pied dans l’organisation de travail pour que « ceux qui font le boulot » aient le temps de s’approprier les orientations, de les mettre à leur main, les négocient dans les équipes.
En 1999-2001, sous la direction de Gilles Klein, nous avons été soumis à des pressions, comme tous les rédacteurs de textes. Soumis aussi à des dilemmes entre proposer quelque chose d’innovant mais ne pas bousculer les collègues, fonder nos propositions sur des travaux de recherches mais rédiger un texte compréhensible. De plus, il ne faut pas perdre de vue que celui ou celle qui écrit des textes officiels dans le domaine de éducation ne dispose pas de modèles théoriques incontestables car fondamentalement, on ne sait toujours pas ce qu’est un savoir ni comment il se construit. Pour s’en convaincre, il suffit de porter le regard sur les débats très vifs à propos des compétences depuis 20 ans, débats qui ne sont pas clos.
Donc il existe sans doute les mêmes hésitations et les mêmes dilemmes chez les rédacteurs actuels de programmes en EPS. Par exemple, je ne suis pas du tout persuadé que les compétences soient constituées de connaissances, capacités et attitudes, comme le définissent les derniers textes et je regrette que cette nouvelle architecture ait remplacé la précédente. Mais c’est une formulation hybride qui deviendra peut-être à terme une ressource pour les enseignants (à la condition qu’un autre modèle théorico-institutionnel ne vienne pas de nouveau modifier les représentations). De même, je ne comprends pas pourquoi le « savoir-nager » prend une place si importante mais il n’est pas exclu que des pressions hiérarchiques aient dicté cette orientation (je ne le sais pas).
Pour conclure sur ce point, il me semble que les meilleurs programmes sont ceux qui sont capables de synthétiser et, en quelque sorte entériner, ce qui se fait déjà dans les établissements (le contre-exemple des IO de 1959 est éclairant de ce point de vue). C’est ce que nous avons essayé de faire il y a quinze ans en définissant les compétences selon 4 (puis 5) composantes motrices d’une part et 4 composantes méthodologiques d’autre part. Avec cette nouvelle architecture, nous avions tenté finalement d’opérationnaliser toute la dimension sociale et méthodologique dont j’ai parlé plus haut dans l’activité de l’élève, dimension qui auparavant apparaissait au niveau des finalités (l’autonomie, la responsabilité, la solidarité, …) mais plus du tout au niveau des compétences et de l’évaluation. Je suis heureux de constater que cette architecture s’est prolongée dans les programmes d’EPS depuis 15 ans et s’est généralisée en primaire et au collège (même si le découpage entre des compétences qui ne seraient que motrices et d’autres qui ne seraient que méthodologiques me semble très abstrait ; il est plus probable que, dans la même compétence, des dimensions sociales, méthodologiques et motrices indissociables soient requises, mais cette vision perdait peut-être en opérationnalité). On peut avancer que le groupe de travail réuni autour de Gilles Klein avait pointé, à cette époque, dans les activités d’enseignement et d’apprentissage sur le terrain, certains aspects du métier d’enseignant d’EPS et du « métier d’élève » qui étaient gommés jusque-là. Nous sommes parvenus à mettre des mots sur ce qui se faisait déjà dans les salles de sport (prendre en compte les dimensions sociales et méthodologiques des apprentissages en EPS). La discipline y a sans doute gagné, surtout dans les établissements où il y a beaucoup d’élèves peu scolaires.
Propos recueillis par Benoît Montégut