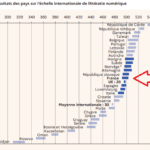Le courant d’idées prônant une « éducation basée sur la preuve » (« evidence-based education » en anglais) est né dans un contexte anglo-américain avec l’objectif d’aborder de manière plus rationnelle les problèmes éducatifs afin d’améliorer les politiques dans ce domaine. Ce courant a deux faces : une face « recherche » incarnée par des chercheurs qui pensent disposer d’une méthodologie scientifique permettant de dégager les pratiques pédagogiques efficaces, et une face « gestion de la politique éducative » incarnée par des décideurs politiques ou institutionnels qui pensent que les connaissances « basées sur la preuve » ainsi élaborées, doivent réorienter les politiques scolaires et les pratiques d’enseignement : programmes scolaires, outils didactiques utilisés dans les classes, etc.
 En France, le principal relais institutionnel de ce courant est l’association « Agir pour l’école », la branche de l’« Institut Montaigne » qui se préoccupe d’éducation. Créée en 2010, cette association compte parmi ses parrains Jean-Michel Blanquer, l’ancien directeur de l’enseignement scolaire (DGESCO) sous Chatel et durant les 5 premiers mois de Peillon, une figure de proue de la face « politique éducative » du courant. Elle est dirigée par Laurent Cros qui a été l’adjoint d’Alexandre Siné, le propre directeur de cabinet de Peillon à partir de décembre 2012, lorsque tous les deux étaient spécialistes des questions scolaires à Bercy sous Sarkozy. C’est dire l’influence prépondérante de ce courant, via cette association notamment, au sommet du ministère de l’Éducation nationale, même sous Peillon. D’où des conflits politiques au plus haut niveau, au point qu’un observateur avisé comme Emmanuel Davidenkoff a pu décrire une Éducation nationale « tétanisée en son sommet par des querelles de hauts fonctionnaires » (1). Cependant, au-delà des personnes, ces querelles sont bien des divergences d’orientations.
En France, le principal relais institutionnel de ce courant est l’association « Agir pour l’école », la branche de l’« Institut Montaigne » qui se préoccupe d’éducation. Créée en 2010, cette association compte parmi ses parrains Jean-Michel Blanquer, l’ancien directeur de l’enseignement scolaire (DGESCO) sous Chatel et durant les 5 premiers mois de Peillon, une figure de proue de la face « politique éducative » du courant. Elle est dirigée par Laurent Cros qui a été l’adjoint d’Alexandre Siné, le propre directeur de cabinet de Peillon à partir de décembre 2012, lorsque tous les deux étaient spécialistes des questions scolaires à Bercy sous Sarkozy. C’est dire l’influence prépondérante de ce courant, via cette association notamment, au sommet du ministère de l’Éducation nationale, même sous Peillon. D’où des conflits politiques au plus haut niveau, au point qu’un observateur avisé comme Emmanuel Davidenkoff a pu décrire une Éducation nationale « tétanisée en son sommet par des querelles de hauts fonctionnaires » (1). Cependant, au-delà des personnes, ces querelles sont bien des divergences d’orientations.
Le lobbying de cette association est donc à l’œuvre et elle cherche à peser de tout son poids sur l’élaboration des programmes pour l’école maternelle et élémentaire qui, comme on le sait, est engagée. Les chercheurs qui s’inscrivent dans ce courant, comme n’importe quels chercheurs, souhaitent voir leur travail influer sur la politique éducative de notre pays. Aussi prennent-ils de plus en plus souvent la parole de manière publique dans ce moment critique pour l’avenir de l’école.
C’est dans ce contexte qu’il faut apprécier l’interview de Stanislas Dehaene dans Le Monde du 20 décembre dernier, celle qui est qualifiée de « coup de gueule » sur le site moncerveaualecole.com. Le lancement de ce site, la réaction de Franck Ramus à l’analyse que j’en ai fait, ainsi que diverses interventions de Bruno Suchaut, doivent également être reliés à ce contexte.
Le but de cet article n’est évidemment pas de plaider en faveur d’une éducation qui ne serait pas fondée sur la preuve : bien sûr qu’il convient d’aller vers plus de raison dans les choix faits en matière d’éducation, qui pourrait penser autrement ? Son but est de montrer qu’il existe une autre façon de le faire, que cette autre façon correspond à une autre logique scientifique et sociale et qu’elle serait beaucoup plus efficace et respectueuse des enfants et des enseignants.
La démarche classique du courant « evidence-based education » : une prise en compte insuffisante de l’« état de la science »
La démarche classique des chercheurs s’inscrivant dans ce courant comporte deux étapes : 1°) La revue systématique des recherches concernant telle ou telle méthode ou intervention pédagogique ; cette étape vise à dégager les pratiques pédagogiques efficaces (what works) et 2°) une expérimentation pré-test, post-test avec deux groupes d’élèves formés de manière aléatoire, l’un, expérimental, recevant l’intervention dont il s’agit de prouver la supériorité, l’autre fonctionnant comme groupe-témoin.
Une analyse approfondie mais générale des points forts et faibles d’une telle démarche, quel que soit le contenu d’enseignement concerné, se trouve dans un excellent article de Frédéric Saussez et Claude Lessard publié en 2009 dans la Revue Française de Pédagogie (accès libre sur internet (2) ). Ici, nous examinerons ce que devient une telle démarche dans un cas précis, celui de l’apprentissage de la lecture tel que l’étudie et le recommande l’association « Agir pour l’école ». On sait en effet que dans ce cas, l’expérimentation pré-test et post-test correspond à un projet nommé « Lecture », partiellement financé par le fonds d’expérimentation pour la jeunesse, projet dont Viviane Bouysse et Gilles Pétreault (VB & GP), Inspecteurs Généraux, avaient fait une évaluation très sévère de la première année de fonctionnement (3) , et projet dont la note finale vient d’être publiée (4).
Cependant, intéressons-nous d’abord aux conclusions de la première étape, la revue systématique des recherches. Les conclusions auxquelles « Agir pour l’école » se réfère sont celles d’une institution états-unienne : le National Reading Panel (NRP). Elles conduisent à penser qu’il convient principalement d’avoir 3 types d’interventions pédagogiques avec les jeunes enfants dès la GS de maternelle : 1°) Il faut développer la conscience phonologique au niveau de la syllabe, de la rime et du phonème 2°) Il faut développer la connaissance des lettres et des phonèmes qui leur correspondent ainsi que la correspondance entre la juxtaposition des lettres et la fusion des phonèmes (principe alphabétique) et 3°) Il faut développer la compréhension de l’oral.
Comment le NRP en est-il arrivé à ces conclusions ? Pourquoi, par exemple, faudrait-il développer la conscience phonologique des enfants de GS au niveau du phonème ? Parce que, depuis les travaux de Stanovich dans les années 1980, de nombreuses expériences ont montré que la réussite à un test de conscience phonologique au niveau le plus fin, celui des phonèmes, est un bon prédicteur de la réussite en lecture.
Tout cela paraît relever d’une logique scientifique irréfutable. S’il y a une faille dans le raisonnement, où se situe-t-elle ? En fait, il faut considérer que l’ensemble des résultats utilisé par le NRP, ne renvoie qu’une vision partielle de ce qu’on appelle l’ « état de la science ». Ils constituent en effet ce qu’on peut appeler « les savoirs positifs issus de la recherche ». Or, en épistémologie, on considère généralement aujourd’hui que la connaissance scientifique nécessite aussi l’apport critique de « résultats négatifs » (cf. les travaux de Giuseppe Longo, par exemple), c’est-à-dire l’explicitation de ce que l’on ne sait pas. C’est en effet le seul moyen de prendre conscience des limites des théories avancées. D’où la question : qu’ignore-t-on concernant l’apprentissage de la lecture ?
Dans son ouvrage, « Les neurones de la lecture », Stanislas Dehaene insiste sur le fait que l’on ne sait pas répondre aux questions suivantes : faut-il d’abord que l’enfant analyse les sons en phonèmes, avant de pouvoir en apprendre le code écrit (ce qu’André Ouzoulias (5) appelle la conception classique de l’entrée dans l’écrit) ? Ou bien n’est-ce qu’à partir du moment où l’enfant comprend ce que sont les lettres qu’il parvient à décomposer la parole en phonèmes (dite conception « alternative ») ?
Chez l’adulte, en effet, il est évident que la connaissance de l’écrit a une influence sur la façon dont nous analysons l’oral. Un grand nombre de personnes, par exemple, pensent que PACSE s’analyse avec 5 phonèmes alors que TAXI s’analyserait avec 4 phonèmes seulement. En réalité, PACSE et TAXI s’analysent tous les deux avec 5 phonèmes, l’erreur provenant du fait que la lettre X, dans le cas de TAXI, correspond à 2 phonèmes. Cet exemple montre que, chez l’adulte, l’analyse fine de l’orale est sous la dépendance de la connaissance de l’écrit. Qu’en est-il chez le débutant ? Et s’il fallait attendre que les enfants aient une expérience de l’écrit suffisante pour qu’ils puissent enfin analyser l’oral finement (conception alternative) ?
L’incertitude dans laquelle nous sommes quant à trancher entre la conception classique et la conception alternative doit être considérée comme un « savoir critique » qui fait consensus : cette incertitude est écrite noir sur blanc aussi bien dans « Les neurones de la lecture » de Stanislas Dehaene que dans les ouvrages d’André Ouzoulias. Cette zone d’ombre des résultats de la recherche scientifique fait également partie de l’« état de la science ».
À l’origine du problème : les consonnes ne font que co-sonner !
Supposons par exemple qu’on veuille qu’un enfant apprenne à écrire BA sous la dictée (on notera la forme orale de cette syllabe /ba/). Pour apprécier ce qui est en jeu dans une telle tâche, le premier réflexe consiste évidemment à la décomposer en sous-tâches. L’enfant entend /ba/ et il doit :
1°) analyser la syllabe orale /ba/ en phonèmes : /b/ et /a/
2°) connaître la correspondance entre phonèmes et lettres pour écrire BA.
Les non-professionnels de l’enseignement imaginent rarement que la première sous-tâche puisse être difficile : il semble « de bon sens » que, bien avant d’avoir appris à lire et écrire, un enfant qui entend /ba/ est capable, comme nous le sommes, d’analyser ce son en 2 « petits sons ». Dans cette première sous-tâche, seul ce qu’on entend est en jeu et, a priori, on n’imagine pas pourquoi les enfants et les adultes n’entendraient pas à l’identique.
Or, ce n’est pas le cas et l’explication d’un tel phénomène est la suivante : le phonème /b/, n’est pas un son. Depuis qu’il y a près de 50 ans, les psychologues ont collaboré à la mise au point de machines qui synthétisent la parole, ils savent que les consonnes, notamment les occlusives, ne sonnent pas, qu’elles ne font que « co-sonner », c’est-à-dire modifier le son de la vocalique qui les suit (ou les précède). Lorsqu’on efface sur un enregistrement de /ba/ ce qui correspond à /a/, il ne reste qu’un grésillement indistinct de celui qu’on obtient en faisant la même manipulation avec /ta/, avec /pa/ ou avec /ka/). Alors que les phonèmes vocaliques (ceux qui correspondent aux voyelles ou pseudo-voyelles de la langue orale) conduisent à produire des sons (/a/, /i/, /ou/, /in/…), les phonèmes correspondant à des consonnes n’ont pas d’équivalents sonores distincts.
Il est d’ailleurs symptomatique que celui qui croit « entendre » le phonème /b/ parle de cette expérience auditive en déformant ce qu’il a réellement entendu : pour analyser la syllabe /ba/, il dit qu’il a entendu /bé/ puis /a/ ou bien /be/ puis /a/ alors que dans un cas comme dans l’autre la fusion de ces deux sons ne reconstitue pas la syllabe initiale (on entend respectivement /béa/ et /beua/). L’adulte lettré, l’enfant chez qui « la mayonnaise de la lecture est en train de prendre », lorsqu’ils croient entendre sonner les consonnes occlusives isolément, sont les victimes (heureuses) d’une sorte d’illusion : c’est parce qu’ils ont conceptualisé (compris) les phonèmes correspondants que cette illusion fonctionne.
Comme ce point est fondamental pour comprendre la suite, il vaut la peine de suggérer une analogie. Qu’on se rappelle ces images qui, a priori, apparaissent comme un ensemble de taches noires sur fond blanc. Au premier abord, il s’agit d’art abstrait et puis l’on nous dit de « bien regarder » parce qu’il y a un chien figuré dans l’image. Souvent, on a beau regarder, on ne distingue rien. La consigne de « bien regarder » a beau être répétée de nombreuses fois, cette répétition n’est d’aucun secours. C’est seulement lorsqu’on nous donne des informations supplémentaires (où est la tête, la queue…) que l’animal nous apparaît et, caractéristique de cette situation : on ne peut plus ne pas le voir. Lorsqu’on a compris l’image, c’est définitif : le chien est là, comment pouvait-on ne pas le voir auparavant ?
L’expérience de la compréhension des phonèmes consonantiques est proche de celle-là : lorsqu’on les a compris, on croît qu’il s’agit là d’une expérience sensorielle primaire et on pense qu’on les entend. Et l’enfant qui ne les entend pas devient un être bizarre parce que l’adulte a oublié qu’avant de savoir lire et écrire, lui non plus, ne les entendait pas.
Le projet « Lecture » d’ « Agir pour l’école » : vraisemblablement des élèves en souffrance
Rappelons que dans le cadre d’une approche basée sur la preuve telle qu’elle se pratique classiquement, le projet « Lecture » de l’association « Agir pour l’école » correspond à la 2e phase : l’expérimentation pré-test puis post-test avec une intervention pédagogique dans l’intervalle. Les élèves de GS reçoivent donc l’entrainement aux trois points décrits précédemment. Concernant la découverte des phonèmes, ils jouent, par exemple, au jeu de l’intrus : sur un carton, ils voient les images d’un râteau, de raisins, d’une table et d’un rond. Grâce à ces images (activité de lecture d’images), les enfants accèdent à la forme phonique de chaque mot : /rato/, /rèzin/, /table/ et /ron/ et ils doivent déterminer le mot qui ne commence pas comme les autres.
Une telle tâche (isoler un phonème consonantique) est celle qui a été envisagée plus haut, dont nous avons dit qu’elle ne peut que mettre de très nombreux enfants de GS en échec. On n’est pas étonné, donc, lorsqu’on lit dans l’évaluation de VB & GP (p. 12) : « En GS, il est permis de se demander si l’introduction du module Phonologie n’est pas trop précoce pour certains élèves. Ainsi, quand la moitié d’un groupe ne donne aucune réponse correcte en une demi-heure d’atelier, ne manifeste aucun signe d’intérêt pour l’activité en cours, il est légitime de se demander si ces élèves ne gagneraient pas à être mobilisés sur d’autres activités dont ils ont un besoin plus pressant. »
En fait, l’expression des inspecteurs généraux est vraisemblablement dans la retenue. En effet, on trouve sur le site des éditions La Cigale, l’éditeur qui fournit le matériel d’expérimentation, une vidéo (6) relatant un exemple de travail avec un petit groupe d’enfants de GS dits « en difficulté ». En réalité, ces enfants se comportent tout à fait normalement pour cet âge : ils entendent les syllabes et les vocaliques (a, e, i…). Ainsi, comme l’une des enfants propose le mot « raisins » comme intrus dans la liste : râteau, raisins, table et rond, l’enseignant reprend les images dans l’ordre et l’interroge sur chacun des mots. Systématiquement, elle dit que râteau commence par /ra/, raisin par /rè/, table par /ta/ et rond par /ron/. Pressée de « trouver plus court », elle dit : /a/ pour râteau, /è/ pour raisin, /a/ pour table et /on/ pour rond. Rien que de très normal : elle répond en utilisant ce qu’elle entend. Le phonème /r/, elle ne l’entend pas parce que ce n’est pas un son. Et pourtant, /r/ n’est pas une occlusive, c’est une consonne dite « vibrante », qu’on peut prolonger : /rrrr/. Rien n’y fait.
Quand un autre enfant du groupe isolent le /rrrr/, cette enfant le regarde, ne comprenant absolument pas comment il a fait pour entendre une sorte de rugissement de lion lorsque /rato/ a été prononcé, alors qu’elle n’a rien entendu de tel. Alors que dans sa famille, l’enfant entend ce que les autres entendent, l’école doit lui apparaître comme un lieu inquiétant où ce n’est plus le cas. Elle ne peut pas comprendre ce qui lui arrive.
Et les rédacteurs de la note finale de l’expérimentation, note qui est rédigée au nom de l’association « Agir pour l’école » elle-même, par des chercheurs rémunérés par cette association, qu’en disent-ils ? Ils écrivent (p. 11) : « Les entraînements se sont parfois révélés difficiles pour les élèves les plus faibles initialement. Il a ainsi été observé que dans les classes avec beaucoup d’élèves en très grande difficulté, les séances pouvaient être très difficiles, à la fois pour l’enseignant et pour les élèves, car le protocole suppose que les élèves s’exercent de façon systématique, sur des tâches non maîtrisées, jusqu’à ce qu’elles le soient. »
La mise en souffrance d’élèves est très vraisemblable : on ne peut pas demander à un enfant d’entendre un son qui n’existe pas en pensant que, par la répétition, il se mettra à l’entendre. Non : la répétition ne fera que renforcer l’enfant dans son sentiment d’inadaptation et le rendre malheureux de ne pas pouvoir répondre à l’attente de l’adulte. Encore une fois : de tels élèves ne sont pas faibles initialement, il est normal qu’ils n’isolent pas les phonèmes consonantiques. En revanche, on risque effectivement de les rendre faibles en les décourageant, on risque de créer de l’échec scolaire. Et le dispositif expérimental ne permettra pas de le déceler : l’évaluation étant fondée sur un calcul de moyennes et évaluant autre chose que la capacité des enfants à résister au stress de telles situations, rien ne sera dit de la façon dont les élèves les plus fragiles sur ce plan là, s’en sortent ou, malheureusement, ne s’en sortent pas.
Il est clair que la répétition ne peut pas permettre à cette élève de progresser. Les autres activités proposées, les tâches d’écriture notamment, le permettent-elles ? Non, parce que la démarche adoptée est similaire. C’est celle qu’André Ouzoulias qualifie de « classique » : l’analyse de l’oral au niveau du phonème est considérée comme un préalable absolu. Ainsi, la méthode propose des dictées de syllabes : /ba/ est dicté, par exemple, mais il est demandé à l’enfant d’analyser cette syllabe en phonèmes /b/ + /a/ avant d’écrire les lettres correspondantes. Dans les tâches d’écriture proposées, le même obstacle s’érige que celui qui empêchait l’élève de rentrer dans les tâches d’analyse de l’oral.
On peut se poser la question : mais pourquoi les enseignants acceptent-ils de mettre ainsi en échec de nombreux élèves sur de nombreuses tâches ? Parce qu’ils se sont engagés dans la recherche, parce que cette activité fait partie du protocole d’expérimentation et parce qu’au-delà, cette façon de faire leur a été présentée comme recommandée par une entité qui s’appelle « la recherche ». Les auteurs de la note continuent d’ailleurs ainsi leur propos sur la nécessité de répéter encore et encore (p. 11) : « C’est en effet d’après la recherche, le seul moyen d’accéder à certaines compétences nécessaires à l’apprentissage de la lecture. Cela a parfois été mal vécu par les enseignants ainsi conduits à confronter les élèves les plus faibles à des situations de blocages, malheureusement parfois persistante ».
Quand on lit : « cela a parfois été mal vécu », le mot « parfois » relève vraisemblablement de l’euphémisme parce que p. 16, concernant le suivi au CP de la cohorte des élèves de GS, il est écrit que : « 66 classes de CP seulement se sont engagées au terme de la première année, au lieu des 174 visées ». Les enseignants se sont engagés sur une année mais, dès qu’une possibilité de sortie s’est présentée, il semble bien que ce fut l’hémorragie.
Rémi Brissiaud
Lecture : le débat est ouvert
http://cafepedagogique.studio-thil.com/lesdossiers/Pages/2014/LectureLedebatestouvert.aspx
Notes
3 Inspection Générale de l’Éducation Nationale. (2012). Évaluation de la mise en œuvre, du fonctionnement et des résultats des dispositifs « P.A.R.L.E.R. » et « R.O.L.L. » (Vol. 2012-129). Paris: Ministère de l’Éducation Nationale.
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/31/1/2012-129_254311.pdf
4 http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Final_EXPE_HAP-11.pdf
5 André Ouzoulias (2014) Lecture Écriture – 4 chantiers prioritaires pour la réussite. Paris : Retz.
6 http://www.editions-cigale.com/ressources
La vidéo en question s’appelle : « Aider les élèves en difficulté » ; consulté le 03/04/2014.
|
Sur le site du Café
|