À l’heure où des écoles sont vandalisées par de jeunes émeutiers, Laurence De Cock, historienne, revient sur ce phénomène hautement symbolique et pas si nouveau que ça…
 Dès les premières nuits de révoltes et d’émeutes à la suite du meurtre de Nahel par un policier à Nanterre, des écoles ont été attaquées. Le 30 juin, le ministère faisait état d’une centaine d’incidents dans 18 académies et de six fermetures au total. Les chiffres ne sont pas définitifs, la colère gronde encore, non sans raisons.
Dès les premières nuits de révoltes et d’émeutes à la suite du meurtre de Nahel par un policier à Nanterre, des écoles ont été attaquées. Le 30 juin, le ministère faisait état d’une centaine d’incidents dans 18 académies et de six fermetures au total. Les chiffres ne sont pas définitifs, la colère gronde encore, non sans raisons.
Les incendies et dégradations touchent aussi des crèches, des bibliothèques et médiathèques. Autant le dire, aucune institution publique, pas même celles qui nous semblent intouchables, lieux de culture, d’accueil des tout petits, n’est épargnée.
Dès lors, des voix s’indignent et s’étranglent : ce sont les écoles de vos petits frères et sœurs, c’est la bibliothèque où vous allez emprunter des livres leur dit-on. Les parents, on les comprend, s’angoissent et s’organisent pour protéger les écoles de leurs enfants. À la fois ils comprennent les révoltes mais la destruction des écoles dépasse leur capacité d’entendement. C’est normal, c’est ce qu’ils ont de plus précieux dans le quartier.
Les plus empathiques parlent d’autodestruction. Les jeunes se saboteraient eux-mêmes. Mais dans la droite la plus extrême et dans certains médias d’information continue, on profite de ces actes, cette « violence aveugle », pour tourner en boucle sur la sauvagerie des jeunes, ces « nuisibles », comme les qualifient les syndicats UNSA-Police et Alliance réunis dans un infâme et séditieux communiqué. On fustige leur absence de scrupules et on voit bien là la preuve du caractère apolitique de leur colère. Ils n’attendaient que ça, disent-ils, piller et mettre le feu.
Les écoles, lieux d’injustice sociale
Mais pourquoi brûlent-ils des écoles ? La question ne se pose pas pour la première fois. En novembre 2005, cela avait déjà interpelé car 255 établissements scolaires avaient été touchés. Pour Laurent Ott, éducateur et pédagogue social, dans les quartiers populaires, depuis longtemps, les écoles incarnent le lieu de l’injustice sociale, et beaucoup d’adolescents n’en gardent pas un si bon souvenir que cela. Présentées comme les lieux de « promesse républicaine » aussi bien par l’institution que par les enseignants, les jeunes ne peuvent que percevoir le décalage entre ces beaux discours et leur réalité. Dans les quartiers populaires, l’école produit beaucoup plus de relégation que d’intégration.
Les sociologues Didier Chabanet et Xavier Weppe notent à leur tour que « la rage [des émeutiers] porte contre le quartier lui-même, elle n’a rien à négocier ». Ils confirment la révolte des jeunes contre des institutions publiques qu’ils méprisent en retour et miroir du mépris qu’elles leur ont fait subir. L’école n’est pas une cible collatérale, elle est au cœur des institutions ciblées comme mensongère. Lors d’entretiens en 2016 et 2017, les jeunes critiquent les enseignants « blancs », qui n’habitent jamais le quartier, qui ne les respectent pas, ne les félicitent jamais. Le ressentiment est lourd. Les bibliothèques, elles, ne seraient fréquentées que par à peine 10% des habitants en moyenne. Les deux sociologues notent alors l’échec patent d’une politique de la ville qui n’a jamais réfléchi aux modalités d’association des habitantes et habitants aux choix de transformations de leur quartier. Dès lors, toutes les institutions publiques apparaissent comme des excroissances qui au pire les écrasent ou rejettent, au mieux ne les concernent pas. L’école ne fait pas forcément exception.
Nos lycées brûlent
S’en tenir à ces explications ne suffit peut-être pas pour comprendre la place particulière occupée par les établissements scolaires dans cette démonstration de colère. Dans les années 1970, on assiste à une multiplication d’incendies criminels, par des élèves, touchant des écoles, collèges et lycées. C’est à l’occasion de l’incendie du collège Pailleron le 8 février 1973 que les médias commencent à interroger cela comme un phénomène de société. Pour les seuls mois de janvier et février, le journal Paris-Match en dénombre onze dans tout le pays …

Comme pour Pailleron, ce sont des incendies ou départs de feux faits par des élèves qui veulent se venger de situations ou propos humiliants. À Pailleron, le jeune Patrick 14 ans avait dit à la police qu’il ne voulait pas aller dans la classe surnommée « des déchets ». À Bobigny, ce sont les classes dites « pratiques » d’un CES qui brûlent, cinq baraquements en bois : « Mon prof nous a raconté que les autres profs lui disent sans arrêt : « tu as du courage de rester avec ces tarés » raconte un élève, ajoutant : « les portes n’ont même pas de poignées, elles nous restent dans les mains. Par moment il n’y a pas de carreaux, les extincteurs ils viennent les remettre pour l’enquête pour faire bien devant les inspecteurs, c’est parce qu’un mec a voulu mettre le feu ».
Deux ans plus tard, en 1975, on compte encore une quarantaine d’incendies criminels. Les conditions matérielles sont avancées comme principales causes à deux niveaux : d’abord parce que les constructions sont hautement inflammables et que tout départ de feu peut être fatal, comme à Pailleron ; ensuite parce que les établissements scolaires qui sont incendiés sont pour la plupart délabrés et renforcent le sentiment de honte des élèves qui y sont scolarisés.
Mais certains articles avancent d’autres hypothèses comme celui de Claire Brisset dans Le Figaro du 12 février 1973, où la journaliste (qui deviendra plus tard défenseure des droits, spécialisée dans les droits de l’enfant) interroge « l’enfant et la symbolique du feu ».
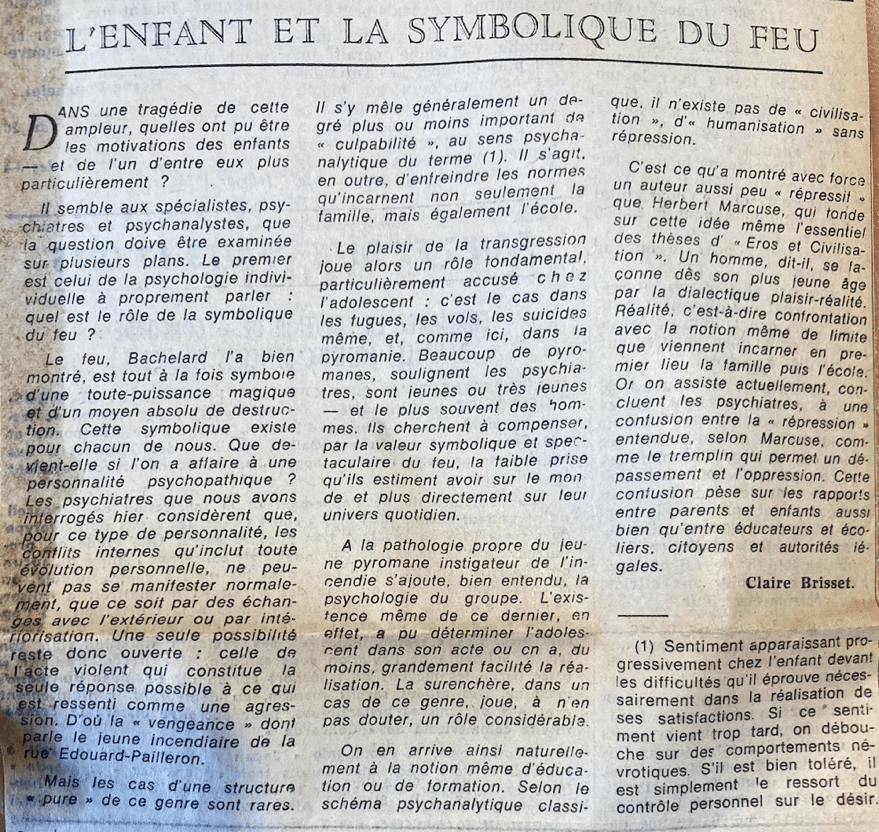
L’approche se veut plus psychologique. L’acte violent de mettre le feu relèverait à la fois du sentiment de la toute-puissance magique et de la volonté de venger une situation ressentie comme une agression : « Ils cherchent à compenser, par la valeur symbolique et spectaculaire du feu, la faible prise qu’il estiment avoir sur le monde et plus directement sur leur univers quotidien ».
Sans pousser trop loin les analogies avec aujourd’hui, ces rappels historiques permettent d’interroger autrement les incendies ou saccages d’établissements scolaires que comme des gestes irréfléchis et gratuits. En s’attaquant à ce qu’ils savent être des lieux symboliques d’une promesse d’égalité, ils leur déclarent la guerre parce que depuis trop longtemps le contrat qu’ils ont avec l’école publique s’est transformée en jeu de dupes.
On ne répond pas à la rage par des incantations
Quelles réponses ont été données à la jeunesse reléguée depuis cinquante ans ? C’est peu de dire que le pari de la démocratisation scolaire n’a pas été tenu. L’école française figure parmi les plus mauvaises élèves de l’OCDE en matière de reproduction des inégalités. Si l’on ne parle plus de « déchets » ou de « tarés », les lycéennes et lycéens des voies professionnelles restent considérés comme de la main d’œuvre corvéable à merci comme en témoigne la récente réforme des lycées professionnels. Le mépris de classe n’a pas disparu.
Quelles réponses ont été apportées à la jeunesse des quartiers populaires depuis 2005 ? Il suffit de regarder l’état matériel de certains établissements scolaires délabrés pour comprendre le désintérêt des collectivités territoriales pour les conditions de scolarisation de certains enfants. Les réformes éducatives ont été dans le sens complètement inverse d’une démocratisation scolaire : accélération du tri social, accentuation d’une concentration des moyens sur les élèves les plus « méritants » (voir les internats d’excellence par exemple), laissant les autres – la majorité – sur le bas-côté ; absence de continuité du service public avec des enseignants non remplacés, des recrutements au rabais etc.
Dans la magnifique Lettre à une enseignante qu’ont écrite les enfants italiens de l’école de Barbiana en 1967 on trouve aussi cette rage. Ils annoncent d’emblée la couleur : ils sont les recalés du système, et ils en connaissent les responsables. Ils ne sont pas là pour négocier mais pour poser leurs conditions. Le texte est cru, violent parfois, la condamnation d’une école publique qui les rejette est implacable. Eux n’ont pas choisi le feu mais leurs mots jettent des flammes, et c’est bien comme ceci qu’a été reçue la lettre en Italie. « Nous attendons une réponse » posent-ils comme un ultimatum.
Le retour du calme ne peut être qu’à ce prix. Des réponses, des vraies. On ne répond pas à la rage par des incantations et on n’a que trop attendu.
Laurence De Cock











