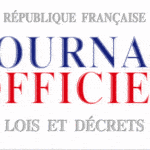La violence à l’école est un sujet de vos recherches depuis 40 ans, quelle évolution sur la violence à l’école ? Y a-t-il plus de violence aujourd’hui comme on peut souvent l’entendre ?
Toutes les enquêtes comme celles du ministère sont claires : il n’y a pas véritablement d’augmentation de violences subies par les élèves, comme entre élèves. Qu’il y ait des changements liés à l’usage de la cyberviolence, c’est une évidence, mais il n’y a pas plus de victimes. Par contre, une des inflexions très récentes est l’augmentation de ce qui touche à une violence idéologique portée par les élèves eux-mêmes. C’est-à-dire tout ce qui va toucher au racisme, à la xénophobie ou au LGBTphobies et en particulier la transphobie. On peut dire qu’il y a une augmentation très récente mesurée par le ministère. On peut la lier bien sûr à l’ambiance idéologique générale de la société au niveau mondial.
Et qu’en est-il de la violence à l’encontre des personnels ?
Il n’y a pas d’augmentation de la violence contre les personnels par les élèves pour être clair. On est encore à plus de 80% des professeurs qui se disent respectés par les élèves. Cela ne veut pas dire que c’est satisfaisant : 40% des professeurs déclarent avoir été victimes de violences verbales. Mais on a tendance à focaliser sur des faits divers extrêmement tragiques qu’il ne faut pas considérer comme des faits ordinaires subis par la quasi-totalité des personnels. Il ne s’agit pas non plus de minimiser les drames qui ont pu arriver. Leur exceptionnalité ne doit pas être récupérée dans une sorte de « série » nauséabonde. On pense évidemment à Samuel Paty, à Dominique Bernard, mais pensons aussi à Agnès Lassalle qu’on oublie très souvent, car sa mort n’est pas en relation avec le terrorisme… et qu’on n’associe guère dans les minutes de silence.
Les enquêtes révèlent une augmentation du harcèlement entre adultes, que ce soit du harcèlement entre professionnels qui est le harcèlement majoritaire, mais aussi les difficultés avec les parents qui sont pourtant quantitativement moins fortes mais plus dites. Il y a une augmentation de chefs d’établissement qui se disent être harcelés par leurs enseignants, et des enseignant par leur chef d’établissement. Cela montre une augmentation très nette des conflits d’équipes et derrière une violence institutionnelle, perçue telle quelle dans les verbatim de nos recherches. Ce n’est pas spécifique à l’Education nationale mais quand on a 78% des personnels du 2nd degré et 74% du Premier degré qui disent ne pas être respectés par la haute hiérarchie ou par le personnel politique, il est évident qu’on a une crise de confiance majeure. Cette crise se reporte ensuite dans les établissements par ceux qui sont pris en tenailles entre la hiérarchie hors établissement et leurs troupes, et en particulier les chefs d’établissement et directions d’école. Il y a aussi une remise en cause très forte de la manière dont se fait l’école inclusive qui est un véritable appel au secours de la part des personnels du Premier degré. Il ne s’agit pas de d’assimiler handicap et violence mais bien de dire que la manière dont l’inclusion se fait au rabais et sans formation est en soi une violence institutionnelle.
Quelles manifestations et forme de la violence peut-on distinguer ?
L’essentiel des violences à l’école sont des microviolences, apparemment extrêmement banales ou ordinaires. On comprend souvent mal qu’elles puissent former le fond de la violence comme les bagarres dans les cours de récréation ou les insultes. Quand elles se cumulent sur les mêmes personnes, quand elles sont répétées et associées comme le harcèlement, elles peuvent avoir des conséquences dramatiques. C’est quelque chose que la recherche a montré depuis des dizaines d’années, y compris aux Etats-Unis, pays pourtant de plus fréquentes violences létales. Pour les formes de violences paroxystiques liées par exemple à des intrusions dans des établissements scolaires, il faut rappeler le chiffre officiel des dernières enquêtes de l’Éducation nationale : seules 2,5% des violences dans les établissements scolaires sont celles des extérieurs. C’est donc bien un problème au cœur de l’établissement scolaire qui a évidemment la nécessité d’un traitement pédagogique. Ce point n’empêche pas de penser à la sécurisation technique de l’établissement scolaire, mais en sachant que cela ne traitera jamais qu’une toute petite partie du problème de la violence à l’école. L’irruption de la cyber violence et du cyber-harcèlement nécessitent aussi des traitements de coéducation entre les familles et les établissements scolaires.
Y-a-t-il une évolution dans les réponses politiques sur le thème de la violence ?

A chaque nouveau ministre, il y a un nouveau plan même si c’est le même, il n’y a pas de suivi et on oublie plein de choses. J’aime bien citer l’exemple des emplois jeunes de l’époque Allègre au tournant des années 2000. Plusieurs dizaines de milliers d’emplois jeunes sont mis sur le terrain pour aider les établissements scolaires. Du jour au lendemain avec une alternance politique, ils sont supprimés sans un merci. Un chapitre de l’ouvrage parle des précaires de la violence, des personnels souvent sans statut ou sans formation, souvent oubliés dans les alternances politiques. Par rapport à l’école inclusive, les personnels AESH sont très mal payés et très rarement à plein temps, très mal indemnisés et très mal formés : ça ne peut pas fonctionner. Il y a une incohérence d’Etat.
Quand on parle de violence, on l’associe désormais au sujet du harcèlement et cyber-harcèlement dont il est de plus en plus question dans la société et la presse. Est-ce pour autant nouveau ?
Les progrès techniques avec le web 2.0 voire 3.0 ont amené de nouveaux outils à disposition du harcèlement. On en parlait déjà en 2011 dans les assises nationales. De l’influence d’internet, de la haine et de la manière dont se fabriquent des communautés. Pour le harcèlement en milieu scolaire, ce sont des groupes qui se constituent en désignant un bouc émissaire, en touchant au racisme, à la xénophobie, la transphobie, la grossophobie ou encore le trop bon élève. C’est vraiment cette manière dont un « nous » se monte contre un autre et c’est un processus très étudié dans la sociologie. C’est une catastrophe annoncée, mais qui est précipitée par un climat politique diffusé ad nauseam par différents médias, des médias sociaux ou des médias télévisuels. La presse Bolloré joue pour moi un rôle dans les cours de récréation. J’ai d’ailleurs refusé leurs interviews.
Ce que vous décrivez sur la violence à l’école, ce sont finalement les mêmes mécanismes que ceux de la violence dans la société. Finalement la violence en milieu scolaire a les mêmes mécanismes que la violence dans d’autres milieux ?
Oui, disons en grande partie mais accélérée par la spécificité des milieux scolaires, c’est à dire des lieux où des élèves sont mis ensemble de manière artificielle. Des dizaines de centaines d’enfants et adolescents vivant ce groupe à longueur de journée, c’est quand même quelque chose de très spécifique malgré tout. Même si ce sont les mêmes mécanismes étudiés depuis longtemps en psychologie sociale : c’est la tyrannie de la majorité ou à l’inverse l’influence des minorités actives. Tous ces phénomènes sont très intéressants à étudier dans le fonctionnement d’une classe, d’un groupe classe et dans la manière dont on pourrait agir sur ce type de de phénomène si on était formé. On sait depuis longtemps, si on reprend par exemple les travaux de la pédagogie institutionnelle dans les années 70 qu’un style autoritariste excessif de la part de l’adulte cause un phénomène de bouc émissaire chez les élèves…
On voit effectivement aussi combien ignorer les difficultés ou faire semblant de les ignorer encourage en fait à l’escalade. Un style coopératif est sans doute le style qui permet le plus de réguler un certain nombre de phénomènes de groupe à condition que ce soit un groupe coopératif organisé autour d’un projet commun. Il y a beaucoup de solutions qui sont pédagogiques. Mais ce nouveau livre n’est pas un livre de pédagogie. C’est une sonnette d’alarme pour dire à notre classe politique : écoutez, arrêtez les conneries.
La violence en milieu scolaire serait en quelque sorte le reflet d’une violence institutionnelle ?
On est dans une boucle, dans un système : la violence est systémique. Il faut penser le système, la violence a des spécificités évidentes et les violences en milieu scolaire ce n’est pas la violence de la MJC. C’est une illusion de penser, et surtout à l’heure où l’information et la fausse information circulent à longueur de journée sur le téléphone portable, qu’on puisse être isolé de mécanismes extérieurs. Si je parle des phénomènes qui ont lieu sur le plan français, on est aussi complètement pris dans la circulation de violences portées par la géopolitique. On sait par exemple que le conflit en Moyen Orient avec à la fois d’un côté des massacres commis par le Hamas et de l’autre côté le génocide en cours en Palestine a un impact sur les relations sociales des jeunes eux-mêmes. Il est utile de dire aussi à quel point les traitements très inégalitaires des actualités liées à l’islam ont aussi un impact direct sur les jeunes. On fabrique de l’humiliation qui peut être un terreau extrêmement dangereux avec toutes les manipulations d’un certain nombre de groupes d’extrême-droite très organisés en particulier sur la toile. Et cela n’aurait pas d’influence sur nos jeunes qui vont sur internet ?
Vous avez dit écrire un livre politique. Quel message adressez-vous ?
On a besoin à court terme de penser à long terme. On a besoin de penser de manière transpartisane. On y est arrivé, ce n’est pas impossible comme en 2011 avec Luc Châtel à l’éducation, un ministre de Nicolas Sarkozy, qui n’est certes pas de mon bord politique… Quand il y a eu alternance politique, Vincent Peillon et Najat Vallaud-Belkacem n’ont pas remis en cause les politiques de formations mises en place, les formations au climat scolaire et de lutte contre le harcèlement. Cette politique transpartisane a été cassée idéologiquement, en particulier par Jean-Michel Blanquer.
Arrêtons de penser à court terme, en particulier en réagissant à chaque fait divers de la manière attendue. Quand Darmanin dit qu’il faut arrêter les activités ludiques en prison, c’est démagogique. Ensuite, c’est non à la gouvernance top down, le terrain n’en peut plus.
Arrêtez de pondre des textes et circulaires, qui se sont accélérés d’une manière incroyable depuis une quinzaine d’années. Il y a longtemps que l’on sait que la violence est une crise de sens ! Où est le sens de tout ça quand ce sont les ministres eux-mêmes et une grande partie de la classe politique qui en rajoutent sur le rejet de l’autre ? Et méprisent finalement la jeunesse dans le jurassique stéréotype de l’enfant sauvage, pour ne pas dire de sauvages.
Propos recueillis par Djéhanne Gani
Eric Debarbieux : Zero pointé. Une histoire politique de la violence à l’école. Les liens qui libèrent, 2025.

Pour recevoir notre newsletter chaque jour, gratuitement, cliquez ici.