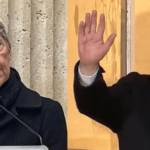Une multitude d’espaces de diffusion et de médiation des recherches en éducation et sa faible influence
Ouvrant la journée, Xavier Pons, du Laboratoire ECP-Lyon 2 et chercheur associé au Centre de Recherche sur les Inégalités Sociales (CRIS-Sciences Po, UMR 7049) évoque un paradoxe : les espaces de diffusion et de médiation des recherches en éducation se multiplient, en même temps que des rapports soulignent la faible capacité de la recherche à influer les tendances dans le pilotage des politiques publiques. On déplore souvent des « cloisonnements multiples », les logiques disciplinaires de la recherche qui contribuent à l’émiettement de la communauté scientifique, la résistance à se confronter aux autres courants et la difficulté à constituer des instituts de recherche en éducation forts. Peser sur le débat public nécessite que les travaux scientifiques soient robustes. Mais en même temps, on constate une fabrication des politiques publiques instable, qui se méfie des sciences de l’éducation et a tendance à produire ses propres normes en instrumentalisant d’autres disciplines de recherche. Il parle d’ignorance collective ou d’instrumentalisation de certains courants de recherche pour tenter de valider les politiques menées. La journée d’études « Recherches, problèmes publics et politiques d’éducation Regards croisés » qui est organisée à l’IFE tente de faire le point sur la question, en donnant d’abord la parole à deux chercheuses.
Les difficultés à partager les résultats et analyses de la recherche
Dans sa thèse, Rosa Bortolloti a étudié l’usage des réseaux sociaux par les jeunes et les éducateurs de rue de Seine-St-Denis. Elle montre que la rencontre entre les deux univers à travers ces espaces implique un changement de culture des professionnels.
Camille Lavoipierre, qui a étudié le port des vêtements dans le cadre scolaire, montre à quel point la définition des « tenues correctes et acceptables » devient difficile lorsque les polémiques politiques et médiatiques instaurent l’idée de « tenues républicaines » ou que l’identité des personnes « trans » fait surgir de nouvelles polémiques sur ce qui est jugé acceptable par les équipes de vie scolaire des établissements.
Interrogées sur les difficultés qu’elles peuvent rencontrer dans la communication de leurs résultats, les chercheuses soulignent plusieurs difficultés qu’elles ont rencontrées :
- voir les résultats de leurs recherches tronqués ou déformés par un angle journalistique ;
- répondre aux demandes de collectifs, qui attendent de la recherche des solutions aux problèmes professionnels qu’ils rencontrent, ce qui est bien entendu hors de portée de leurs connaissances ;
- savoir défendre la rigueur de leurs analyses lorsqu’elles sont suspectées d’être mues par leurs engagements personnels, surtout lorsqu’elles enquêtent sur des questions socialement vives.

La question de la légitimité et de l’acceptabilité de la parole du chercheur est donc toujours à reposer. « La codification de la parole publique est permanente » ajoute X. Pons. « J’ai vécu une polémique terrible quand ma première interview structurée de 40 mn a été réduite à 4 secondes caricaturales diffusées au 20h de France 2. Limiter le propos à une seule idée est souvent cruel… » dit-il.
Des relations problématiques entre sciences et politiques éducatives ?
Prenant l’exemple de la dyslexie, Stanislas Morel (université Sorbonne Paris-Nord), entend montrer comment les chercheurs en sciences sociales sont aujourd’hui confrontés à la domination des sciences cognitives dans le champ de l’éducation. Depuis les années 1950, les troubles « dys » commencent à faire l’objet d’études, avant que les sciences cognitives en fassent un problème de santé publique, d’origine neurologique, qui toucherait entre 1 et 8% des élèves selon les études des années 1990. La « dyslexie » devient, dans cette construction, le coeur de l’échec scolaire dans une école primaire qui ne prendrait pas en charge les adaptations nécessaires. « La médicalisation de l’échec scolaire est toujours en cours aujourd’hui » explique S. Morel, « au point que les critiques de surmédicalisation sont aujourd’hui partagées y compris dans le champ médical ».
Or, les évolutions récentes des savoirs issus des sciences cognitives remettent en question certaines évidences. La définition de la « dyslexie » reste très peu consistante : est présumé dyslexique celui qui n’apprend pas assez, qui est mauvais lecteur sans qu’on puisse identifier une cause apparente (déficience, psychopathologie, milieu social).
On peut donc, poursuit-il, questionner l’efficacité de la « prévention de la dyslexie », puisqu’aucune remédiation ne montre qu’elle aurait une efficacité particulière sur une population spécifique identifiée « dyslexique ».
Qu’en conclure ? Pour S. Morel, c’est la tension entre le temps long de la science, dont les progrès sont lents, et le temps court du politique tenté de chercher des solutions miraculeuses et… populaires. « Je ne remets pas en cause les sciences cognitives, mais l’utilisation qu’on en fait dans les politiques publiques, toujours placées sous le signe de l’urgence » précise-t-il. Certains chercheurs en sciences cognitives dénoncent d’ailleurs publiquement l’utilisation de leurs travaux par les partisans de la « neuroéducation ». Mais quand la demande politique rencontre l’intérêt de certains groupes sociaux, on assiste à des effets d’emballement désastreux pour les enseignants qui sont enjoints de mettre en oeuvre des prescriptions impossibles.
Ces politiques ont, selon lui, tendance au « réductionnisme scientifique », dans lequel une seule cause devient centrale. La complexité des problèmes d’apprentissages de la lecture est niée, les apports des autres sciences sous-estimés alors qu’on aurait besoin d’un regard global. Les usages que les acteurs sociaux font des connaissances scientifiques se réduisent à des guides de bonnes pratiques. « Loin de moi l’idée de réduire cette simplification au champ des sciences cognitives. Dans l’histoire, on a sans doute aussi parfois réduit les savoirs issus des sciences sociales à des recommandations simplistes. On a besoin que les administrateurs de l’éducation fassent preuve de continuité et de discernement, pas de volonté de choc !»
Décrypter les « configurations » dans lesquelles les discours prennent forme : l’exemple des journalistes et des chercheurs
Xavier Pons poursuit le fil de la discussion : « Pour comprendre comment évolue le débat public sur l’éducation, il faut accepter l’idée que les acteurs sont interdépendants les uns les autres, et que ces configurations exercent des contraintes sur leur parole et leur action ». Comment les acteurs arrivent-ils à s’ajuster ? L’intervenant propose de revenir à la discussion entre chercheurs et journalistes, à partir d’un ouvrage qu’il a publié sous le titre Comment on débat des politiques d’éducation en France[2].
Il prend l’exemple d’un débat qui a eu lieu sur l’absentéisme scolaire des élèves dans les années 2000 : avant cette date, l’absentéisme n’est pas un problème public. Plusieurs articles de presse amènent a définir l’absentéisme comme un « fléau », ce qui n’est pas une métaphore neutre, à un moment où aucune statistique publique n’existe à la DEPP sur cette question. Ce « fléau » conduit à la « violence », confondant causalité et corrélation. Il faut donc « sanctionner les familles » coupables de « manque d’autorité » ou de « carences éducatives ». En mars 2002, un rapport propose de supprimer les allocations familiales aux parents d’enfants absentéistes. Le débat public se concentre sur la controverse autour de l’annonce de cette mesure (qui existe déjà !).
Comment expliquer la montée de ce « populisme éducatif » ? Son étude analyse le contexte : une radicalisation des discours de la Droite en pleine campagne interne de N. Sarkozy, la Droite cherchant à renvoyer la Gauche à ses insuffisances. De leur côté, les rédactions des médias « collent » à l’actualité gouvernementale, en faisant traiter l’actualité par des journalistes politiques plutôt que par des journalistes spécialisés en éducation. L’opinion publique elle-même est sensible à ce type de mesure. Face à ces discours, les syndicats enseignants ont peu de de contrepouvoirs. Les acteurs de la vie scolaire sont peu audibles, faiblement structurés. La parole experte de la recherche est elle-même dispersée : les recherches sont peu nombreuses, et les chercheurs les plus compétents font le choix de peu communiquer dans l’espace médiatique, même quand leurs résultats vont à rebours des discours politiques. Les journalistes spécialisés en éducation sont eux-mêmes peu audibles dans les conférences de rédactions, face aux 60 millions d’experts en éducation…
A travers cet exemple, X. Pons explique donc qu’on ne peut pas « parler de tout », on est dépendant des « configurations » dans lesquelles on puisse s’exprimer, s’ajuster. S’intéressant spécifiquement aux journalistes, il construit plusieurs catégories :
- des experts, journalistes précocement spécialisés dans la question éducative, toujours intéressés par le domaine, centrés vers un journalisme d’expertise, écrivant en direction des professionnels, des acteurs de terrain ;
- des « convertis» qui essaient de prolonger leur expérience et cherchent à décrypter l’actualité ;
- des « polyvalents », dans des rédactions généralistes, qui éprouvent rapidement un sentiment de saturation sur les questions d’éducation, et qui sont parfois dépendants des sources officielles ;
- des « outsiders», souvent plus féminisés et plus jeunes, ne souhaitant pas s’adresser aux publics spécialisés, mais surtout s’adresser au grand public.
Mais en tendance, quelle que soit leur catégorie, selon les études et entretiens qu’il a menés, les journalistes reprennent le fil dominant, y compris les experts, devant la politisation forte des discours. Ils ne cherchent que rarement à ouvrir le débat, à montrer qu’il ne prend pas la bonne voie, ne s’inscrivant pas dans une « conception héroïque » de leur travail.
Du côté des chercheurs, X. Pons décrit deux stratégies opposées[3], la « stratégie Beethoven » (vendre beaucoup pour enrichir son carnet de commande, c’est à dire s’adapter aux discours dominants pour augmenter son pouvoir et « avoir un impact ») et la stratégie « Mozart » (ne pas renoncer à son idéal, quitte à être progressivement marginalisé). Les « Beethoven » publient, tissent des réseaux, investissent les médias. Ils deviennent une « voix », font connaitre leurs résultats, avec les effets pervers que cela amène pour pouvoir « communiquer » dans les médias. Les Mozart, au contraire, privilégient d’autres canaux d’intervention, critiquent l’hyper-spécialisation de la recherche ou les phénomènes de cour, le politiquement correct ou la censure dont leurs résultats font l’objet. Ils font des séminaires et discutent en privé avec les hauts-fonctionnaires, mais ne sont pas audibles dans le débat public.
Concluant son intervention, X. Pons insiste sur ces différentes « configurations de dicibilité » et leur impact sur le débat public et ses acteurs, ses différentes phases…
La table-ronde finale de la journée s’intéresse à la communication entre chercheurs et presse.
« Comment faire des controverses et des questions vives un moyen de renforcer le pouvoir d’action des lecteurs ? ». Béatrice Kammerer, journaliste spécialisée en éducation et parentalité, s’intéressant aux écrans, souligne à quel point les experts convoqués dans les grands médias peuvent être soumis à critique. « Un CV ne suffit pas pour savoir qui va m’aider à avancer sur un sujet. Encore faut-il que l’intervenant soit capable de dire où s’arrêtent ses connaissances… ». Cela passe, dans sa pratique, par un échange le plus authentique possible avec l’interviewé pour qu’il sorte de ce qu’il a prévu de dire très académiquement.
Murielle Salle, enseignante en INSPE, reconnait cette difficulté : « En interview, je me sentais obligée de répondre. J’ai mis longtemps à oser dire que je ne savais pas quand on m’interviewe, et dire que je n’étais pas la bonne personne ». Faire simple sans faire simpliste, trouver la formule sans tomber dans la punchline, c’est préférer l’illustration que la définition.
Aurélie Djavadi, journaliste à The Conversation France, consulte systématiquement les sites spécialisés pour avoir une idée des champs de compétence des auteurs qu’elle sollicite, et cherche à varier les éclairages.
Régis Guyon, directeur-adjoint de l’IFÉ et rédacteur en chef de la revue Diversité[4] rebondit : « parfois, en voulant bien préparer, on gomme la spontanéité des propos ». Il essaie que sa revue puisse être à la fois dans l’actualité scientifique et dans les questions vives qui préoccupent les professionnels. « Cela passe par une commande claire et une évaluation réelle des contributions reçues, pour que les auteurs comprennent à quel public ils s’adressent. Et c’est parfois douloureux. ». Conduire des entretiens est un autre exercice avec les chercheurs : un dialogue « épistolaire » amène la production d’écrits différents. La question de l’adressage des propos lui semble toujours complexe, parce qu’on n’est jamais certain que la contraction du propos va permettre de développer la complexité de la pensée d’un auteur.
Concluant les travaux, Maïtena Armagnague, de l’Université de Genève, s’attèle à tirer quelques liens de la journée : la question de la traduction entre les Sciences et la Cité pose la question du « crédit » de la Science dans ses relations avec les politiques publiques : quelles sont les « preuves » qu’elle apporte à celles et ceux qui agissent dans la vie ? Comment est-elle capable de s’emparer des controverses qui traversent la société, mais aussi celles qui traversent les espaces politiques et les champs scientifiques, au-delà de l’invocation des « libertés académiques » ? La prochaine journée, le 10 avril à Genève, sera consacrée aux « terrains sensibles » de la recherche, autour des questions d’ethnicité et d’éthique. Parce que les chercheurs, qu’ils le veuillent ou non, font de la Politique.
Patrick Picard
[1] https://www.cerlis.eu/wp-content/uploads/2025/02/GIS-PROSON-JE-de-fevrier-2025-vDEF.pdf
[2] Xavier Pons, X. (2024). Débattre des politiques d’éducation en France. Une enquête sociologique (1997-2022). Presses universitaires de Rennes
[3] issues de sa lecture des travaux du sociologue N. Elias
[4] https://publications-prairial.fr/diversite/