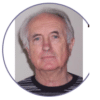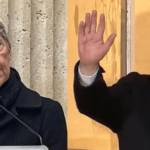Comment est né ce projet de podcast sur la mémoire de Buchenwald ?
Ce projet est né de ma rencontre avec l’autrice-réalisatrice de documentaires sonores Claire Latxague, par l’intermédiaire de la documentaliste du lycée, Delphine Ya Chee Chan. Delphine fait en sorte que nous ayons chaque année un artiste en résidence au lycée pour nous accompagner sur des projets de plus ou moins grande envergure. Au début de l’année, tout ce que je savais, c’était que je voulais organiser un voyage. Je n’avais jamais songé à me lancer dans un projet radio mais le fait d’avoir une spécialiste et du matériel à disposition m’a poussée à imaginer quelque chose autour de la parole, du témoignage. Et ça m’a paru être un outil très pertinent dans le cadre d’un cours de langue. Je connaissais personnellement la famille de Stéphane Hessel, ça me donnait une porte d’entrée du côté des témoins. C’est ce qui nous a amenés à nous orienter vers Buchenwald et Weimar.
Comment transmettre la mémoire quand les survivants disparaissent ?
Nous nous sommes intéressés à la question de la Résistance et de la déportation – nous n’avons pas eu, parmi nos témoins, de familles de déportés juifs ou déportés en tant que tels. Mais nous vivons à l’époque où s’éteignent les dernières voix des témoins directs, c’est ce qui nous a semblé crucial. En nous penchant sur la question de la transmission de l’histoire de la Déportation, nous n’avons pas voulu adopter un rôle d’historien – il y a tant de documentaires bien plus complets et plus savants qui ont été faits depuis la fin de la guerre – mais nous interroger plutôt, plus largement, sur ce que, dans les familles, l’on dit et ce et l’on tait et sur la manière de recevoir un héritage de cette taille.
Aucun collègue d’histoire du lycée n’a été associé au projet mais nous avons travaillé avec un collègue d’histoire du collège voisin, le collège Jolliot-Curie de Stains : Fabien Pontagnier. Il est également professeur relai aux Archives Nationales. Il a organisé pour nous un atelier aux Archives pour faire des recherches sur les prisonniers de Buchenwald dont parle notre documentaire. Il a également proposé aux élèves une visite de Stains en montrant la place particulière qu’y occupe la mémoire des résistants stanois, qui étaient nombreux, Stains étant une ville communiste.
Vous avez réalisé un podcast qui a été primé. Racontez-nous !
Il s’agit d’une série en 6 épisodes à travers laquelle on entend ces adolescents partir sur les traces des descendants de survivants des camps de Buchenwald et de Ravensbrück pour les interroger sur la transmission de cette histoire au sein de leurs familles, quand ils étaient eux-mêmes enfants ou adolescents. Les jeunes documentent, à hauteur d’adolescent, leur propre cheminement, la découverte d’une histoire qu’ils pensaient très éloignée de la leur et qui va pourtant se révéler si proche.
Ce projet raconte aussi la relation affectueuse qui s’est nouée entre ces adolescents et Anne Hessel, fille de Stéphane Hessel. Ils sont devenus passeurs de mémoire à leur tour en s’engageant avec elle dans une quête pour restaurer la mémoire d’un résistant oublié de l’Histoire, Michel Boitel. Ce détenu, mort du typhus, a échangé son identité avec Stéphane Hessel avant de mourir et lui a permis de survivre au camp.
Comment s’est passé ce travail au long cours de podcast dans l’établissement ?
Claire a proposé une formation de tous les collègues qui le désiraient à la manipulation du matériel, sous forme d’ateliers. Elle a fait toutes les prises de son d’ambiance et le montage, elle m’y a impliquée en me demandant mon avis sur ses choix de montage. On a travaillé ensemble pour le montage des interviews en allemand car Claire ne parle pas allemand. De mon côté, j’ai trouvé l’idée du documentaire, les témoins, organisé les visites, les déplacements. Claire est à l’affût de tous les festivals, toutes les manifestations autour de la radio, qui permettent de faire connaître notre travail. Nos sensibilités se rejoignent et nous avons tout de suite trouvé une bonne dynamique et un équilibre dans la manière de collaborer. Ca a été pour moi très surprenant car je ne suis pas habituée à travailler avec les autres, et surtout très agréable. Nous avons envie de nous lancer ensemble dans d’autres projets.
Nous avons immédiatement été très agréablement surprises de l’engagement des élèves dans le projet, qui s’est fait en dehors des heures de cours, les mercredis après-midi, le week-end, sur leur temps libre. Alors qu’ils continuent à nous accompagner même après avoir quitté le lycée, à Blois, à Amiens, à Verdun, ça nous semblerait presque évident alors que ça ne l’est pas du tout. Mais il faut bien constater que ce projet a créé une complicité singulière avec les élèves du projet. En tout cas, le projet semble avoir éveillé un réel intérêt chez eux pour les questions mémorielles. Certains d’entre eux se lancent à leur tour dans un nouveau projet sur leurs mémoires familiales, toutes liées à l’histoire migratoire.
Et par rapport à l’enseignement de l’allemand, qu’avez-vous proposé aux élèves ?
Le projet a amené les élèves à prendre la parole en allemand en créant de vraies situations de communication : à Weimar, ils ont pu interroger des témoins germanophones et ont dû mener les entretiens en allemand. De retour au lycée, on a pu retravailler sur ces entretiens en cours ce qui a fait travailler la compréhension orale. Tout voyage scolaire est, à mon sens, crucial pour motiver l’apprentissage d’une langue telle que l’allemand, que les élèves ne croisent que peu voire pas du tout sinon. Lier ce projet au voyage a donné un autre sens au voyage scolaire, les élèves venaient découvrir un pays mais ils arrivaient avec d’emblée des choses précises à aller chercher. Et, culturellement, ce projet a permis d’apporter beaucoup de choses, des repères historiques jusqu’à la découverte de poésie de Celan.
Propos recueillis par Djéhanne Gani
Pour écouter les podcasts Mémoires de Buchenwald
Dans le Café pédagogique :