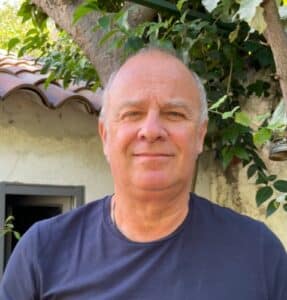
Remettons les choses dans leur contexte
Par une circulaire, du 22 octobre 2024 le dispositif des « deux heures d’activité physique et sportive en plus par semaine au collège » dès la rentrée 2024 est recentré sur « les seuls collèges classés en REP/REP+ » avec pour justification que ce sont « des territoires où le taux de licence est le plus faible ».
Cette perspective mérite d’être discutée avec pour arrière-fond les résultats des travaux scientifiques concernant la sportivisation des jeunes fréquentant ces établissements.
« Primo pratiquants » ou décrocheurs sportifs
La centration sur ces populations scolaires est pertinente, car ce sont elles qui sont les moins sportives et, surtout, les jeunes filles.
La philosophie qui anime ce projet est discutable. Il est présenté comme s’adressant à des « primo-pratiquants ». Or, nos récents travaux ont montré que si ces jeunes ne pratiquent pas le sport c’est que, pour une grande partie d’entre eux, après l’avoir pratiqué ils ont décidé de l’abandonner. Les années collège sont celles durant lesquelles on observe une augmentation importante des décrocheurs sportifs.
La pratique du sport à l’origine de son propre abandon
Nous avons pu aussi montrer que c’est la pratique du sport, telle qu’elle est trop souvent proposée, qui est principalement à l’origine de ce décrochage sportif. L’expérience sportive est vécue comme répulsive. Trois raisons sont à l’origine de ce « drop out » : le climat dans lequel se déroule cette pratique/le rapport aux autres ; l’image de soi qu’elle renvoie/le rapport à soi, et aussi les contraintes qu’exige toute perspective d’évolution/le rapport à l’effort.
Un enjeu, réconcilier les jeunes et le sport
Les actions qui méritent d’être envisagées doivent donc s’appuyer sur une ambition : réconcilier les jeunes et les sports.
Pour cela, trois grandes idées méritent d’être mises en œuvre autour d’une philosophie qui consiste à fidéliser ces jeunes collégiens à la pratique sportive en valorisant un engagement indissociable de la présence apaisée et rassurante des autres, en proposant des formes de pratique sportive ouvertes à une diversité d’expériences ne se limitant pas exclusivement à la confrontation aux autres et en co-construisant avec les pratiquants les conditions de leur entrainement.
Pourquoi alourdir le travail des équipes pédagogiques plutôt que d’augmenter l’offre de formation existante
La circulaire insiste sur la responsabilisation de la communauté éducative dans la mise en œuvre de son déploiement. Mais, pourquoi ne pas carrément augmenter, dans ces lieux d’éducation, le nombre d’heures d’EPS et agir afin que le plus grand nombre des élèves intégrant ses collèges se licencient à l’AS de l’établissement ? Pourquoi alourdir, avec l’introduction d’un nouveau partenaire, le travail des équipes pédagogiques alors que l’augmentation de leurs moyens d’agir leur permettrait de renforcer une efficacité déjà en place ? Pourquoi ne pas s’appuyer sur « la carte passerelle », une sorte de visa sportif déjà existant, qui permet aux jeunes licenciés à l’AS d’un collège d’aller voir dans les clubs qui ont adhéré à ce dispositif si une offre sportive correspond à leurs attentes ?
Développer un mode de vie sportif et profiter des bienfaits qui s’y associent
Toutes actions correctement ciblées et englobant à la fois le collège et les liens avec les clubs environnants s’associent à des enjeux politiques et éducatifs qui en valent la peine. A court terme, elles permettraient à ces jeunes décrocheurs sportifs de retrouver le goût de la pratique, de développer un mode de vie sportif et de continuer à profiter des bienfaits qui s’y associent : l’entretien d’une meilleure santé, le développement de compétences sociales, une meilleure estime de soi et de meilleures performances scolaires. A plus long terme, on sait que des jeunes sportifs ont plus de chance de devenir des adultes sportifs que ceux qui ne le sont pas et, quand ils ont des enfants, ces derniers à leur tour deviennent plus fréquemment sportifs que ceux qui ont des parents qui ignorent le sport.
En s’appuyant sur un diagnostic pertinent, les moyens à engager semblent dérisoires face aux multiples bénéfices qui peuvent être envisagés.
Maxime Travert











