
Régulièrement paraissent des ouvrages qui réactivent la tradition de critique radicale de l’école. C’est le cas du dernier opus de Bertrand Ogilvie intitulé Inclassable enfance qui est tout autant une réflexion sur l’enfance que sur la façon dont l’école la dénature et l’éteint, afin de pouvoir finaliser son projet de maintien d’un ordre social dominant.
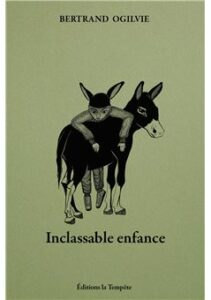
À ceci s’ajoute une coordonnée conjoncturelle : l’accélération de la destruction de l’école publique par le rouleau compresseur néolibéral nous incite à sauver ce qu’il en reste, avant de réfléchir à sa refondation.
Dans ce dialogue de sourds, que faire des critiques radicales de l’école ?
La fabrique des ignorants
« À l’école, on apprend rien » … La phrase, en quatrième de couverture d’Inclassable enfance est une petite provocation qui s’inscrit dans une longue tradition critique. Déjà en 1971, dans un singulier conte pour enfants intitulé Ah ! Ernesto, Marguerite Duras racontait l’histoire d’un petit garçon refusant d’aller à l’école car on y apprend ce qu’il ne sait pas. Pas besoin d’école dit-il, il apprendra tout ce dont il a besoin « par la force des choses ». Un conte adapté par le couple Huillet-Straub dans un court-métrage, En rachachant. Bernard Ogilvie reprend à son compte cet apparent paradoxe. Comment un lieu de transmission de savoirs pourrait-il ne produire que de l’ignorance ? C’est que l’école, en confisquant l’enfance, produit un « enfant ignorant », celui dont elle a besoin pour pouvoir le remplir ensuite de connaissances dont il ne fera rien s’il refuse de jouer le jeu de la compétition sociale. En somme, l’école ne laisse pas d’autre choix à l’enfant que d’abandonner ce qu’il sait. C’est toute sa perversion.
L’évaluationnite aiguë qui la saisit n’est qu’un moyen de contrôler cette progressive mise en conformité avec les normes scolaires. L’école désapprend l’enfance à l’enfant. Pourquoi pas. En cela, Ogilvie rejoint les réflexions sur la politisation de l’enfance dont nous avons déjà parlé ici.
Haro sur l’école publique
L’école publique française est singulière par son histoire qui la noue intrinsèquement au politique. La période révolutionnaire lui assigne en effet une mission d’émancipation par le savoir rationnel, lequel déjouerait potentiellement les assignations de classes, et contribuerait à fabriquer une citoyenneté éclairée dont la révolution a besoin pour se perpétuer. Ce lien spécifique en fait une institution traversée par une perpétuelle tension : sommée de croire en cet idéal subversif tout en se mettant au service d’une cause politique qui appelle l’obéissance plutôt que la résistance.
Depuis plus de deux siècles, cette tension lui vaut des accusations et critiques qui sont comme des rappels à l’ordre. La mouvance libertaire appelle à se libérer des effets carcéraux d’une institution inféodée à l’État ; et plus généralement, la gauche pointe le modèle bourgeois véhiculé par l’école. À chaque fois se pose la question de savoir quoi faire de cette institution ? La détourner ? La déserter ?
Des best-sellers dans les années 1970 ont déjà tenté des réponses ; et, parmi eux, les deux livres emblématiques suivants : Ivan illich, Une société sans école, et Alexander Neill, Libres enfants de Summerhill. Le premier propose de déconcentrer les lieux d’apprentissages de savoirs pour ne plus les réserver à l’école comme institution centrale ; le second rend compte d’une expérience d’école libertaire fondée dans les années 1920 en Angleterre, reposant sur l’autogestion, et la centralité de la volonté des enfants dans l’acte d’apprendre.
D’autres ont plutôt opté pour une sorte de sabotage. C’est le cas d’Élise et Célestin Freinet, farouches défenseurs de l’école publique, et tous deux militants politiques communistes (et libertaires) qui conçoivent une « pédagogie prolétarienne », soucieuse de la créativité enfantine et tournée en priorité vers les enfants pauvres[1]. Avant d’être contraints, par le harcèlement administratif, à fonder leur propre école à Vence, le couple Freinet a toujours parié sur la possibilité d’agir de l’intérieur même de l’institution. Ce dont s’inspirera un peu plus tard la pédagogie institutionnelle.
Bertrand Ogilvie semble plaider pour cette option du détournement de l’institution, et pour cela, appelle à une révolution copernicienne des pratiques sur lesquelles nous ne pouvons qu’être d’accord : en finir avec l’évaluation, faire de l’école une sorte d’atelier dans lequel les élèves apprendraient à utiliser l’enseignant plutôt qu’à lui obéir comme à un curé etc. Mais les enseignants prennent un peu cher dans ce livre, envisagés comme des agents englués dans leurs routines, souvent satisfaits de leur rôle de censeurs, et surtout manquant de courage pour s’opposer à une hiérarchie inoffensive. Ce qui est très discutable au regard de du néolibéralisme autoritaire qui se déploie aussi contre eux.
Qui a encore besoin d’école ?
En France la critique radicale de l’école tourne un peu en rond. On ressasse à l’envi les métaphores de la prison, des casernes, du « grand enfermement », de la disciplinarisation des corps etc. Sous prétexte de fustiger la reproduction sociale, la critique est si totale et globalisante qu’elle invisibilise un point nodal : les enfants (de) riches sont-ils mis autant en danger que les enfants (de) pauvres ?
Il est évident que les premiers s’en sortent nettement mieux que les seconds. D’abord parce que les savoirs d’enfants issus des familles à fort capital social et/ou culturel sont nettement plus conformes aux attentes de l’école. Ensuite parce que les enfants des classes populaires ne disposent pas des stratégies de fuite des classes favorisées : pouvoir dépenser au bas mot un demi-smic pour s’offrir une école « alternative, ouverte, à pédagogie active, bienveillante, Montessori, Freinet, Steiner, Freire et tous les noms possibles de pédagogues transformés en labels ».
En 1967 paraît un véritable pavé dans la mare en Italie, traduit dans la foulée en France : Letterera a una professora.
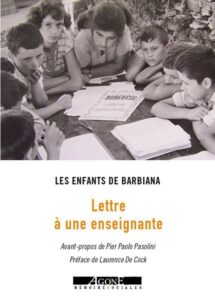
Ceci pour alerter sur un principe de vigilance qui ne minore en rien l’intérêt de maintenir les utopies éducatives dans les débats intellectuels sur l’école ; mais qui rappelle que la portée émancipatrice des propositions n’est possible qu’à certaines conditions : la gratuité, l’égale dignité des savoirs dans l’école (intellectuels, manuels, populaires), la lutte contre toutes formes de discriminations (sociales, raciales, de genre, géographiques etc.).
Laurence De Cock
[1]J’en profite pour signaler à Bertrand Ogilvie que la pédagogie Freinet n’est pas née de sa blessure respiratoire comme aime le véhiculer la légende, mais d’un engagement politique nourri au Front et déployé dès les années d’après-guerre dans différentes revues, dont Clarté et École émancipée.

Pour recevoir notre newsletter chaque jour, gratuitement, cliquez ici.











