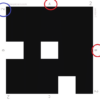Le 6 février 1973, il y a cinquante ans jours pour jours, avait lieu la tragédie du collège Pailleron. Laurence De Cock, enseignante, historienne de l’éducation prépare un ouvrage sur le bâti scolaire à l’aune de cet incendie. Elle livre, en exclusivité, au Café pédagogique ses premiers éléments d’analyse.
Dans le cimetière de la rue d’Hautpoul du 19ème arrondissement parisien, la tombe de la petite Marianne est encore régulièrement entretenue. Des fleurs y sont posées près d’un angelot tenant un violon au côté d’une photo-médaillon de la jeune musicienne. Un peu plus loin le nom de Nathalie commence, lui, à s’effacer sur une pierre tombale familiale, grise, vide. Marianne et Nathalie sont décédées le 6 février 1973 à quelques centaines de mètres du cimetière, lors de l’incendie du collège Pailleron. 14 autres enfants ont trouvé la mort ce soir-là, ainsi que 4 adultes. Il y a très peu de traces de cet évènement dans le quartier ; et encore moins dans la mémoire collective. Pourtant, ce drame est bien plus qu’un fait divers. En retracer l’histoire permet de lui conférer une dimension politique pleine de résonnances au présent.
Consumé et effondré en moins de trente minutes
L’incendie du collège Pailleron s’est déclaré à 19h30 après une séance de ciné-club autour du film Alexandre le Bienheureux. À cette heure-ci, le collège aurait dû être vide. Mais le conservatoire avait décidé d’y délocaliser ses cours du soir. Ce pourquoi une cinquantaine d’enfants, avec leurs enseignants, se trouvaient sur les lieux lors de l’incendie. Aux dires des témoins, le collège s’est consumé et effondré en moins de trente minutes, ce dont les archives de police attestent. Dans la salle d’information et de commandement, on note minute par minute le déroulé des évènements. Alertés par des témoins à 19h54, la police pense pendant longtemps que tous les enfants ont été évacués et que les quelques-uns intoxiqués ont été emmenés dans les hôpitaux environnants. Le bâtiment est annoncé comme détruit à 20h19 mais l’incendie se poursuit. Le couperet tombe vers 22h lorsque les pompiers annoncent dégager des corps et que commence un funeste comptage rendu définitif à 2h du matin.

Beaucoup d’enfants, réfugiés sur la terrasse du premier étage, sont sauvés par les pompiers et des parents en contrebas qui leur intiment de sauter dans leurs bras. Mais les autres, ne connaissant pas les lieux, et face à la vitesse de propagation du feu, ne peuvent pas quitter le collège à temps. Ils restent piégés dans une forêt métallique.
Quelques jours plus tard, deux élèves du collège, Marc et Patrick, finissent par avouer l’un sa complicité, l’autre sa culpabilité. C’est Patrick, 14 ans, qui a mis le feu à l’aide de white spirit acheté à l’épicerie du coin. Il en avait assez, raconte-t-il à la police, d’être le bouc émissaire des enseignants et voulait se venger car on menaçait de le mettre dans « la classe des déchets », le surnom donné à la classe des élèves les plus en difficulté. Mais il ignorait évidemment que des enfants se trouvaient sur place. Pendant quelques jours, il était resté suspendu dans le déni : cela ne pouvait pas être lui, répondait-il, le feu avait eu trop de mal à démarrer dans la corbeille de papier. Patrick ne voulait pas faire de mal à des camarades collégiens, il souhaitait rendre les coups à une école qui ne voulait pas de lui : « j’étais la bête noire, je voulais me venger » avait-il confié.
Cependant les aveux ne suffisent à calmer ni les familles, ni les organisations de parents d’élèves ou de lycéens, ni les médias qui, dès le lendemain, exigent la réponse à une autre question : non pas pourquoi le collège avait brûlé, mais pourquoi il s’était embrasé si rapidement alors que, selon les normes en vigueur, il aurait dû résister pendant 1h30 minimum.
« On risque sa peau tous les jours dans mon CES »
L’affaire prend alors une dimension nationale et se politise. Dans les quelques jours suivant l’incendie, les accusations pleuvent. Les lycéens de Bergson dénoncent dans un tract la responsabilité de Fontanet, ministre de l’Éducation nationale. Les « Anars » d’Hélène Boucher (c’est ainsi que le groupe se nomme) déclarent que « s’il nous prend envie de faire sauter les lycées, c’est qu’on y risque sa vie, c’est qu’on nous y tue d’ennui ». De nombreuses déclarations suggèrent que ce qui est arrivé à Pailleron était attendu, et surtout que le risque existe dans de nombreux autres établissements à Paris et ailleurs.

Les parents des victimes, eux, se constituent en association pour saisir la justice. Le juge d’instruction Sablayrolles, dont c’est la dernière affaire, leur promet de mener l’investigation à son terme. La colère gronde. L’accident n’a surpris ni les riverains, ni les élèves ou enseignants. Toutes et tous alertaient depuis plusieurs années sur l’état de l’établissement. Avaient été signalés des glissements de terrain, des cloisons si étroites qu’un crayon pouvait les transpercer, des panneaux de la toiture qui s’étaient envolés un jour de grand vent. Les parents avaient déjà fait plusieurs jours de grève pour alerter. Le Conseil d’administration avait fait remonter une liste de malfaçons, et ce depuis … 1970. Quelques jours avant le drame, dans une rédaction, Brigitte élève de Troisième écrivait ceci comme un funeste présage : « On risque sa peau tous les jours dans mon CES. C’est beau de moderniser mais il faut savoir s’arrêter ».
Les parents des victimes exigent la vérité sur toutes les défaillances de l’éducation nationale en matière de bâti scolaire. C’est précisément la question de la mise en danger des enfants par une institution censée les protéger qui est posée, et c’est bien en cela que l’affaire est politique. Les premiers éléments de l’enquête ne laissent aucun doute sur les carences de la construction. La structure et les matériaux utilisés expliquent la vitesse de propagation du feu.
En laissant des vides entre les planchers et les faux plafonds, ainsi qu’entre la façade et les cloisons, et en faisant communiquer entre eux ces vides, les concepteurs ont fabriqué des cheminées naturelles horizontales et verticales dans lesquelles le feu s’est propagé dans tous les sens à une vitesse fulgurante. Les poteaux porteurs, dans leur partie supérieure, n’étaient par ailleurs pas recouvert de matériaux empêchant la propagation du feu (l’amiante à l’époque). À l’intérieur des vides circulaient toutes les canalisations notamment de gaz et électricité. Enfin, du polystyrène était présent au niveau des fenêtres.
La chaleur intense a déformé les poteaux métalliques qui n’ont plus soutenu le bâtiment, lequel, construit sur 4 étages, n’a pas résisté à l’effondrement.
« Un CES par jour »
Comment expliquer un tel cumul de défectuosités dans la sécurité ? Et comment comprendre que rien n’ait été mis en place pour y remédier malgré les alertes ?
Dès les années 1950, l’institution fait face au phénomène de massification scolaire, c’est-à-dire à l’arrivée en masse d’élèves dans l’enseignement secondaire due à la croissance démographique d’abord mais aussi au volontarisme politique de démocratisation scolaire et d’allongement de l’âge de la scolarisation obligatoire. Selon le célèbre slogan du ministre Christian Fouchet en 1959, il fallait construire « un CES (collège d’enseignement secondaire) par jour, un CET (collège d’enseignement technique) par semaine, un lycée par mois ». De fait, 3225 collèges sont édifiés entre 1965 et 1985, ainsi que 1060 lycées. Construire vite devient un impératif ; mais construire bien beaucoup moins. En 1956 est créée la DESUS, Direction des équipements scolaires, universitaires et sportifs qui a pour objectif de simplifier les procédures et les réglementations. De rationnaliser en somme, surtout économiquement. Par exemple, abandonner les murs porteurs pour leur préférer des poteaux métalliques et poutres assemblées sur la base d’une même trame permet de réaliser 15 à 17 % d’économies indique l’historien Julien Cahon dans l’article « Les politiques d’industrialisation des constructions scolaires et leur remise en cause : l’exemple des lycées publics (1956-1986) ». C’est donc vers cela que se dirige le ministère : la standardisation et le préfabriqué. De fait, rien de plus facile pour construire un établissement en temps record : une structure en béton ou en métal sur laquelle on monte des éléments de planchers et des panneaux de façades. Ne reste plus qu’à mettre en concurrence des entreprises par appels d’offre. C’est ainsi que plus d’une centaine de collèges et lycées ont été construits exactement sur le modèle du CES Pailleron et plus de 700 autres de manière un peu différente mais avec une construction modulaire métallique également.
C’est tout ceci que dénonce l’association des parents des victimes de l’incendie, avec des investigations rigoureuses et une ténacité étonnante malgré les entraves régulières des autorités : refus de donner des informations, rapports biaisés, accusations faites aux parents d’être manipulés par les communistes et les gauchistes …
 Au final, ces derniers réussissent à faire inculper pour homicides et blessures involontaires deux dirigeants de l’entreprise constructrice, deux architectes, un cadre de Gaz de France, deux responsables du service constructeur de l’académie ainsi que l’adjoint du directeur et le directeur de la DESUS, en tout neuf personnes. Tous plaident non coupables. Ils arguent de la confusion généralisée des responsabilités dans le choix des matériaux, de la construction et de la sécurité, ainsi que du manque de coordination. Le procès des « enfants » (qu’ils ne sont plus) a lieu en 1977. Les avocats de l’association des familles de victimes refusent d’y plaider car ils y voient un prétexte pour ne pas juger les vrais responsables. Ils sont condamnés à cinq ans (Patrick) et quatre (Marc) ans de prison avec sursis et sortent libres. Celui des adultes, « le vrai procès » comme titre L’humanité commence un mois plus tard. C’est « le chœur des innocents » titre L’Aurore le 18 novembre 1977 tant aucun des neuf inculpés ne concède quoi que ce soit durant les cinq semaines du procès. Le substitut du procureur réclame des peines très modestes. De fait, cinq accusés écopent de prison avec sursis et sont par la suite amnistiés.
Au final, ces derniers réussissent à faire inculper pour homicides et blessures involontaires deux dirigeants de l’entreprise constructrice, deux architectes, un cadre de Gaz de France, deux responsables du service constructeur de l’académie ainsi que l’adjoint du directeur et le directeur de la DESUS, en tout neuf personnes. Tous plaident non coupables. Ils arguent de la confusion généralisée des responsabilités dans le choix des matériaux, de la construction et de la sécurité, ainsi que du manque de coordination. Le procès des « enfants » (qu’ils ne sont plus) a lieu en 1977. Les avocats de l’association des familles de victimes refusent d’y plaider car ils y voient un prétexte pour ne pas juger les vrais responsables. Ils sont condamnés à cinq ans (Patrick) et quatre (Marc) ans de prison avec sursis et sortent libres. Celui des adultes, « le vrai procès » comme titre L’humanité commence un mois plus tard. C’est « le chœur des innocents » titre L’Aurore le 18 novembre 1977 tant aucun des neuf inculpés ne concède quoi que ce soit durant les cinq semaines du procès. Le substitut du procureur réclame des peines très modestes. De fait, cinq accusés écopent de prison avec sursis et sont par la suite amnistiés.
Et aujourd’hui ?
Il faut vraiment s’approcher pour trouver la stèle commémorative déposée devant le collège Pailleron reconstruit en 1979. Un arbre y a été planté pour « symboliser le combat des familles et pour que pareil drame ne puisse se reproduire ».
« Ici brûla le CES Pailleron » peut-on lire sur la plaque, sans qu’aucune responsabilité n’apparaisse clairement, comme s’il ne s’agissait que du produit de la fatalité.

Pourtant les faits sont clairs : face à la massification, l’Éducation nationale a privilégié une logique de rentabilité et d’économie. Tout cela ne peut que faire écho aux alertes plus récentes de la part des élèves et personnels qui travaillent dans des conditions matérielles indignes, surtout dans les quartiers populaires. Que l’on pense au lycée Voilaume à Aulnay Sous-Bois et aux nombreuses photos d’autres établissements qui circulent sur les réseaux sociaux : collège Lavoisier à Pantin, lycée Jacques Feyder à Epinay, Université Paris-est Créteil : bâtiments délabrés, non chauffés, préfabriqués avec fils électriques apparents, fuites d’eau, sanitaires à l’abandon etc. Combien d’alertes via les conseils d’administration et la presse ? Combien de signalements restés sans réponses ? Devra-t-on attendre un autre drame ?
Administration centrale et collectivités territoriales se renvoient la balle des responsabilités. C’est bien pratique, et c’était déjà le cas il y a 50 ans. Traditionnellement l’enchevêtrement administratif est avancé pour justifier les blocages et l’inertie des autorités. C’est tout de même un argument bien chiche et surtout pleutre au regard de ce que risquent les enfants et de ce qu’une puissance économique comme la France pourrait allouer comme moyens pour l’école publique.
Il est peut-être temps de mettre cette question au cœur des combats pour une éducation nationale digne de ce nom.
Laurence De Cock, enseignante, historienne de l’éducation prépare un ouvrage sur le bâti scolaire à l’aune de l’incendie du collège Pailleron.
Liste des victimes :
Les enfants : Eric Bakon (9 ans), Pierre Binet (11 ans), Christine Causse (10 ans), Eric Chapelet (11 ans), Jacques Charpentier (10 ans), Olivier Ciora (15 ans), Isabelle Darmon (10 ans), Marianne Debreux (13 ans) ; Hugues de Taillandier (8 ans), Eliane Falco (13 ans), Isabelle Fort (8 ans), Jean-Michel Frenoy (10 ans), Brigitte Navarre (10 ans), Sheila Maria Pereira (7 ans), Nathalie Rohner (8 ans), Jeanne Simoni (9 ans).
Les adultes : Michèle Durot (35 ans), Max Giquel (29 ans), Denise Georgeron (38 ans) et Agnès Iwanicki (âge inconnu).
Crédits photos : Image 1 : Photo prise par la police, 7 février 1973, Archives de la Préfecture de Paris, FG9 Image 2 : Tract des parents d’élèves du groupe scolaire Armand Carrel, APP, FG9 Image 3 : Dessin paru dans Rouge, 5 octobre 1977, APP, FG9 Image 4 : Photo prise par Laurence De Cock le 15 janvier 2023