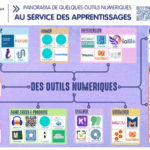A des années lumière des clichés attendus sur la banlieue, des représentations remplies de fracas et de fureur, et des images enfermées dans un présent sans avenir, Alice Diop, cinéaste française d’ascendance sénégalaise, née en 1979 à Aulnay-sous-Bois, entame avec « Nous » un voyage au long cours en suivant la ligne B du RER. A la rencontre des habitants différents, des ‘gens de peu’, de leurs récits, de leurs mémoires, dans des lieux disparates, improprement désignés sous le même vocable, rarement filmés avec autant d’attention et d’amour. Et, la documentariste, arpenteuse ‘obsessionnelle’ des territoires de son enfance en Seine-Saint-Denis depuis 2005 [« La Tour du monde »], élargit son horizon et le nôtre, en construisant sous nos yeux l’esquisse d’une archive familiale, en enregistrant des traces d’autres ‘vis minuscules’ jamais entendues, ni regardées. Ainsi « Nous » relie-t-il l’existence d’êtres humains ordinaires, vivant à la lisière les uns des autres avec des espaces imprégnés de l’histoire de notre pays (le mémorial de la Shoah à côté du camp de Drancy, la basilique Saint-Denis, où sont enterrés les rois de France, les mémoires des descendants des vagues d’immigration italienne, maghrébine ou subsaharienne…). Alice Diop nous laisse alors entrevoir, avec patience et acuité, le visage composite d’un autre ‘Nous’. Un geste à la fois sensible et politique d’inscription dans l’histoire de France. Un chemin exigeant ‘vers la tendresse’.
Le long de la ligne B du RER au fil des rencontres
 D’emblée, le silence de l’attente et la patience de l’observation. En plan fixe rapproché un homme d’âge mûr cadré de profil scrute le lointain à la jumelle. En plan large, à l’orée d’une forêt touffue, nous tentons de déceler ce qu’il fixe ainsi. Bientôt rejoint par un jeune garçon et une femme, il devine l’apparition fugace d’un cerf à peine visible entre les branches feuillues. Une séquence inaugurale en forme d’invitation aux spectateurs : il faut du temps et de la patience pour découvrir les secrets recouverts par l’obscurité de la forêt et en décrypter les signes.
D’emblée, le silence de l’attente et la patience de l’observation. En plan fixe rapproché un homme d’âge mûr cadré de profil scrute le lointain à la jumelle. En plan large, à l’orée d’une forêt touffue, nous tentons de déceler ce qu’il fixe ainsi. Bientôt rejoint par un jeune garçon et une femme, il devine l’apparition fugace d’un cerf à peine visible entre les branches feuillues. Une séquence inaugurale en forme d’invitation aux spectateurs : il faut du temps et de la patience pour découvrir les secrets recouverts par l’obscurité de la forêt et en décrypter les signes.
Reprenant par les moyens du cinéma la démarche littéraire de l’écrivain François Maspero [‘Les Passagers du Roissy-Express’, photographies d’Anaïk Frantz, Seuil, 1990], Alice Diop entame un voyage, à la fois documenté et vagabond, suivant la ligne B du RER reliant le Nord au Sud de la région francilienne, des tours des grands ensembles aux maisons confortables de la vallée de Chevreuse en passant par les cités ouvrières aux zones pavillonnaires. Avec les grondements constants du RER roulant sur les rails en fond sonore et des plans réguliers des lignes et des gares desservies, il s’agit pour l’exploratrice aguerrie et attentive de suivre le parcours du RER et de s’arrêter régulièrement au gré des changements de paysages pour aller à la rencontre des habitants, de les écouter, de les regarder vivre et de les filmer.
En plans larges et fixes, la caméra alliant le lointain et le proche, s’attarde régulièrement sur les visages et les gestes, leurs infimes expressions, des protagonistes. Ainsi suivons-nous Ismaël, qui dort dans un camion, en train de savourer au petit matin seul au troquet du coin le café fumant. Le mécanicien répare sans grand succès avec une patience infinie des voitures en piètre état. Penché sous le capot d’un véhicule, il sursaute à la sonnerie de son portable et entreprend le corps incliné, la voix tremblante et douce une conversation avec sa mère, toujours au pays (pas très loin de Bamako, comme il le précise en répondant à la question en off de celle qui le filme). Et sa voix à peine audible se fait tendre murmure rassurant sur sa situation sans autre précision entrecoupée de ‘Amen’ et d’‘Inch Allah’ tandis que ses yeux clairs et brillants dans un visage anguleux et marqué se brouillent et qu’il dit ne pas être retourné au pays depuis son arrivée en France en 2001.
Sans transition nous pouvons nous retrouver à la basilique Saint-Denis le jour anniversaire de la mort de Louis XVI et percevoir sur le visage attentif au sermon du prêtre lisant la dernière lettre testamentaire du roi la gravité et le geste furtif d’une dame bien mise séchant une larme qui perle. Nous ne décelons cependant aucune moquerie ni volonté de ridiculiser l’assistance à cette étrange cérémonie mais le signe chez la ‘regardeuse’ d’une expérience insolite. L’engendrement de son projet artistique s’affine pourtant au fil des séquences. Des plans larges au temps immobile : architectures aux arrondis harmonieux d’un ensemble urbain sans grâce, petits monticules d’herbes ensoleillés près de hautes tours, morceau de terrain lumineux ombragé de quelques arbres, pavillons agrémentés de barrières et de jardinets fleuris, forêts profondes aux gibiers convoités, maison confortable en pleine nature en bordure de l’Yvette…. Ces plans lumineux, cadres naturels ou urbanisés, nous apparaissent dotés d’une beauté et d’un charme que l’œil de la cinéaste sait capter. Cette dernière ponctue de cette délicate manière les vies ‘ordinaires’ vouées à l’effacement, réduites à l’invisibilité ou renvoyées à des représentations caricaturales, si elles ne les avaient pas filmées.
Récits fragmentaires, mémoires effacées, à la découverte d’univers singuliers
Il faut encore du temps pour que cette vieille veuve bretonne aux traits abîmés, au regard qui s’égaille, confie en quelques phrases l’échec d’un premier amour qui l’avait conduite à quitter sa région natale pour la capitale et sa rencontre décisive dans le café où elle était serveuse avec un ouvrier immigré d’Italie pour trouver du travail. Et comment cet homme l’a sauvée alors qu’elle se jetait d’un pont, la raccompagnait chaque soir pour éviter qu’elle ne répète son geste avant d’aller avec elle au cinéma (puisque la danse interdite par sa mère elle ne l’avait pas apprise) et de l’épouser.
D’autres bribes de vies esquintées surgissent chez les personnes âgées que la sœur, infirmière, de la documentariste, visite. Avec une caméra discrète et pudique pénétrant dans des lieux étroits encombrés de souvenirs et laissant hors champ les soins du corps pendant la toilette accompagnée de la voix dynamique et stimulante de celle qui réveille les solitudes. Jusqu’à cet échange déroutant et bouleversant d’un vieil homme, veuf encore dans le chagrin, expliquant à la même infirmière l’incitant à sortir qu’il déteste les sorties entre vieux organisées par la mairie.
Blancs, Noirs, Arabes, Asiatiques, anciennes et nouvelles générations, filles et garçons, habitants à la lisière d’espaces disparates ou résidents dans des lieux différents, celles et ceux qu’Alice Diop rencontre ont ‘droit de cité’, envahissent le cadre en des silences parlants, de lentes confidences, des gamineries joyeuses, telles celles des jeunes Noirs prenant le soleil torse nu sur un talus avant de placer un carton dans leur dos pour assurer la meilleure glissade. Des pas de danse chaloupés esquissés dans un demi-sourire par des jeunes gens aux chevelures sombres et au regard rieur se levant de leur transat en entendant ‘La Foule’ d’Edith Piaf et en reprenant quelques paroles. Sans oublier les trois filles assises en tailleur près d’un mur d’immeuble jouant aux cartes et avec leurs portables tout en échangeant sur leur vie amoureuse, notamment. A mots couverts ou franchement dans la durée d’un plan qui prend son temps.
De l’intime au collectif, le cinéma, art de réparation et acte d’engagement
Diplômée en histoire et en sociologie, intégrée à l’atelier documentaire de la Fémis, Alice Diop construit une voie singulière, loin de l’immersion prolongée sans commentaire ni explication à la Frederik Wiseman par exemple. Son parcours personnel, ses origines font intrinsèquement partie de la démarche artistique et du geste politique qui en est le fondement. Née en France d’une mère et d’un père qui ont quitté le Sénégal, leur pays natal, au cours des années 60, la réalisatrice nous fait découvrir peu à peu la relation intime, affective, entretenue avec les personnes filmées. Lors de sa première intervention dans le film (même s’il y a eu les quelques mots échangés avec Ismaël), elle évoque en voix off la vie difficile de sa mère femme de ménage, morte il y a vingt-cinq ans, et dont il ne reste que quelques traces audiovisuelles dans des films de famille, des vidéos dans lesquelles la fille cherche en vain la présence à l’écran tant cette mère affairée est presque toujours hors champ ou au bord du cadre, en un tremblé précaire au diapason de son existence.
Pour ce qui est de son père, cheveux blanchis et beau regard clair, Alice Diop l’a filmé quelque temps avant sa mort et nous livre l’échange en un moment très émouvant à double titre : c’est sans doute la première fois qu’elle tient une caméra et c’est la première fois que son père d’une voix calme en quelques phrases courtes revient sur son arrivée en France et le bilan de ses quarante ans de travail ouvrier. A la demande sa fille. Il lui montre le billet de bateau pour Marseille, seul moyen de transport possible, compte tenu du prix de l’avion. Il évoque les petits boulots alimentaires, le travail sans interruption et sa satisfaction d’avoir pu acheter la ‘maison’ pour la transmettre à ses enfants. A un autre moment, la réalisatrice se souvient en voix off du moment où elle a annoncé à son père que, contrairement à ses parents, elle ne souhaitait pas être enterrée au Sénégal mais en France ‘où vivraient ses enfants’. Elle se souvient aussi du silence paternel qui a suivi.
Lorsque nous voyons pour la première fois à l’écran, filmée en plan large, assise à la grande table en bois surplombée par une immense bibliothèque débordant de livres, aux côtés de l’écrivain et historien Alain Bergounioux, dans sa maison à Gif-sur-Yvette, Alice Diop écoute l’auteur lire des passages (choisis par elle) de ses « Carnets de notes, 2016-2021 » [éditions Verdier]. Et elle confie qu’elle sait maintenant, au regard de la démarche littéraire de son interlocuteur, ce qu’elle a voulu : ‘devenir cinéaste pour réparer l’absence de traces qu’il me reste de mes parents.
A l’écoute de la bande-son dominée par le grondement du RER B ponctué par les musiques d’Angel Amato, Alpha Blondy, Edith Piaf (‘La Foule’) ou Jean Ferrat (‘Ma France’), et en regardant l’infinie patience et acuité avec laquelle la documentariste entend et regarde celles et ceux qu’elle filme, ce travail intime sur la place effacée de ses parents venus du Sénégal vivre et travailler en France lui ouvre le chemin pour mettre au jour d’autres existences vouées à l’invisibilité, qui ont fait et font la richesse du pays, en dessine de proche en proche les visages anciens et neufs de l’attachement à la France, en un portrait composite et amoureux.
La documentariste revendique d’ailleurs l’influence majeure à ce titre du cinéma de Maurice Pialat et de « L’Amour existe », documentaire de 1960 composant un portrait en Noir et Blanc saisissant de la banlieue accompagné d’un texte écrit par le cinéaste et lu en voix off. Et elle ajoute : « mes films pourraient presque prolonger cette voix magnifique qui raconte l’intimité et l’amour profond qu’on peut avoir pour ces lieux et leurs habitants. Elle est comme une prière qui leur est adressée. C’est le film fondateur. Il me fait systématiquement pleurer : je comprends à chaque fois pourquoi je suis rentrée en cinéma, en quoi c’est un geste d’hommage à ceux qui ont disparu et à ce qui a disparu ». Avec « Nous » et ses œuvres précédentes, Ali Diop nous donne à espérer que les ‘gens de peu’, les vies invisibles prennent la lumière et entrent dans l’Histoire.
Samra Bonvoisin
« Nous », film documentaire d’Alice Diop-sortie le 9 février 2022
Prix du meilleur documentaire et Prix Encounters Berlin 2021
=>Carte blanche à Alice Diop avec 11 films choisis par la réalisatrice et rencontres avec des cinéastes aimés au Centre Pompidou du 11 au 14 février 2022