Enseignant d’histoire-géographie dans un lycéen Rémy Pawin est chargé de conférences à Sciences-Po Paris. Agrégé et docteur en histoire contemporaine, il a travaillé sur l’idée du bonheur en France.
Vous avez publié l’ouvrage Histoire du bonheur en France de 1945 à nos jours. Pourriez-vous nous expliquer comment le bonheur est devenu la valeur centrale de la société française contemporaine ?
 Peu légitime au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le bonheur n’est encore qu’une « idée neuve » largement déconsidérée. Mais il s’impose en effet et mon travail souligne l’importante modification des systèmes normatifs dans la France du second XXe siècle : transcendance dans l’immanence, le bonheur devient la norme des normes et l’idée régulatrice suprême, au cours d’une irrésistible ascension, qui découle de la déprise des valeurs concurrentes et de la promotion de la vie heureuse – par voie d’argumentations et d’instrumentalisations. Le devoir de bonheur triomphe et les Français s’y convertissent. Les pratiques sont transformées, au nom du bonheur qu’elles doivent procurer à l’acteur, si bien qu’il devient une norme effective : les individus tentent de la respecter et d’être heureux.
Peu légitime au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le bonheur n’est encore qu’une « idée neuve » largement déconsidérée. Mais il s’impose en effet et mon travail souligne l’importante modification des systèmes normatifs dans la France du second XXe siècle : transcendance dans l’immanence, le bonheur devient la norme des normes et l’idée régulatrice suprême, au cours d’une irrésistible ascension, qui découle de la déprise des valeurs concurrentes et de la promotion de la vie heureuse – par voie d’argumentations et d’instrumentalisations. Le devoir de bonheur triomphe et les Français s’y convertissent. Les pratiques sont transformées, au nom du bonheur qu’elles doivent procurer à l’acteur, si bien qu’il devient une norme effective : les individus tentent de la respecter et d’être heureux.
Sur le plan des normes, j’ai comparé les évolutions françaises à celles du monde occidental : d’une part, la France appartient aux pays développés de l’Ouest et ce sacre du bonheur touche également les pays voisins – géographiquement et culturellement. D’autre part, la spécificité française est apparue à plusieurs reprises : la norme du bonheur y rencontre de plus fortes oppositions qu’ailleurs, en raison de la force de l’humanisme – refusant au bonheur le statut de suprême désirable – et de la concurrence vécue par les Français avec l’idéologie américaine qui, la première, a consacré le bonheur. De même, les destructions de la guerre, la brusque modernisation et l’hystérésis des traditions nationales expliquent la temporalité propre à la France dans le concert des nations.
Plus spécifiquement sur la période des Trente Glorieuses, vous avez analysé les représentations et les expériences du bonheur en France. Que pourriez-vous nous livrer de votre travail ?
Mes travaux portaient notamment sur les sentiments éprouvés par les Français et tentaient de rendre compte des bonheurs des Français, en traitant des récits qui mettent en forme leurs expériences et des couleurs de leur vécu. Je me suis ainsi intéressé aux enquêtes de bien-être subjectif, qui tentent régulièrement de mesurer le bien-être par le biais de questions posées à des échantillon de sondés. Peu répandu au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il se propage dès les années 1950, atteint un maximum autour de 1970, et reflue quelque peu dans les années 1970. En 1981, un sursaut indique l’importance de la composante politique dans cet indicateur. Depuis, il suit une fluctuation ascendante et les sondés se disent plus heureux aujourd’hui qu’il n’y a 50 ans.
Ces relevés constituent des jugements réflexifs synthétiques que les sondés formulent en intégrant plusieurs paramètres : la vie privée et familiale est primordiale, suivie par le domaine professionnel. Ce dernier procure le revenu, fortement corrélé au bien-être subjectif, ce qui rappelle cette sentence de Jules Renard : « si l’argent ne fait pas le bonheur, rendez-le ! » Ces deux aspects – famille et travail – déterminent avant tout la couleur du récit biographique. Mais certains aspects liés à l’espace vécu, national ou local, influencent également les bilans de satisfaction : malgré les prodromes de la déprise industrielle, il fait bon vivre à Saint-Etienne au moment où triomphent les verts. De même, la manière dont l’histoire est perçue joue un rôle sur le bien-être subjectif : les individus – et non seulement l’intellectuel engagé – se saisissent de certains événements collectifs et les interprètent pour en faire une histoire proprement subjective. Ce processus herméneutique colore leurs représentations de l’évolution historique, modèle leurs attentes, attise leur anxiété ou, au contraire, apaise leurs expériences en produisant une sérénité face à l’avenir : dans les années 1950, guerre froide et conflits coloniaux assombrissent journaux intimes et autobiographies, tandis que la conjoncture économique positivement perçue les enjolive dans les années 1960. Pour cette raison d’ailleurs, il me semble qu’il serait préférable d’en finir avec les « Trente Glorieuses » de Fourastié, pour élaborer une nouvelle périodisation du second XXe siècle.
Au-delà de la notion de bonheur, comment la notion de bien-être a-t-elle émergé dans les sciences sociales ?
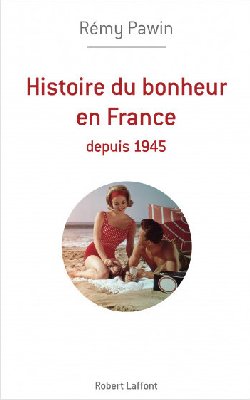 Aujourd’hui, les « sciences du bonheur » constituent un champ de recherches regroupant des spécialistes de divers disciplines humaines, sociales et expérimentales, mêlant psychologues, économistes, sociologues, philosophes, historiens, chercheurs en sciences de l’éducation, ainsi que neurologues et cogniticiens. Cette création est récente et les sciences sociales ont été longtemps rétives à s’emparer du bien-être : en France, elles ont suivi le processus de consécration de cette nouvelle valeur. Les premiers travaux sont apparus au début du XXe siècle dans le monde anglo-saxon et le champ a commencé à se constituer à partir du second XXe siècle, au sein des départements de psychologie sociale de certaines universités américaines. Dans les années 1970, l’OCDE lance les premières recherches en économie, mais elles connaissent une éclipse dans les années 1980-90, avant de renaître dans les premières années du XXIe siècle, pour connaitre le développement que l’on sait aujourd’hui.
Aujourd’hui, les « sciences du bonheur » constituent un champ de recherches regroupant des spécialistes de divers disciplines humaines, sociales et expérimentales, mêlant psychologues, économistes, sociologues, philosophes, historiens, chercheurs en sciences de l’éducation, ainsi que neurologues et cogniticiens. Cette création est récente et les sciences sociales ont été longtemps rétives à s’emparer du bien-être : en France, elles ont suivi le processus de consécration de cette nouvelle valeur. Les premiers travaux sont apparus au début du XXe siècle dans le monde anglo-saxon et le champ a commencé à se constituer à partir du second XXe siècle, au sein des départements de psychologie sociale de certaines universités américaines. Dans les années 1970, l’OCDE lance les premières recherches en économie, mais elles connaissent une éclipse dans les années 1980-90, avant de renaître dans les premières années du XXIe siècle, pour connaitre le développement que l’on sait aujourd’hui.
Comment rapprochez-vous l’éducation et le bonheur ?
A mon sens, l’éducation et le bonheur sont indissociables. Le bonheur doit constituer l’un des principaux objectifs de l’éducation : on ne dit que trop rarement qu’on peut apprendre à être heureux. Les risques d’instrumentalisation d’un tel projet éducatif sont grands, mais l’absence d’une réflexion collective et démocratique dans ce domaine me parait regrettable. D’ailleurs, dans certaines écoles primaires publiques, des enseignants innovants mettent en œuvre une pédagogie du bien-être, afin d’améliorer celui de leurs élèves. Favoriser leur épanouissement est essentiel pour deux raisons. D’une part, parce qu’une jeunesse heureuse, outre être souhaitable en soi, prépare au bonheur de l’âge adulte. D’autre part, parce que le bien-être est un levier majeur de l’apprentissage. De nombreuses études soulignent, en effet, que ce sentiment influence notamment la motivation des apprenants. Par exemple, favoriser le flow – définie par Mihalyi Czikszentmihalyi comme l’expérience optimale ressentie lorsqu’on est complètement immergé dans une activité, caractérisée par une grande impression de liberté, de joie, d’accomplissement et de compétence, et durant lequel le temps semble disparaître – est l’occasion de redonner envie aux élèves d’apprendre, d’améliorer leur gout pour l’école et, partant, peut être un outil d’amélioration du climat scolaire et de lutte contre le décrochage.
Propos recueillis par Séverine Colinet
MCF du laboratoire BONHEURS











