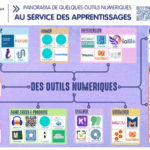Directrice d’école pendant 25 ans à Bobigny (93), Véronique Decker a vu les quartiers populaires se transformer et le rapport à l’Ecole changer. Après le discours d’Emmanuel Macron sur le « séparatisme », nous l’interrogeons sur son expérience des réticences scolaires dans les quartiers populaires, ce qui fait bouger les familles et aussi les solutions que l’Ecole peut apporter.
On accuse souvent les familles populaires de manquer d’ambition pour la scolarité de leurs enfants. Avez vous été confrontée à ce phénomène ?
 L’école se doit d’être émancipatrice, c’est à dire de faire découvrir aux enfants des possibles qu’ils n’auraient pas pu connaître avec la seule transmission de leurs parents. Ce n’est donc pas la responsabilité des familles. Je n’aime pas le terme d’ambition, qui désigne celui qui veut aller plus loin que les autres, plus haut. Je préfère permettre aux enfants des villes de découvrir la vie à la campagne, et l’inverse, aux enfants des banlieues de découvrir les quartiers huppés, et l’inverse, de faire des correspondances entre les classes, des voyages scolaires partagés, et de leur faire visiter des entreprises, de faire venir des gens qui exercent des métiers inconnus. Il est tout autant souhaitable de faire venir des employés de supermarché à Stanislas, que de faire venir une pilote de ligne à Bobigny. Les enfants, les ados, doivent découvrir le monde, tel qu’il est et pouvoir exercer des choix. Il y a peut-être un futur maraîcher dans ce lycée parisien. Il y a peut-être un danseur d’Opéra dans cette classe unique de la Creuse. Pour finir, si on veut vraiment que les classes sociales ne se reproduisent pas à l’identique, ce n’est pas en travaillant l’ambition, mais en mettant en place des dispositifs sociaux divers, comme l’étaient autrefois les IPES (les études universitaires rémunérées pour devenir professeur).
L’école se doit d’être émancipatrice, c’est à dire de faire découvrir aux enfants des possibles qu’ils n’auraient pas pu connaître avec la seule transmission de leurs parents. Ce n’est donc pas la responsabilité des familles. Je n’aime pas le terme d’ambition, qui désigne celui qui veut aller plus loin que les autres, plus haut. Je préfère permettre aux enfants des villes de découvrir la vie à la campagne, et l’inverse, aux enfants des banlieues de découvrir les quartiers huppés, et l’inverse, de faire des correspondances entre les classes, des voyages scolaires partagés, et de leur faire visiter des entreprises, de faire venir des gens qui exercent des métiers inconnus. Il est tout autant souhaitable de faire venir des employés de supermarché à Stanislas, que de faire venir une pilote de ligne à Bobigny. Les enfants, les ados, doivent découvrir le monde, tel qu’il est et pouvoir exercer des choix. Il y a peut-être un futur maraîcher dans ce lycée parisien. Il y a peut-être un danseur d’Opéra dans cette classe unique de la Creuse. Pour finir, si on veut vraiment que les classes sociales ne se reproduisent pas à l’identique, ce n’est pas en travaillant l’ambition, mais en mettant en place des dispositifs sociaux divers, comme l’étaient autrefois les IPES (les études universitaires rémunérées pour devenir professeur).
Avez vous connu des réticences à scolariser un enfant ? Quelle évolution avez vous constaté sur ce point ?
Il y avait encore des réticences à mettre les enfants en maternelle avant 4 ans lorsque j’ai commencé. Beaucoup d’enfants ne venaient qu’irrégulièrement, d’autres prenaient l’excuse de ne pas être « propres », certains ne venaient que le matin…
Puis petit à petit, les choses ont évolué avec le travail des femmes. En élémentaire, l’arrivée des allocations familiales dans l’après guerre avait vaincu les réticences de la plupart des parents.
Puis, dans les années 2000, on a commencé à avoir des réticences sur le programme : des enfants qui ne venaient pas à la piscine, des parents qui ne souhaitent pas que leur enfant étudie tel ouvrage, d’autres qui craignaient les départs en classe transplantée. L’espoir social faisait place de plus en plus place à un espoir tout entier porté par la religion, avec des religions différentes, car il y a également beaucoup de protestants, d’adventistes, d’évangéliques en banlieue. On pense toujours aux musulmans, mais les soucis arrivent de partout.
Chacun s’est mis a réfléchir à sa propre famille comme étant l’étalon de ce qui serait acceptable. Et nombre de familles ont commencé à exiger de l’école publique des aménagements divers et à menacer si elles n’étaient pas entendues.
Certaines ont sauté le pas de la scolarisation à domicile, au moins pour les petites classes, là où tout le monde croit que « c’est facile ». Mais entre les couches moyennes capables de financer une « école Montessori » à 600 euros par mois, ou une « école musulmane » au même tarif, et l’immense majorité des familles de banlieue, il n’y a jamais eu de mouvement massif de déscolarisation.
Même après la loi de 2004, où certains avaient prédit une déscolarisation massive des adolescentes musulmanes, ou la loi contre le niqab, où d’autres avaient imaginé que les enfants de ces mamans ne viendraient plus à l’école. Un petit nombre d’enfants ont effectivement « disparu » des radars, et bien que parfois ils aient été signalés à l’administration, car dans un quartier de Bobigny, par exemple, tout le monde savait que des enfants étaient scolarisés « en appartement », rien n’a été fait. Il y a eu une période de laxisme, qui ensuite à tourné à l’inverse, c’est à dire une demande de « sur signalement » des familles ultra orthodoxes après Charlie.
Par contre, après la suppression de l’IUFM par Sarkozy, et l’embauche de contractuels sans formation en position de remplaçants, la qualité de l’école publique s’est progressivement affaissée et les parents n’en ont pas été dupes : beaucoup ont commencé à faire reprendre des bases à leurs enfants à la maison, pendant les vacances, avec des associations qui ont fleuri partout en banlieue, l’argent du « contrat de ville » retiré aux écoles étant disponible aux associations. C’est à partir de là que des mamans diplômées commencent à basculer en IEF, avec de l’entraide entre mamans, qui regroupent quelques enfants ensemble. Néanmoins, malgré l’augmentation récente, le phénomène reste très minoritaire.
Et comment les expliquez vous ?
Il y a de plus en plus de familles instruction en famille (IEF), particulièrement en province, bien plus qu’en banlieue. D’abord en raison d’une exigence de personnalisation des apprentissages que l’école ne peut mettre en oeuvre, faute de formation adaptée, de lieux aménagés (on a toujours des classes de 50 m2 dans lesquelles on entasse plus de 25 enfants, soit moins de 2m2 par être humain), de matériel de différenciation (la plupart des classes ne disposent même pas de l’argent nécessaire pour racheter les manuels déchirés). Mais en banlieue aussi, le niveau d’exigence des familles monte, et les parents comprennent bien que la classe qui a été conduite par 5 remplaçants dont 3 contractuels n’a pas du tout travaillé au niveau du programme. Alors, eux aussi peuvent fuir la violence, l’anomie, le désarroi que leurs enfants leur rapportent. Mais ne l’oublions pas, ce phénomène, même s’il a été accentué par le confinement (quelques familles n’ont pas remis leurs enfants à l’école après avoir fait classe pendant plusieurs semaines), reste très très marginal, surtout dans les quartiers populaires. Il y a sans aucun doute plus d’enfants scolarisés à domicile dans l’Aveyron ou la Drôme que dans le 93.
Qu’est ce qui explique que des enfants ne soient plus à l’école du jour au lendemain ?
Je pense que cela ne se passe jamais comme cela « du jour au lendemain ». En général ce sont des décisions murement réfléchies, basées sur la protection de leur enfant face à des violences institutionnelles, ou des exigences auxquelles les familles n’adhèrent pas. Chacun veut désormais le « meilleur » pour son enfant et pour son enfant seulement. La vision de ce qui est le « meilleur » varie, mais la démarche des alternatifs et des ultra religieux reste identique : protéger sa descendance, dans un contexte anxiogène de virus, de vaccins, de peur de l’échec scolaire, de fake news relayées par les réseaux sociaux (comme une éducation à la masturbation en maternelle, par exemple) qui en dit long sur la défiance qui existe désormais entre l’école et les familles.
Quelles réponses peut on y apporter ?
En premier, la formation des enseignants : à la différenciation, à l’accueil des parents, à l’animation de rencontres, à la coopération avec le quartier. Le retour des réseaux d’aide et de la médecine scolaire qui effectuaient également toutes sortes de médiations avec les parents des enfants en difficulté psychique ou médicale.
Ensuite, l’ouverture des écoles, la fin de vigipirate et de tous les dispositifs d’interdiction d’entrer dans les écoles (même si en période COVID, cela suppose sans doute des aménagements temporaires). Toutes les solutions utiles se retrouveront sur le chemin de la coopération, de la rencontre humaine, loin des dispositifs de dématérialisation de la remise des livrets scolaires, du fichage des tests de niveau, et du stress à tous les étages.
Que pensez vous de cette phrase du rapport de l’inspection générale sur Roubaix : « les attentes fortes des familles ne s’accompagnent pas de la part des élèves du comportement qui permettrait de la satisfaire »
Je n’ai pas lu ce rapport, mais ce que je comprends, c’est que les familles attendent de l’école un ascenseur social, une réussite scolaire, sans construire avec leurs enfants les compétences et les qualités humaines nécessaires pour aboutir un bon parcours scolaire. Certains parents voudraient que leur gamin fasse l’ENA mais sans jamais l’emmener à la bibliothèque, sans le coucher à l’heure le soir, sans vérifier qu’il a bien ses lunettes dans son sac. Résultat, l’enfant est confronté à une double injonction : celle d’être frais et disponible en classe, de pouvoir trouver le matériel et la disponibilité mentale nécessaire aux apprentissages, et à son domicile, un laisser aller devant la télé, les jeux vidéos, et un désintérêt pour l’exigence, car au fond, les parents sont, eux, déjà découragés par une situation économique et sociale faite de précarités sans lendemain.
Les attentes de certaines familles sont parfois désespérées : toutes ont de l’ambition, mais beaucoup ne savent pas du tout quel chemin d’exigence il est nécessaire de s’infliger pour contrarier le destin social. Parfois, ces contradictions sont à la base du décrochage scolaire ou des phobies scolaires. L’enfant ne sait plus vers où se diriger, sans cesse soumis à ces injonctions contradictoires. Il serait nécessaire d’avoir des psychologues scolaires disponibles, en nombre suffisant, de l’école maternelle au collège, pour aider les équipes et les familles à s’accorder avec les enfants.
Propos recueillis par François Jarraud