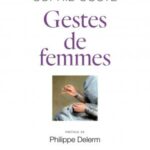L’enseignement du français au lycée a été frappé par un séisme : les programmes 2019, rétrogrades, écrasants, contraignants, sapent des décennies de réflexion et de travail didactiques, le bonheur d’enseigner et le désir d’apprendre. Peut-on sauver les meubles ? Peut-on entendre la détresse des enseignant.es et des élèves pour mieux aller de l’avant ? Samedi 30 novembre, l’association historique AFEF et le jeune collectif Lettres vives ont organisé une journée commune pour tenter de revivifier les forces du français au lycée. En particulier autour de deux questions : comment s’emparer de l’écriture d’appropriation ? quelles perspectives pour l’enseignement de la langue ? Un point d’étape lucide, stimulant, volontariste, à quelques jours de possibles annonces d’ajustements ministériels…
L’enseignement du français au lycée a été frappé par un séisme : les programmes 2019, rétrogrades, écrasants, contraignants, sapent des décennies de réflexion et de travail didactiques, le bonheur d’enseigner et le désir d’apprendre. Peut-on sauver les meubles ? Peut-on entendre la détresse des enseignant.es et des élèves pour mieux aller de l’avant ? Samedi 30 novembre, l’association historique AFEF et le jeune collectif Lettres vives ont organisé une journée commune pour tenter de revivifier les forces du français au lycée. En particulier autour de deux questions : comment s’emparer de l’écriture d’appropriation ? quelles perspectives pour l’enseignement de la langue ? Un point d’étape lucide, stimulant, volontariste, à quelques jours de possibles annonces d’ajustements ministériels…
Que faire des nouveaux programmes de français ?
En ouverture de la journée, Isabelle Henry, de l’Association Française pour l’Enseignement du Français, et Mathieu Bilière, du Collectif Lettres vives, livrent leurs analyses sur les nouveaux programmes mis en œuvre au lycée depuis la rentrée 2019.
L’AFEF, est-il rappelé, a été présente dans les premières réunions du Conseil Supérieur des Programmes et n’en est pas sortie complètement négative : des ouvertures étaient alors proposées comme la présence du carnet de lecture à l’oral, mais des arbitrages ont remis en cause ces avancées, en particulier sur l’examen. Il s’agit bel et bien de décisions politiques, qui montrent quel type d’élève et quel type d’enseignant on veut. Ce que les professeur.es dénoncent massivement, c’est la forte tension entre la densité du programme et la temporalité, celle du travail en classe et de leur travail personnel. Ce qu’ils expriment, sans nostalgie des anciens programmes, c’est beaucoup de détresse, l’impression de ne plus savoir faire, la conviction que cela n’a pas de sens. Ce dont ils se font aussi l’écho, c’est de la détresse des élèves. Le but de la journée, conclut Isabelle Henry, c’est d’essayer d’être un peu moins malheureux.
Que faire avec les programmes de français au lycée ? interroge Mathieu Bilière. La présence de la notion d’appropriation fait plaisir, tant elle a été mise en avant depuis des décennies par les chercheurs en didactique. Mais sa place est petite, on l’y envisage comme appropriation d’une « culture littéraire » (plutôt que des œuvres ?), elle semble considérée comme un objectif (plutôt qu’une modalité de travail ?), et une question demeure brûlante : si les écrits d’appropriation ont de la valeur, pourquoi les avoir exclus de l’examen en interdisant le carnet de lecture comme support de l’entretien oral ? pourquoi cette contradiction avec les LCA où par bonheur le portfolio est imposé ? La présence de la langue en préambule doit sans doute être considérée comme un détachement emphatique. Est aussi frappant le remplacement de « l’argumentation » par la « littérature d’idées » : les préférences sont accordées au corpus plutôt qu’aux compétences des élèves. Mathieu Bilière montre combien les programmes mènent à l’empilement : des œuvres, des types d’exercices, des notions. Et pose des questions qu’on ne semble pas avoir envisagées « là-haut » : comment certaines familles vont-elles pouvoir budgétiser l’achat de 8 œuvres comme cela est exigé en 1ère ? quelle prise en compte des conditions de travail réelles des élèves quand on externalise à ce point leur mise en activité ? ce programme ne met-il pas en œuvre une forme de sélection sociale ? quelle place enfin pour la littérature contemporaine sinon dans les marges ? Ceci, parce que selon les propos rapportés d’un Inspecteur général, il faudrait distinguer les œuvres patrimoniales, « qui nécessitent le truchement d’un enseignant », et les œuvres contemporaines, « qui peuvent être explorées seul » ? Les programmes sont « boulimiques, poussiéreux et sélectifs », juge le membre du collectif Lettres vives..
Que faire de l’écriture d’appropriation ?
 Françoise Cahen, enseignante au lycée Maximilien Perret à Alfortville, et Jean-Michel Le Baut, professeur au lycée de l’Iroise à Brest, mènent une défense et illustration des écrits d’appropriation, qui, par bonheur, trouvent dans les programmes 2019 une reconnaissance officielle. A la lumière des analyses de Bénédicte Shawky-Milcent dans son ouvrage de reference : « S’être approprié une œuvre, c’est bien l’avoir rendue « propre à soi », l’avoir transformée en une composante de ce que l’on est, en élément d’une culture personnelle, inscrit dans la mémoire. »
Françoise Cahen, enseignante au lycée Maximilien Perret à Alfortville, et Jean-Michel Le Baut, professeur au lycée de l’Iroise à Brest, mènent une défense et illustration des écrits d’appropriation, qui, par bonheur, trouvent dans les programmes 2019 une reconnaissance officielle. A la lumière des analyses de Bénédicte Shawky-Milcent dans son ouvrage de reference : « S’être approprié une œuvre, c’est bien l’avoir rendue « propre à soi », l’avoir transformée en une composante de ce que l’on est, en élément d’une culture personnelle, inscrit dans la mémoire. »
Comment faire de la lecture au lycée un projet d’écriture ? Les exemples proposés montrent la diversité des démarches possibles. Comme dans le projet « Il faut sauver Boule de suif », l’écriture interventionniste permet de se glisser dans les fragilités du texte pour changer le cours et le sens de l’histoire. A l’instar de travaux menés sur Marivaux ou Louise Labé, les élèves peuvent établir des éditions critiques d’œuvres patrimoniales pour publier leurs propres « petits classiques » et développer leur posture de lecteurs experts. La « concrétisation imageante » (Sylviane Ahr) est la voie utilisée par des secondes créant un album-souvenir pour éclairer « Les Années » d’Annie Ernaux. L’« empathie fictionnelle » conduit les élèves à écrire de l’intérieur d’un personnage, par exemple en créant les traces numériques qu’il aurait pu laisser sur internet, comme dans un projet des lycéen.nes i-voix autour de la mémoire et d’un roman de Sylvie Germain. Les coécritures permettent aux élèves de se glisser dans les textes pour que se mêlent la voix de l’auteur et la voix du lecteur. L’oral d’appropriation est une piste à explorer comme dans ces « mémo-monologues » enregistrés par Lorenzaccio tout au long de la pièce de Musset ou ces débats entre Cunégonde et Candide. Et, puisque les candidat.es seront autorisé.es à apporter leur livre à l’entretien, pourquoi ne pas les amener à y insérer des « marginalia créatives » ?
Pourquoi l’écriture d’appropriation ?
C’est que, reconnaissant tout à la fois le sujet lecteur et le sujet scripteur, les écrits d’appropriation paraissent particulièrement riches et stimulants. Il s’agit de donner un but à l’activité de lecture, qui ne va pas de soi pour tous : on ne lit plus seulement pour lire, mais pour écrire, pour réaliser quelque chose, pour « faire ». Il s’agit de favoriser l’implication de l’élève : par l’identification possible aux personnages, par la mise en activité, par la liberté accordée de construire son propre cheminement dans l’œuvre, par la réhabilitation de l’émotion, de la sensibilité, des affects qui fondent l’événement de lecture. Il s’agit de travailler simultanément des compétences de lecture et d’écriture, d’apprendre à mieux écrire par imprégnation, compagnonnage ou imitation. Il s’agit de varier les postures de lecteur, de ne pas se limiter à celle du lecteur expert que l’Ecole tend à survaloriser. Il s’agit de considérer l’innutrition comme démarche possible d’interprétation, de favoriser une connaissance plus intime, plus intense, peut-être plus riche, de l’œuvre dont on fait l’expérience de l’intérieur. Il s’agit d’amener l’élève à se déplacer : la vertu de « l’empathie fictionnelle », c’est aussi de devenir autre le temps d’une identification non pas subie mais choisie et construite, d’une identification-action, c’est faire une expérience de l’altérité dont on peut présumer qu’elle a aussi des enjeux éthiques et citoyens. Il s’agit enfin de faire de la lecture une aventure plutôt qu’un voyage organisé par l’enseignant, une aventure qui favorise curiosité, ouverture, esprit et démarche de lecteur chercheur.
Pourquoi l’écriture numérique d’appropriation ?
Peut-on imaginer pour les écrits d’appropriation d’autres supports que le carnet de lecteur papier ? Le numérique, démontre-t-on, apparait comme particulièrement intéressant pour mettre en oeuvre de tels dispositifs. Il convient en effet de prendre en considération le « milieu » du savoir qui est désormais le nôtre : si le livre imprimé a jadis diffusé la lecture, désormais le numérique démocratise l’écriture, désormais lire-écrire-publier c’est tout un, désormais un nouveau scriptorium est à investir, avec nos élèves. Il semble aussi pertinent d’aller chercher les élèves là où ils sont (en ligne, en réseau) pour réconcilier la culture du livre (la littérature) et la civilisation des écrans (internet), les savoirs scolaires et les savoirs illégitimes, les pratiques formelles et informelles du numérique. Chaque enseignant, y compris en français au lycée, a pour mission de développer des compétences en littératie numérique et en translittératie. Les projets présentés montrent combien le numérique permet de diversifier et différencier encore plus les parcours possibles dans les œuvres : chacun.e peut rendre compte de sa lecture selon ses goûts, ses aspirations, sa sensibilité, ses habiletés, choisir les outils et les formes qui lui semblent les plus adaptées et les plus personnelles.
Il serait aussi dommage de ne pas exploiter les nouvelles possibilités d’écriture que libère le numérique : nouveaux outils (les smartphones), nouveaux gestes (couper, copier, coller, insérer, faire des liens…), nouveaux espaces (les réseaux sociaux), nouvelles modalités (collaboratives, immersives, transformatives), nouvelle textualité (qui permet d’écrire avec des mots, des images, des vidéos, de l’audio, des hyperliens, des émoticônes, des gifs, des hashtags). Le numérique renforce aussi la possibilité de partager les lectures : chacun.e en ligne peut découvrir les productions de ses camarades, enrichir son regard et sa réflexion sur l’œuvre ; chacun.e en ligne a la fierté de participer à un projet collectif, de faire de la littérature une culture à partager et de la classe un projet commun à inventer. Certains projets montrent encore combien, si le numérique permet d’habiter autrement ou davantage les œuvres, la littérature peut nous conduire à prendre une distance critique par rapport à nos pratiques numériques, à saisir ce qui se joue, ou pas, quand nous écrivons en ligne. Enfin, la possibilité est offerte de faire sortir l’œuvre du livre, de: ne pas enfermer la littérature dans son support, de faire de l’écriture un moyen de s’emparer des mots pour mieux habiter le monde.
Points de vigilance et d’inquiétude
Les échanges font apparait certains points de vigilance. Par exemple ne pas abandonner les élèves à eux-mêmes : faire des suggestions, donner des embrayeurs, ouvrir des pistes ; puis accompagner le travail de lecture et d’écriture en classe pour être au plus près de leurs étonnements, de leurs interrogations, de leur désir de mieux comprendre ou de mieux écrire. Mais aussi ne pas trop contraindre les élèves : préférer les propositions, les plus diverses possibles, aux injonctions, qui démotivent, qui brident le sujet-lecteur, qui risquent d’instaurer de nouveaux formalismes. Car il s’agit bel et bien de sortir un peu de cette culture et de cette rhétorique de la glose, qui enferment notre enseignement, qui étouffent les élèves : la « lecture d’invention » libère la créativité, donne à éprouver le plaisir du texte, met en action une authentique « expérience de lecture », peut favoriser la réflexivité si on amène les élèves à justifier et éclairer leurs intentions. Il est aussi rappelé l’importance de dissocier l’activité de la question de l’évaluation : l’enjeu, c’est le travail, non la note ; on peut, si on y tient, trouver des critères d’évaluation, mais l’activité est réussie quand les élèves travaillent pour le bonheur retrouvé de la littérature, pour le plaisir de créer, pour la stimulation de participer à un projet commun. Il est encore intéressant d’inviter les élèves à faire « quelque chose de beau », de plaisant à regarder, d’original, d’émouvant, d’amusant : favoriser une esthétique de l’écriture d’appropriation pour déployer en français une « pédagogie du chef-d’œuvre ». Enfin, si l’écriture d’appropriation donne du sens à la lecture, il peut être pertinent et motivant de donner du sens à l’écriture d’appropriation elle-même, c’est-à-dire un enjeu qui ne soit pas que lié à la préparation de l’EAF : les ressources d’accompagnement en font un peu trop une propédeutique à la dissertation ; pourquoi, par ces écrits, ne pas chercher plutôt à explorer un problème de société, aborder une question éthique, s’approprier une forme originale, inventer un objet numérique inédit ?
Retour au réel : la lourdeur des programmes permet-elle vraiment de mettre en œuvre l’écriture d’appropriation en classe ? L’interdiction incompréhensible à l’oral du « carnet de lecture » sous toutes ses formes ne risque-t-elle pas démotiver élèves, enseignants, examinateurs ? pourquoi l’institution crée-t-elle des empêchements aux innovations qu’elle prétend favoriser ? Par les écrits d’appropriation, l’élève se voit offrir la chance de se constituer une « bibliothèque intérieure », pour reprendre les mots de Pierre Bayard. Un double rêve est alors formulé : recueillons les traces laissées par les œuvres dans la mémoire des élèves, recueillons les, traces laissées par les élèves dans les œuvres elles-mêmes.
Que faire de l’enseignement de la langue ?
Karine Risselin livre ses analyses sur les pages des programmes consacrées à l’enseignement de la langue. S’y croisent des grammaires qui ne disent pas leur nom : l’énonciation, le texte, la phrase . Il va falloir « aiguiser le regard des élèves pour faire le ménage », « arbitrer pour dégager le nerf des activités grammaticales ». Se déploie aussi une « triade intéressante » : les compétences langagières, les connaissances linguistiques, les compétences linguistiques. Et Kaine Risselin de s’étonner : comment développer les connaissances sans manipuler la langue ? comment peut-on considérer, à rebours de toute la didactique de ces dernières années, qu’il faut des connaissances linguistiques pour mieux parler et écrire ? La notion d’interrogation a été mise au programme pour répondre au problème de l’annonce du plan dans les introductions des élèves : qui peut croire qu’en faisant un cours sur l’interrogation indirecte on règle les problèmes ? Sur les fiches des ressources d’accompagnement Eduscol, pourquoi cette « montée en terminologie » qui les rend inopérantes ?
Des contradictions sont mises à jour en confrontant des extraits des programmes : « l’étude de la grammaire n’est pas une fin en soi », « le travail de l’expression écrite s’affranchit du recours systématique au métalangage grammatical », « c’est de la maîtrise de la langue que dépendent à la fois l’accès des élèves aux textes du patrimoine littéraire et leur capacité à s’exprimer avec justesse à l’écrit et à l’oral ». Ce programme réintroduit aussi un lexique de la norme et fait l’impasse sur les variations linguistiques. Le problème du cadrage de l’épreuve finale est posé. Karine Risselin teste sur les enseignants et formateurs présents une question des ressources d’accompagnement : « étudier la négation » dans le vers de Lamartine « Nulle part le bonheur ne m’attend ». La salle reste sans réponse et sans voix …. Comment un collègue peut-il avoir l’étayage suffisant pour interroger de façon pertinente ? Cette évaluation-certification reproduit nos épreuves de concours. Comme le montre aussi l’explication linéaire, ce qui se révèle, c’est un impensé didactique : faites avec vos lycéens ce que vous avez fait en passant le concours !
Pour Karine Risselin,, il est souhaitable de « positionner des chantiers » de travail de la langue, et ce de façon régulière, mais le temps imparti ne permet guère hélas de faire manipuler. En formation, il faut permettre aux collègues de problématiser, de se demander ce qui est essentiel. Les IPR sont invités à demander un cadrage plus clair sur ce qui peut être exigé des élèves. L’enjeu est clairement posé : faire de cet enseignement de la langue « quelque chose de raisonnable.» Et les témoignages d’enseignants sont édifiants : « il n’est pas facile de concilier les besoins des élèves et les exigences des épreuves du bac », « le rapport à la langue me paraît très normatif », « les notions remontent à l’avant-guerre », « c’est très chronophage », « les élèves se désinvestissent » … Les collègues, constate Karine Risselin, sont précarisés en termes de maîtrise des savoirs et de gestes professionnels.
Enseignantes et formatrices sous tension
 Carole Amsellem et Armelle Sibrac le confirment en se présentant comme « enseignantes formatrices sous tension ». Elles livrent le retour de leurs premières expériences. Les élèves arrivant en 1ère confient leur absence de connaissances grammaticales. Le temps des apprentissages, en particulier en grammaire, est un temps long : pour être efficace, il faut pouvoir fragmenter, manipuler, répéter. Même un moment de grammaire peut prendre une heure ! La nature de l’épreuve est difficile à cerner, même pour les élèves : pourquoi s’investir autant à acquérir des notions abstraites pour 2 minutes d’oral notées sur 2 points ?
Carole Amsellem et Armelle Sibrac le confirment en se présentant comme « enseignantes formatrices sous tension ». Elles livrent le retour de leurs premières expériences. Les élèves arrivant en 1ère confient leur absence de connaissances grammaticales. Le temps des apprentissages, en particulier en grammaire, est un temps long : pour être efficace, il faut pouvoir fragmenter, manipuler, répéter. Même un moment de grammaire peut prendre une heure ! La nature de l’épreuve est difficile à cerner, même pour les élèves : pourquoi s’investir autant à acquérir des notions abstraites pour 2 minutes d’oral notées sur 2 points ?
Qu’enseigne-t-on exactement ? Pourquoi ? Comment ? interrogent Carole Amsellem et Armelle Sibrac qui ont repris un atelier de langue sur la proposition relative que propose Eduscol. Il s’est avéré impossible d’aller au bout du travail dans le temps planifié. La lourdeur du prescrit, une planification serrée des cours pour y répondre, viennent se heurter au temps long des apprentissages. Et cela génère de la frustration, car il est intéressant de travailler la langue de cette façon, de faire manipuler, de faire émerger les questions des élèves, de travailler les productions langagières. Pour être efficace, il parait nécessaire de relier connaissances linguistiques, compétences linguistiques et compétences langagières. Mais les collègues rencontrés sont désorientés ou en panique. Il y a un besoin important de formation pour qu’ils se sentent plus en confiance dans leurs savoirs et leurs scénarios didactiques
Quelles perspectives ?
La journée AFEF – Lettres vives a permis de se confronter aux problèmes que posent les programmes tout en élargissant le champ des possibles.
Des clarifications demeurent nécessaires. La lecture des programmes a évolué au fil des mois : par exemple la dissertation sur l’oeuvre et le parcours est de plus en plus souvent présentée dans les formations comme une dissertation sur l’oeuvre (ave possibles élargissements). D’une académie à l’autre, les explications et injonctions institutionnelles sont parfois contradictoires : par exemple, sur la question de manipulation dans la partie langue de l’oral.
Des ajustements sont attendus. Beaucoup espèrent dans l’immédiat un allègement quantitatif : renouvellement annuel au quart des oeuvres au programme ? gel pour l’année 2020-2021 ? diminition (de 24 à 20) du nombre exigé d’explications de textes ? Beaucoup souhaitent aussi que ces programmes soient fondamentalement repensés : les problèmes posés vont au-delà des questions de chiffres, les épreuves finales telles qu’elles sont définies sont une fois de plus en train de scléroser les pratiques, le risque est fort hélas que les belles intentions parfois affichées restent lettres mortes. Puisse cette journée contribuer à faire entendre les aspirations d’enseignant.es attaché.es à la vitalité du français au lycée..
Jean-Michel Le Baut
Le site du Collectif Lettres vives
Bénédicte Shawky-Milcent dans Le Café pédagogique