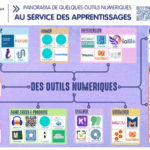Quand on leur parle des ZEP, que disent les acteurs concernés, ceux qui sont chaque jour face aux élèves ?
Afin de préserver la liberté de parole de nos interlocuteurs, nous recourons, une fois n’est pas coutume, à l’anonymat. En effet, une chose revient souvent dans les témoignages : certaines paroles ont du mal à être proférées publiquement.
En premier lieu, l’inquiétude devant un système qui a de plus en plus de mal à « tenir » : les élèves qu’on n’arrive pas à installer dans une posture d’élève, l’usure quotidienne quand on désespère de pouvoir « faire son métier ». Bien sûr, tout n’est pas noir, mais c’est le sentiment d’abandon qui prédomine largement, quand on se sent « comme seul à tenir le front ». Si, bien souvent, on se serre les coudes, la confiance dans la capacité de l’institution à donner des perspectives semble évanouie. « Pendant longtemps, on n’a pas compté les heures, mais depuis quelques années, on se sent oubliés de tous ». Les crédits baissent d’année en année, le pilotage est incompréhensible vu du terrain, et le sentiment que « les circulaires passent, le vocabulaire change, mais rien ne bouge ». Dans nombre de ZEP, le comité exécutif, censé piloter le collectif, n’est que virtuel. Le «projet» de la ZEP est peu partagé, quand il n’est pas inconnu : « les axes prioritaires du contrat de réussite ? Euh, là, vous me collez… » Côté premier degré, le pilote est invisible. « Vous êtes sûr que c’est le principal du collège qui est le pilote de la ZEP ? Ca m’a échappé… ». Dans un univers qui reste souvent cloisonné entre les deux degrés, on a du mal à comprendre « comment ça marche » : « on a vu arriver de nouveaux métiers, des assistants pédagogiques, des enseignants référents, sans qu’on définisse exactement ce pour quoi ils sont là ».
Le coordonnateur, entre deux chaises ?
La perception du coordonnateur ZEP, bien que son existence soit plus ancienne, n’est pourtant jamais définie de la même manière : ici, il « coordonne les grilles, les emplois du temps ». Là, il « remplace l’IEN qui lui a délégué son pouvoir sur la ZEP ». Ou « il passe beaucoup de temps en réunions, loin des classes : conseil de ceci, réunion avec la mairie, préparation de la Réussite Educative »…
Il monte des projets, commande des bus, chasse les finances : côté éducation nationale, elles ont considérablement baissé depuis plusieurs années. L’essentiel des moyens vient de l’extérieur, quand des partenaires existent : contrat de ville, ACSÉ, PRE… Du coup, il faut justifier les demandes de financement : s’agit-il de subventionner le fonctionnement ordinaire du service public d’éducation, ou de mettre en place de nouvelles actions ? Et chercher à convaincre les enseignants d’investir de l’énergie sur ce qui ne leur semble pas toujours le cœur de leur activité : l’aide aux devoirs, la relation aux parents… « Moi, mon boulot, c’est de leur apprendre à lire, si possible qu’ils comprennent ce qu’il font là, les faire vivre ensemble, faire que l’Ecole n’explose pas. L’essentiel se joue dans la classe. Alors, quand le coordo vient me parler d’une réunion de plus, ça n’est pas ça qui m’aide à faire mon boulot »…
Du coup, certains coordonnateurs ZEP, conscients qu’ils doivent « justifier leur fonction aux yeux des collègues », cherchent à se rapprocher du quotidien de la classe, travaillent les résultats des évaluations avec les équipes, prennent en charge du travail de formation, voire des groupes d’élèves. Au risque de se trouver en porte-à-faux : «Moi, vous comprenez, je ne suis pas conseiller pédagogique. J’ai quelle légimité pour faire de la pédago avec les enseignants ? ». Il faut dire que la culture de certaines ZEP, c’était surtout les projets, les sorties… Bref, « pas ce qui fait le quotidien du métier : tous les jours, six heures par jour, tenir… Faire que ça tienne… ».
Aides en tous genre, au risque de la perturbation…
Même si l’époque est parfois plus au recentrage sur les « fondamentaux » scolaires, on n’a souvent pas perdu les habitudes de travailler ensemble. Mais rarement sur le fond de l’explication de la difficulté scolaire, si ce n’est par les « causes sociales ». Du coup, on se centre sur les dispositifs : on décloisonne, on remédie avec l’aide des assistantes d’éducation ou des EVS, on organise du travail en petits groupes. « Mais le paradoxe, explique un directeur d’école, c’est que je me suis aperçu qu’on diluait l’ordinaire de la classe : certains enfants, pris en charge dans des groupes d’aide, des PPRE, par le RASED, passent plusieurs heures par semaine hors de la classe. Je ne suis pas sûr que ça renforce la cohérence de ce qui s’y passe. Alors, quand je pense qu’on risque de devoir encore inventer de nouvelles réponses avec du soutien scolaire après la classe, je me dis qu’on va les faire exploser, les gamins »…
Comme le précise l’article des enseignants de Besançon, l’essentiel du ressenti de l’enseignant de ZEP se résume à une question finalement simple : « là où je suis, je me demande parfois si j’ai de l’efficacité, ou si on ne me fait pas jouer un rôle de maintien de l’ordre. Je me dis qu’il faudrait que quelqu’un me les répare pour que je puisse ensuite faire le programme : le RASED, l’orthophoniste, l’assistante sociale… ». Et ce sentiment d’impuissance, de distance, est vite redoutable : avec « ces enfants-là », le pari d’éducabilité ne va pas de soi. On réduit les ambitions, on limite les tâches scolaires à ce qui préserve du désordre, on sécurise…
Et pourtant, elle tourne
Pourtant, on voit bien que certaines écoles sont des îlots préservés dans un univers plutôt hostile. « J’ai été étonné en arrivant dans l’Ecole, de voir le calme dans les couloirs, dans les classes. Les enseignants ont trouvé le délcic qui fait qu’on ne négocie pas sur l’essentiel : on vient à l’école pour apprendre, pour bosser, pour s’entraîner, pour s’écouter. Les collègues croient à leur boulot, c’est tout. »
Evidemment, plus facile à dire qu’à faire, surtout dans le temps. Qu’un rouage se mette à grincer (une directrice qui part, trois élèves ingérables, un changement d’IEN, un conflit avec la mairie…) et c’est tout l’édifice qui menace de s’écrouler…
« Pendant deux ans, on a eu un vrai passage à vide. J’arrivais avec la boule au ventre, l’inquiétude de ne pas arriver à gérer une classe d’élèves de trois ans dont je n’arrivais pas à bout, malgré mes trente ans de ZEP. Les tessons de bouteille de bière du lundi matin dans la cour me faisaient remonter de la haine… Je ne sais pas ce qui a fait le déclic, une classe moins dure, le travail qu’on a fait dans un stage de formation filée où les formateurs nous on refixé sur le sens du travail scolaire… Mais je suis repartie sur des projets d’apprentissage : leur apprendre à catégoriser, relier systématiquement avec le travail de langage. Et j’ai vu tout de suite des déclics, des attitudes, des engagements des élèves… J’ai longtemps cru qu’ils ne pouvaient apprendre que si j’arrivais préalablement à les socialiser, j’ai renversé le point de vue : c’est quand on arrive à mettre de l’ordre dans ce qu’ils savent qu’ils deviennent disponibles, et que le cadre de travail devient possible.
Et c’est le moteur de leur réussite qui me fait retrouver l’envie de venir à l’Ecole. Comme une pompe qui s’auto-amorce. C’est au moment où il faut amorcer la pompe qu’on est démuni. Et qu’on est souvent trop seul. »
- Edito : Afficher, ou décider ?
- ZEP : repères historiques
- Alain Bourgarel : une vie d’engagement pour les ZEP
- Qui l’a dit ? (petit jeu)
- Faire classe dans l’Education Prioritaire : que dit l’Inspection générale ?
- Et que dit le terrain ?
- A Montereau, le lycée cherche les voies de l’excellence
- A Créteil, les référents se positionnent
- Difficultés à apprendre : l’aide en question
- Les CAREP, ressources documentaires
- Points de vue de la recherche
- Revenir au sommaire