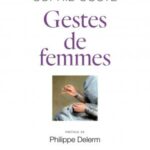L’École Intégrée Danielle Casanova (E.I.D.C.) d’Argenteuil, dans le Val d’Oise, accueille depuis 1972 des enfants sourds de toute la région parisienne et de province. Deuxième établissement en taille en Ile de France après l’INJS de Paris (Institut National des Jeunes Sourds), l’école reçoit 235 enfants de 0 à 20 ans qu’elle accompagne tout au long de leur cursus scolaire. Un accompagnement dont la complexité est plus grande qu’on ne le pense en général : pour Édith Heveline, directrice de l’école, la surdité est un handicap discret dont on mésestime l’impact sur la vie et la construction de l’identité de ceux qui en sont atteints. La question des modalités de l’apprentissage, des choix pédagogiques, de l’intervention des spécialistes (médecins, psychologues, audio-prothésistes, assistantes sociales, orthophonistes, psychomotriciens, professeurs CAPEJS), de l’intégration de professionnels sourds, de l’organisation du cursus scolaire selon les besoins des enfants et de leurs familles, forment un maillage complexe dans lequel le souci des personnes ne doit jamais céder le pas à l’exigence technique d’efficacité. Une séance de cours de philosophie auprès de jeunes lycéennes sourdes, dans une classe spécialisée du lycée partenaire Fernand Léger d’Argenteuil, permet de mesurer la difficulté et la performance des acquisitions scolaires pour ces élèves.
Un univers perceptif différent.
 « Imaginez la différence d’univers perceptif qui peut exister entre un enfant sourd ou malentendant et un entendant. La surdité retentit en profondeur sur l’image du monde et la formation de l’identité personnelle des individus », explique Edith Heveline, directrice de l’École Intégrée Danielle Casanova, établissement géré par les PEP95, sous contrôle de l’ARS et financé par la Sécurité sociale et autres caisses d’assurance maladie. Dès les premiers moments de notre existence, la perception auditive structure le champ de nos représentation et notre communication avec autrui. Nous avons baigné dans les sonorités et les intonations du langage oral avant d’en rien saisir. L’univers subjectif d’une personne privée du paysage sonore n’est pas moins cohérent, pas moins plastique ni adapté que celui d’une personne entendante, mais il est différent ; difficile de s’en faire une image juste quand on ne le partage pas. L’accueil et l’accompagnement scolaire d’enfants sourds se heurtent d’emblée à un dilemme : comment faire accéder l’enfant au monde « normal » des entendants, dont il ne partage pas l’expérience, sans lui faire rompre brutalement avec l’univers intime constitué par sa conscience depuis sa naissance ?
« Imaginez la différence d’univers perceptif qui peut exister entre un enfant sourd ou malentendant et un entendant. La surdité retentit en profondeur sur l’image du monde et la formation de l’identité personnelle des individus », explique Edith Heveline, directrice de l’École Intégrée Danielle Casanova, établissement géré par les PEP95, sous contrôle de l’ARS et financé par la Sécurité sociale et autres caisses d’assurance maladie. Dès les premiers moments de notre existence, la perception auditive structure le champ de nos représentation et notre communication avec autrui. Nous avons baigné dans les sonorités et les intonations du langage oral avant d’en rien saisir. L’univers subjectif d’une personne privée du paysage sonore n’est pas moins cohérent, pas moins plastique ni adapté que celui d’une personne entendante, mais il est différent ; difficile de s’en faire une image juste quand on ne le partage pas. L’accueil et l’accompagnement scolaire d’enfants sourds se heurtent d’emblée à un dilemme : comment faire accéder l’enfant au monde « normal » des entendants, dont il ne partage pas l’expérience, sans lui faire rompre brutalement avec l’univers intime constitué par sa conscience depuis sa naissance ?
Langue orale ou langue des signes ?
La première difficulté, à l’accueil des enfants, réside dans l’accompagnement de la famille : le handicap est décelé précocement, dès la maternité, et les enfants sont reçus au tout premier âge à l’E.I.D.C. Pour les parents, le désir de normalisation est fort, et le recours aux prothèses apparaît comme une évidence nécessaire. La pose d’implants cochléaires (appareil électronique qui remplace les fonctions endommagées de l’oreille interne) permet d’espérer l’accès à des fonctions auditives plus satisfaisantes. Le souci du bien-être de leur enfant conduit les parents à attendre beaucoup de ces solutions. Mais pour les enfants qui ne connaissent pas, ou seulement sous une forme atténuée, le monde sonore, le problème ne fait que commencer avec l’appareillage. Il permet de développer au maximum l’accès au langage oral. La langue des signes, quant à elle, non seulement n’empêche pas l’apprentissage de l’oral, mais elle le favorise par la compréhension qu’elle permet. L’oralisation semble un gage d’intégration familiale et sociale, mais n’est-ce pas au prix d’une perte au regard de l’univers sémantique particulier du langage des signes ? La LSF opère par une symbolisation sensible particulièrement expressive de l’expérience du monde vécue dans la surdité. Elle constitue à elle seule un vecteur de culture spécifique. « C’est une question récurrente sur laquelle nous ne portons aucun jugement, précise Édith Heveline. Nous accompagnons les familles au mieux de leurs attentes et de leurs besoins particuliers dans leur choix, mais nous n’avons pas de position dogmatique. Nous travaillons sur un projet linguistique bi-modal, incluant les deux formes d’apprentissage de manière complémentaire, en particulier pour favoriser l’accès à la langue écrite qui n’existe pas en LSF. ».
Une scolarité sur mesure de la maternelle au baccalauréat.
Pour les enfants reçus à l’E.I.D.C., le parcours est adapté dès le plus jeune âge : les bébés sont accueillis dans le cadre d’un SAFEP (Service d’Accompagnement Familial et d’Éducation Précoce), puis les enfants sont scolarisés soit individuellement dans l’école maternelle de leur quartier, soit en classe spécialisée à l’École Maternelle Dolto d’Argenteuil. Le Primaire peut s’effectuer en scolarisation individuelle ou bien en classes spécialisées, dans les Écoles Joliot-Curie puis Lapierre d’Argenteuil, où les classes externalisées favorisent le vécu d’écoliers, selon un concept défendu par l’E.I.D.C. depuis l’origine. En cas de handicap associé, les enfants peuvent entrer en section spécialisée à l’École Casanova. Pour le collège, la scolarité peut se poursuivre en scolarisation individuelle ou dans l’unité enseignement Ulis (Unité spécialisée pour l’inclusion scolaire) du Collège Langevin Wallon à Saint-Gratien, accompagnée par des traducteurs et des professeurs spécialisés, ou bien dans l’Unité d’Enseignement spécialisé du Collège Claude Monet à Argenteuil.
Vient ensuite le lycée, en scolarisation individuelle, ou en Ulis au Lycée Fernand Léger d’ Argenteuil, ou bien en SPFP (section de première formation professionnelle) en lycée professionnel ou en CFA selon le profil de l’élève. La signature de conventions de coopération avec ces structures partenaires sont en cours de réalisation. Ces parcours diversifiés requièrent l’intervention de personnels très spécialisés : l’équipe de Casanova compte 110 professionnels des domaines médicaux, psychologiques, éducation spécialisée, animation, interprétariat et enseignement. 15 postes d’enseignants spécialisés CAPA-SH Option A (ex-CAPSAI) sont mis à disposition par l’Éducation nationale et 10 professeurs CAPEJS (spécialisés pour l’enseignement aux jeunes sourds, diplômé du Ministère de la Santé). « Les modes d’accompagnement sont très divers selon les enfants, précise Édith Heveline, mais il est essentiel de rester attentif à l’évolution de chacun. Le risque de mimétisme, par exemple, pour un enfant intégré dans une classe ordinaire, n’est pas toujours bien mesuré : il peut se fondre dans le groupe de manière très discrète sans qu’on s’aperçoive qu’il est perdu. Et le retard s’accumule au fil des années. »
Un établissement fragilisé par la conjoncture malgré une demande pressante.
 Lorsqu’elle fait visiter les locaux de son école, Édith Heveline est partagée entre fierté et embarras : fierté légitime devant l’aménagement chaleureux des salles, les affichages pédagogiques inventifs et colorés, l’espace accueillant de la bibliothèque, les ateliers d’arts plastiques ouverts aux petits en ce mercredi après-midi, l’ambiance amicale qui règne entre les membres de l’équipe. Mais les locaux défraîchis, les espaces devenus étriqués malgré un aménagement ingénieux, les tracas quotidiens de l’entretien d’un établissement quadragénaire qui doit faire face à des demandes toujours plus nombreuses avec des moyens matériels limités par la conjoncture actuelle, sont le reflet visible des difficultés d’organisation et de gestion de la structure dans son ensemble. « Plus fondamentalement, les solutions institutionnelles privilégient l’inclusion comme la panacée pour la scolarisation des élèves sourds dans l’esprit de la loi de 2005 sans toujours tenir compte des effets spécifiques induits par cette démarche. Pas plus que l’appareillage ne résout entièrement le problème de la surdité, l’immersion en milieu scolaire ordinaire ne peut suffire à aplanir les différences de modalités d’acquisition des savoirs. »
Lorsqu’elle fait visiter les locaux de son école, Édith Heveline est partagée entre fierté et embarras : fierté légitime devant l’aménagement chaleureux des salles, les affichages pédagogiques inventifs et colorés, l’espace accueillant de la bibliothèque, les ateliers d’arts plastiques ouverts aux petits en ce mercredi après-midi, l’ambiance amicale qui règne entre les membres de l’équipe. Mais les locaux défraîchis, les espaces devenus étriqués malgré un aménagement ingénieux, les tracas quotidiens de l’entretien d’un établissement quadragénaire qui doit faire face à des demandes toujours plus nombreuses avec des moyens matériels limités par la conjoncture actuelle, sont le reflet visible des difficultés d’organisation et de gestion de la structure dans son ensemble. « Plus fondamentalement, les solutions institutionnelles privilégient l’inclusion comme la panacée pour la scolarisation des élèves sourds dans l’esprit de la loi de 2005 sans toujours tenir compte des effets spécifiques induits par cette démarche. Pas plus que l’appareillage ne résout entièrement le problème de la surdité, l’immersion en milieu scolaire ordinaire ne peut suffire à aplanir les différences de modalités d’acquisition des savoirs. »
Un handicap encore mal connu et mal compris.
« Les préjugés et les idées fausses sont très nombreuses, concernant le domaine de la surdité, souligne la directrice de l’École Casanova. Il y a un travail d’ouverture et de communication à développer. » Comprendre la surdité reste compliqué, aussi bien pour le jeune que pour les parents, les professeurs ou les partenaires. Pour progresser dans cette voie, l’E.I.D.C. organise des actions destinées au public : pour les 40 ans de l’École Casanova, les 18 et 19 avril prochain, deux journées d’études permettront d’échanger avec des spécialistes sur les actualités médicales, l’accompagnement familial, les questions de langues, les adaptations de parcours, sous forme de conférences et de débats. Dans le domaine de la formation et des échanges de pratique, « nous avons mis en place des actions de formation pour les enseignants et les orthophonistes concernant les mathématiques et les structures logico-mathématiques avec l’aide du GEPALM, dit Édith Heveline. Nous participons, avec l’ensemble des établissements spécialisés surdité de l’Ile de France, à une exposition interactive sur la mesure, du 13 mai au 23 mai à l’INJS. Nos élèves du primaire s’y rendront par groupe. ».
Le piège de la normalisation forcée.
« Il faut se méfier des solutions univoques, conclut Edith Heveline. Le congrès de Milan en 1880 (Congrès international sur l’éducation des sourds) a conduit à interdire la langue des signes dans les écoles, et donc les enseignants sourds, au profit de l’oralisation, pour ne pas marginaliser les enfants. C’est toute une modalité de l’échange et une dimension culturelle de la surdité qui ont été menacées, avant qu’on s’avise de l’intérêt de réinvestir la LSF dans les années 70. Aujourd’hui, un CAPES de LSF existe à l’Éducation nationale. A Casanova, qui était à l’origine un établissement oraliste, on travaille depuis les années 90 à infléchir les enseignements vers un usage de la LSF pour favoriser la conceptualisation. Le projet actuel précise l’équilibre dans l’usage des deux langues. Des techniques comme le codage LPC (langage parlé complété) qui permet de faciliter l’oral par la distinction des sosies labiaux, sont parfois demandées par la famille qui y voient une solution pour faciliter les échanges oraux. Mais identifier les sons ne donne pas accès au sens des termes, le but n’est pas d’apprendre à imiter mais de saisir le sens des mots. »
Une réflexion qui penche vers la prise en compte de l’existence réelle d’une identité du monde de la surdité, dans la recherche des moyens de faciliter la vie des personnes handicapées et de leurs familles, à l’opposé du déni normalisateur, sans doute bien intentionné, mais parfois destructeur qui a pu prévaloir. Avec une nuance importante : l’identité sourde est très diversement acceptée et assumée par les personnes atteintes de déficiences auditives. Prétendre l’imposer comme un caractère déterminant de leur personnalité sociale peut se révéler tout aussi violent que la dénier.
Portrait d’interprète : « transposer le discours en un monde d’images ».
Une danse des mains, des bras, des lèvres, menée à toute allure à ses côtés, l’expérience d’une traduction simultanée en LSF est une aventure singulière pour l’enseignant qui la découvre. Le cours se joue à ses côtés, redoublant sa parole d’une vie parallèle à laquelle seule les élèves accordent attention : sans leurs regards, sans leurs voix, quel échange peut encore opérer ? Mais soudain les retours se font et les yeux accompagnent la parole de la traductrice : le sens passe, accroche, cherche, se faufile, hésite, l’échange se met en œuvre.
 Ce cours de philosophie, que j’ai pu mener avec les élèves de TS2S du Lycée Fernand Léger d’Argenteuil, grâce à l’invitation de leur professeure titulaire, Violette Villard, n’est pas comme les autres : faire entendre la pensée est toujours une gageure, qui affronte l’obstacle des registres de langue, des degrés d’abstraction et de la conceptualité. Mais ici, la parole doit prendre des couleurs et des formes, une tonalité et des inflexions visibles pour atteindre les élèves. L’enseignant dépend entièrement de la fidélité et de l’ingéniosité de son interprète, devenu aussi précieux que sa propre voix. Sensation inattendue, aussi, dans l’exercice du métier, de sentir le soutien presque physique d’une tierce personne dont l’écoute empathique relaie et déploie l’effort de pédagogie. Deux interprètes, aussi différentes que possible l’une de l’autre, et pourtant parfaitement complémentaires dans leurs interventions, se sont succédées ce jour-là à mes côtés, Vinciane Trufelli et Audrey Albot.
Ce cours de philosophie, que j’ai pu mener avec les élèves de TS2S du Lycée Fernand Léger d’Argenteuil, grâce à l’invitation de leur professeure titulaire, Violette Villard, n’est pas comme les autres : faire entendre la pensée est toujours une gageure, qui affronte l’obstacle des registres de langue, des degrés d’abstraction et de la conceptualité. Mais ici, la parole doit prendre des couleurs et des formes, une tonalité et des inflexions visibles pour atteindre les élèves. L’enseignant dépend entièrement de la fidélité et de l’ingéniosité de son interprète, devenu aussi précieux que sa propre voix. Sensation inattendue, aussi, dans l’exercice du métier, de sentir le soutien presque physique d’une tierce personne dont l’écoute empathique relaie et déploie l’effort de pédagogie. Deux interprètes, aussi différentes que possible l’une de l’autre, et pourtant parfaitement complémentaires dans leurs interventions, se sont succédées ce jour-là à mes côtés, Vinciane Trufelli et Audrey Albot.
Vinciane Trufelli : « J’enfile les costumes des gens toute la journée ! »
Animatrice de théâtre « ayant eu la chance de rejoindre une équipe de professionnels », dit-elle, et passionnée par la langue des signes, Vinciane Trufelli en a acquis les rudiments auprès de jeunes sourds de l’INJS de Bordeaux, avant de se perfectionner jusqu’au niveau de compétence requis pour intégrer l’école d’interprétariat du SERAC, pour une formation de deux ans. Entre temps, elle rencontre Emmanuelle Laborit et travaille comme comédienne bilingue pendant une année, sous la direction de Chantal Liennel à l’IVT (International Visual Theater). Une expérience précieuse au quotidien pour son métier d’interprète : « J’enfile les costumes des gens toute la journée ! La traduction demande un rapport d’intimité avec les gens, une capacité d’empathie pour laquelle le théâtre est une très bonne école. Il ne suffit pas de traduite les mots, il y a toute une dimension implicite de la parole à faire passer en traduction. On oublie souvent la dimension corporelle du langage, tout ce qui passe à travers le visage, les mouvements du corps, les inflexions de la voix. C’est pourtant cela qui porte les nuances les plus importantes du discours. Tout ce non- verbal qu’on ignore dans la langue orale doit être indiqué autrement dans la langue des signes, par une forme d’expression qui en rende l’esprit », explique-t-elle.
Un monde imaginaire propre à chaque enseignant.
« Dans la traduction scolaire, il y a d’abord un travail d’appropriation des contenus. Le vocabulaire technique n’est pas vraiment un problème, mais il faut du temps et du travail pour bien l’intégrer, des temps de préparation avec les professeurs. On utilise beaucoup l’icônicité, la ressemblance entre signifiant et signifié, pour mettre en images les termes qui n’ont pas d’équivalents stricts en LSF. Et puis la déontologie prévoit qu’on puisse refuser de traduire dans un domaine où l’on ne se sent pas à l’aise (pour moi, c’est l’histoire géographie…). La difficulté consiste à dé-verbaliser les contenus pour les transmettre sous une forme imagée. Il faut parvenir à déclencher une pensée en images. Quand on connait bien l’enseignant, comme c’est le cas pour moi avec Violette, on élabore un univers imaginaire d’autant plus fécond que l’univers mental de l’enseignant est riche, et on y est directement imprégné de son style. Il peut arriver aussi qu’on soit piégé par la symbolisation des gestes : on risque de donner la réponse aux questions, simplement en les posant ! C’est le cas en SVT où on utilise des gestes très iconiques. Pour l’éviter, la solution consiste à épeler les mots – mais il faut avoir anticipé les questions de l’enseignant ! Avec le temps, on attrape une bonne intuition, on devine à l’avance la stratégie des professeurs, on sent quand ils veulent en venir à une question précise. Traduire la pédagogie d’un enseignant sans la trahir, comme toute traduction, cela exige de se rendre transparent. Mais la transparence n’empêche pas la présence, au contraire, et sans empathie pour son intention pédagogique, on ne laisserait pas passer la qualité propre de son enseignement. Cela suppose un filtre très fin dans la traduction, de saisir le sens implicite de son intention éducative. »
Jeanne-Claire Fumet
EIDC – Ecole Intégrée Danielle Casanova – 22 rue de Picardie – 95100 ARGENTEUIL ;