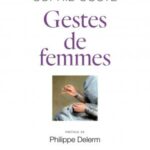Le dernier TIMSS est sorti. On n’attendait pas un bouleversement, mais quand même, ça fait mal. Franchement mal, même. Lire les performances de nos enfants en mathématique m’a franchement affectée : ils sont tellement loin des objectifs des enseignants, à savoir les rendre autonomes pour être au monde de la façon la plus éclairée possible. Or, depuis 2015, le niveau des élèves français ne s’est pas amélioré, et s’est même détérioré pour les filles en mathématiques.
Des résultats mauvais
TIMSS nous fournit un document que j’ai trouvé intéressant, voire passionnant, et qui m’a évoqué des tas de réflexions. Nul doute que de nombreux journalistes, professionnels de terrain, chercheurs et cadres de l’Éducation nationale nous fourniront dans les jours qui viennent des analyses pertinentes. Ce n’est pas mon propos : je voudrais étudier un exemple, pour enrichir ma réflexion.
Les évaluations sont exprimées sur une échelle de quatre niveaux, comme chez nous pour le DNB : au niveau avancé, les élèves sont capables de résoudre des tâches complexes et de justifier leurs démarches. Ils maîtrisent la multireprésentation. Au niveau haut, les élèves résolvent des problèmes, mais sont moins capables de transferts et d’argumentation. Le niveau intermédiaire est le niveau d’application directe et, au niveau bas, les élèves ont des acquis partiels.
Pour la France, 3% des élèves de CM1-CM2 sont au niveau avancé, 18% sont au niveau haut, 36% sont au niveau intermédiaire et 28% atteignent le niveau bas. Cela signifie que 15% des enfants n’atteignent même pas le niveau bas. Et globalement, on peut prendre TIMSS dans tous les sens, nos élèves obtiennent des résultats mauvais. Sur certains items nous nous situons au-dessus de la moyenne, mais enfin, ce n’est vraiment pas glorieux, c’est un euphémisme.
Un exemple : De l’obstacle langagier…
Penchons-nous donc sur un exemple d’exercice. Au niveau CM1-CM2, d’abord, cet exercice m’a intéressée :

Le taux moyen de réussite complète de cet exercice est 24%. En haut du tableau, Singapour avec 55%. Ensuite, 42 autres pays, et puis la France : 12% d’élèves ont réussi l’exercice. Quelques pays terminent le classement. Pourquoi 12% de réussite chez les élèves français ? Je ne peux faire que des conjectures, naturellement, d’autant que je ne dispose malheureusement pas des réponses. Comme j’aimerais pouvoir les étudier!!!
Que peut-il se passer dans la tête d’un enfant français devant cet exercice ? Ne répondez pas « rien ». C’est trop facile et surtout c’est faux. Nos élèves jouent le jeu et s’impliquent, dans leur majorité. Ils sont aussi intelligents que les enfants d’ailleurs. Mais manifestement, ils ne savent pas et ne savent pas faire les mêmes choses. Supposons que nous observons un élève qui accepte de réfléchir à la tâche : il y a dévolution. Et ensuite ?
D’abord, l’enfant doit réussir à lire la consigne : la déchiffrer et donner du sens aux mots. Nous connaissons les difficultés de lectures au cycle 3. Évidemment que nous perdons là quantité de réponses potentielles. Cela va bien dans le sens que la lecture est l’affaire de tous, même pour des enseignants de collège, même pour des disciplines autres que les lettres.
Ensuite, il faut comprendre le « et ». Je le trouve intéressant, cet exercice : il met en jeu de la logique. Encore au collège, y compris en cycle 4, nombre d’élèves interprètent le « et » comme un « ou ». Pourquoi ? Devrait-on revenir à des maths comme au temps des maths modernes ? Sans doute pas ; mais expliciter le sens logique du « et », du « ou » et expliquer que ces sens ne sont pas toujours ceux employés dans la vie courante est nécessaire. Surtout pour le « ou », qui peut signifier « l’un ou l’autre, et pas les deux » ou « l’un, l’autre ou les deux ». Le « et » semble plus simple, et il l’est. Mais pourtant il demeure mal compris. Il y a là un enjeu de langue et un enjeu mathématique.
Si un élève a compris l’idée de la consigne et a en tête qu’il y a deux contraintes à considérer, il faut qu’il dépasse un nouvel obstacle langagier : « impair ». Pour ma part, en 5e, certains de mes élèves ne savent pas ce que signifie impair. Pourtant, je vous assure qu’ils savent dire si un nombre est ou n’est pas dans la table de 2. Alors on peut supposer qu’en CM1-CM2, le mot « impair » ne soit pas forcément digéré. C’est par un travail fréquent, automatisé souvent, contextualisé d’autres fois, qu’on donne du sens aux mots. Par ailleurs, la parité n’est pas citée du tout dans les programmes de 2020. Je n’écris pas cela comme un reproche : un programme ne peut pas tout contenir, ni être exhaustif dans tous les éléments de langage à mobiliser. Mais il est déjà foisonnant, ce programme, et il n’est peut-être pas naturel pour un enseignant d’école d’aborder explicitement la parité. Pourquoi l’aborderait-il ? Dans quel but ? On parle beaucoup de double et de moitié dans le programme de cycle 2 (et pas du tout dans le programme de cycle 3), mais les mots « pair » ou « impair » n’apparaissent pas. Au collège c’est plus simple : l’arithmétique est un thème d’étude.
Extrait du programme de cycle 4

Au sens de la multiplication
Supposons qu’un élève ait lu la consigne, compris le mot impair, identifié la double contrainte. Il arrive à la question. À ce niveau, il doit avoir compris le sens de la multiplication, sans quoi il restera perplexe. Là encore, ce n’est pas le cas de tous les élèves. Certains connaissent même leurs tables (d’autres pas) sans avoir compris le sens de la multiplication. C’est que ce n’est pas si simple, de le comprendre. Il faut comprendre que c’est une représentation de l’addition itérée, mais pas seulement : la commutativité est une propriété qui fonde la compréhension du sens de la multiplication. Mais ce n’est ni simple, ni économe en temps, de faire comprendre la commutativité. Or, là encore, la commutativité n’apparaît pas du tout dans les programmes. Les enseignants qui s’appuient seulement sur ces textes de référence doivent eux-mêmes avoir cette pensée didactique, à laquelle ils n’ont pas forcément été formés, ou pas forcément assez, vu la part congrue de formations pour les mathématiques en master 2.
Mais imaginons qu’un élève ait fait le lien. Espérons qu’il connaît ses tables. Comment un élève français (que l’on sait souvent empêché par la pression évaluative de notre système et par un rapport à l’erreur inhibant) va-t-il réagir devant une activité de discrimination, dans laquelle il peut penser à plus de solutions (mais alors lesquelles donner ? A-t-il manqué une information ? Doit-il vraiment décider ?), ou bloquer sur une seule, habitué peut-être (ce serait dommage) à des problèmes à solution unique. Car on peut aussi réfléchir à des problèmes aux solutions multiples, ou sans solution du tout ; c’est formateur et passionnant à observer, mais c’est tellement éloigné de notre culture que souvent l’exercice met tout le monde mal à l’aise. Pourtant, dans la vie, des problèmes à solutions multiples ou sans solution, ça arrive, et chacun l’accepte. Et les maths font partie de la vie. Elles en sont une représentation, un langage.
30 n’est pas un nombre « complexe », par ailleurs. 30 est le produit de 1 et 30, de 2 et 15, de 3 et 10, de 5 et 6. Je me demande d’ailleurs si des élèves ont répondu « 30 groupes de 1 élève », et si cela varie selon les pays. Comme la consigne dit « Nombre d’élèves », au pluriel, j’ignore si cette réponse serait acceptée. Elle doit être très à la marge, de toute façon.
Cette fois, c’est la méthodologie de résolution de problèmes qui est à interroger. Mais finalement, cet exercice n’est vraiment pas que mathématique. Seule la décomposition en facteurs l’est réellement, dernier obstacle à surmonter. C’est très bien, et cela montre comme les disciplines ne devraient pas être aussi cloisonnées : les questions de langage, de structuration, d’interprétation, de logique, les concernent toutes.
12% de nos élèves ont réussi cet exercice. 12%. C’est douloureux, franchement. Et explicable, on l’a vu. Mais comment s’en contenter ? Peu m’importe la comparaison internationale en elle-même. Nous n’avons pas besoin des résultats d’ailleurs pour comprendre que nos enfants ne construisent pas suffisamment des outils pour comprendre le monde, pour communiquer.
Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ?
Claire Lommé