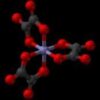mathématiciens (déclaration de l’ARDM, du 4 mars 2008) écrivent ceci : « La philosophie qui semble
présider aux programmes tend à opposer algorithmes et sens des
opérations, considérant la résolution de problèmes comme terrain
d’applications des algorithmes. Les études menées en
didactiques des mathématiques ont permis de montrer qu’au lieu de faire
précéder l’apprentissage des uns par celui des autres, il était au
contraire nécessaire de veiller à l’articulation des uns et des autres,
sans les disjoindre. »
Il
me semble qu’on peut dire exactement la même chose, mutatis mutandis,
du domaine du français : la philosophie de ces « nouveaux » programmes
tend à opposer étude de la langue et pratiques langagières, considérant
que les pratiques langagières ne seraient que le terrain d’application
des savoirs sur la langue.
En fait de nouveauté, il
semble que ces programmes fassent retour aux pratiques scolaires des
années soixante, châtiments corporels et intimidations en moins.
Ainsi la définition qui est
donnée du langage est indigente. L’articulation
entre langage et pensée est posée sans explicitation : la compréhension
orale est réduite à la syntaxe et au vocabulaire sans considération
aucune pour les marques d’énonciation (de temps, de lieu, d’identité –
seule la maîtrise du je est recommandée en PS -) ; la distinction
fondamentale entre langage en situation et langage d’évocation
disparaît ; il n’y a pas plus de référence à l’opposition entre code
implicite et code explicite. Que l’enfant développe son
langage parce qu’il y trouve un bénéfice symbolique, parce qu’il
élargit sa socialisation et parce qu’il verbalise sa singularité, qu’il
le développe en capitalisant les actes de parole réussis, tout cela
n’effleure qu’au bénéfice de l’institution scolaire : « se faire
comprendre pour les besoins de la vie scolaire », « prendre sa place dans
les échanges collectifs » (progression
pour la Maternelle, p. 21).
Le travail sur la compréhension
(en lecture) et sur la recevabilité (en production de texte) est non
moins indigent. Au C.P. et au C.E.1, la question de la
compréhension se dissout dans celle du déchiffrage, de « l’organisation
des phrases ou du texte », du vocabulaire et des connaissances
antérieures (p. 9). Au cycle 3, c’est « une analyse précise »
(p. 13) du texte qui doit la permettre. Faut-il lire dans
cette introduction des explications de texte une secondarisation de
l’école primaire ? En effet, le « repérage intuitif » (p. 13)
dont les élèves sont capables apparaît non comme la base du travail
mais comme une navrante concession, puisqu’il faut « aussi » (p. 13)
recourir à l’étude des marques de cohésion : étude de la ponctuation de
la phrase et du texte, temps verbaux, pronoms, champs
lexicaux… Il n’y a donc rien sur une réflexion sur le sens
même de l’acte de lire, sur les façons de s’y prendre, sur ce qu’on en
peut espérer. Seules sont mis en avant les activités qui
permettent au maître de contrôler la compréhension : « lire à voix haute
avec fluidité, reformuler, résumer, répondre à des questions » (p. 28)…
Et il faut aller chercher dans les progressions proposées pour le CE2
(apparemment cette question ne devrait se poser qu’à ce niveau et y
être définitivement résolue !) pour trouver quelque chose sur la
manière de restaurer la compréhension (p. 28).
Du côté de la production de
texte, rien. Il ne s’agit que de « rédaction »
(tout au long du texte), comme si l’écriture se résumait à la mise en
mots. D’ailleurs, comme guide à la « rédaction » ne sont
mentionnées que de mystérieuses « règles de composition et de rédaction »
(p. 13). Conformément à cette vision applicationniste, la
cohésion du texte, sa « précision », sa « richesse » et l’absence de
répétition semblent les seuls critères pour établir la qualité d’une
« rédaction » (p. 29). On ne considère nulle part son efficacité
éventuelle sur un lecteur, laquelle semble devoir découler
automatiquement de ces seuls aspects. Et comme le maître est
le seul invité à formuler des remarques (p. 29), on a l’impression
qu’il est l’unique lecteur envisagé. Il ne s’agit donc pas
d’apprendre à écrire en vue d’un usage autonome de l’écriture, mais
simplement de s’inscrire dans un rituel scolaire. Il est donc
logique qu’on ne trouve rien sur la planification ou la révision, rien
sur la recherche des idées, rien sur le repositionnement énonciatif et
social qu’exige l’écriture. Logiquement encore, l’effet en
retour de l’écrit sur son auteur n’est jamais envisagé.
La référence à la littérature
paraît une révérence prise en compte à regret.
En effet, rien ne distingue ce qui en est dit de ce qui est dit de la
lecture en général, sinon :
– la référence à une « culture
littéraire commune »
– le droit reconnu aux élèves d’
« exprimer leurs réactions » (et non pas seulement de répondre à des
questions du maître)
– la proposition de « mettre en
relation » les textes (p. 13).
L’interprétation
disparaît. Il n’apparaît donc aucune allusion à
la littérature comme socialisation des émotions, comme laboratoire de
la compréhension (des processus d’élaboration à ceux d’intégration),
comme expérience singulière du langage. Le sort fait à la
poésie est particulièrement emblématique : occasion de retenir des mots
évocateurs ou « amusants » en Grande Section (p. 21), elle disparaît (ou
plutôt elle est réduite à la récitation) jusqu’au Cours Élémentaire 2
où l’on ne trouve qu’une proposition d’ « écrire un texte poétique en
obéissant à une ou plusieurs consignes précises » (p. 29, c’est nous qui
soulignons). Rien, donc sur l’invention propre des élèves, la
patiente mise au jour des appétences langagières propres des
élèves… Dans ce contexte, le mot « culture » dans l’expression
« culture commune » ne signifie que la fréquentation d’un répertoire
défini, il ne s’agit apparemment pas de cultiver les élèves.
Alors, la littérature : un « vœu pieux » ? Un supplément d’âme
? Une marque de croyance aux effets magiques d’une
littérature dont la force serait immanente ? Un leurre, en
tout cas.
Symétriquement,
dans le domaine de l’étude de la langue, aucune référence n’est faite aux
connaissances en acte des élèves, à la grammaire
implicite, pourtant continûment évoquée dans les instructions
officielles depuis le plan Rouchette de 1971, les programmes de 1985,
ceux de 1995 puis ceux de 2002. Aucun tissage avec ce qui est déjà là
chez les élèves, aucun appel à la curiosité, à l’explicitation. Aucune
autre relation avec l’usage dans le langage qu’une omniprésente
relation de prescription et d’obéissance.
Ainsi, quel que soit le
domaine du français, langue, langage et parole sont clivés.
Et, au mépris de toutes les avancées en épistémologie (comme en
didactique), la langue domine le langage et la parole n’a point de
place. C’est partout un appel à l’obéissance de la « règle » et
au respect des normes. Qu’il s’agisse de lecture, d’écriture
ou d’étude de la langue, le scénario est clair : le maître sait, les
élèves appliquent, le maître contrôle. De pensée,
point. De curiosité, moins encore. De l’instruction
sans éducation.
Car ces « nouveaux » programmes
mésestiment quatre obstacles majeurs, attestés dans la
trajectoire de la plupart des élèves en difficulté. Nous
n’insisterons ni sur la réelle complexité
des objets à enseigner ni sur les simplifications réductrices qui se
trouvent ici promues (voyez cependant l’édifiante note 3 page 30 : elle
en suggère long sur le désintérêt porté à l’articulation entre
grammaire de phrase et compréhension du texte. Le rôle des
compléments de phrase dans l’organisation du texte est pour le moins
négligé…). Nous n’insisterons pas davantage sur la conception
de l’apprentissage, uniquement envisagé ici comme évidente réception de
la voix de son maître.
Mais
qu’on nous permette d’insister sur la pauvreté des pratiques
langagières de ces élèves. En effet, malgré ce qu’on voudrait laisser
accroire, les maîtres ne manquent pas de provisionner le vocabulaire
des élèves, de fournir et d’expliquer les procédures
efficaces. Mais
ces interventions n’ont d’efficacité que si les élèves en ont l’usage,
s’ils en ont besoin ; sinon elles font un emplâtre sur
une jambe de bois. Or les élèves en difficulté ont peu le
souci de se repérer dans le vaste monde, ils ne ressentent aucun besoin
de penser l’universel. Les mots – malgré ce qu’en veulent les
programmes – n’ont de valeur de précision et de structuration que par
opposition, parce qu’on hésite, parce qu’on a quelque chose à dire (à
écrire) dans la sphère où ces oppositions font sens. Ces
élèves n’ont souvent aucune aspiration au cosmopolitisme ni à
l’universel. Leur préoccupation essentielle (et qui recouvre
toutes les autres en général, et qui est également, le plus souvent,
aussi celle de leurs parents) est de l’ordre de la survie dans une
sphère locale, laquelle ne réclame pas d’autre précision que celle
qu’ils maîtrisent déjà. La centration obsessionnelle des
programmes sur « le » vocabulaire – le vocabulaire de la culture savante
et lettrée, en fait – veut soigner des symptômes, et non des causes.
Nous
insisterons aussi sur les effets de dissonance
culturelle. Il ne faut pas avoir observé trois fois une
classe de Grande Section de maternelle pour constater les obstacles à
la compréhension du principe alphabétique. Il ne faut pas
avoir tenté deux fois de faire mémoriser la conjugaison des verbes
prendre et rendre pour se heurter à l’absence de motivation et à
l’incompréhension. Une fois suffit pour éprouver combien il
est ardu d’entendre – seulement entendre – la moindre fable de La
Fontaine… La
culture que l’école tente de transmettre n’est pas celle de ces élèves.
Ils se trouvent ainsi en butte avec une culture exigeante qui n’est pas
la leur, et qui n’a plus de valeur perceptible. Non seulement
elle est bafouée par la multiplication de médias qui l’ignorent ou la
caricaturent, mais elle ne représente plus ni promotion sociale, ni
garantie d’emploi, ni prestige aucun ; elle est même discutée et
suspectée par ceux qui devraient être ses soutiens naturels (certains
parents d’élèves, certains intellectuels…). Elle semble au contraire
aux élèves un résidu du passé, une entrave à l’individualisme, à la
« débrouille ». La situation actuelle n’a donc rien de commun
avec les périodes anciennes où la culture scolaire incarnait l’espoir
d’un progrès collectif et personnel. Or si on n’obtient pas l’adhésion
des élèves au projet d’enseignement, s’ils n’y répondent pas par un
projet d’apprentissage, l’instruction ne peut être qu’une violence.
On sait les efforts considérables que font les maîtres pour faire
converger les pratiques propres des élèves et les pratiques scolaires,
ou au moins pour les faire dialoguer. Mais une absence de
prise en compte de la réalité du langage des élèves et un appel à leur
seule docilité, sans l’effort d’une médiation, ne peuvent que concerter
une sorte de maltraitance cognitive…
Ces « nouveaux » programmes
ne se fondent sur aucune légitimité qui viendrait d’avancées avouables
dans la connaissance des élèves, des objets d’enseignement ou des voies
de l’apprentissage. De
ces points de vue, ils véhiculent préjugés, idées toutes faites,
stigmates d’idéologies diverses… Comme on ne
voit aucun bénéfice pour des élèves en difficulté, on se demande bien
quel peut donc être le projet social et politique qui les
légitimerait… Voudrait-on introduire dans les murs de
l’école, ces murs qui accueillent tous les futurs citoyens, tous les
enfants porteurs d’avenir, une forme subtile de… lutte des
classes ?
Pierre Sève
Formateur
à l’IUFM d’Auvergne