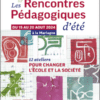Dans un récent article publié sur Cairn – site spécialisé dans la publication et la diffusion d’articles en sciences humaines, Guillaume Gros, professeur d’histoire-géographie et chercheur, revient sur l’histoire du collège français. Pour l’historien, le choc des savoirs est « symptomatique des dysfonctionnements structurels de notre système éducatif ». Il répond aux questions du Café pédagogique.
 Vous évoquez un choc des savoirs symptomatique des dysfonctionnements structurels de notre système éducatif. C’est-à-dire ?
Vous évoquez un choc des savoirs symptomatique des dysfonctionnements structurels de notre système éducatif. C’est-à-dire ?
Sur le plan purement factuel, le « choc des savoir », qui s’avère être une remise en cause du collège unique, est une tentative de réponse, dans l’urgence, comme souvent dans l’éducation nationale, aux résultats de l’enquête internationale PISA de 2023.
Or, dès le 15 décembre 2007, déjà sur la base d’une enquête Pisa, Luc Cédelle, dans Le Monde, cherche à attirer l’attention avec ce titre alarmant « Alerte sur le « niveau » scolaire ». Bien plus tôt, en 1997, dans un rapport destiné à Ségolène Royal, alors ministre déléguée à l’enseignement scolaire sont évoqués « des résultats inquiétants » : « ce sont entre 21 et 42 % des élèves qui, au début du cycle III (entrée au CE2), paraissent ne pas maîtriser le niveau minimal des compétences dites de base en lecture ou en calcul ou dans les deux domaines. Ils sont entre 21 et 35 % à l’entrée au collège ». En réalité, si l’on remonte encore plus loin, on s’aperçoit que la gauche, à peine arrivée au pouvoir en 1981, est déjà percutée par ces difficultés structurelles que doit gérer le ministre Alain Savary, liées à l’explosion des effectifs scolaires dans le collège unique confronté à l’hétérogénéité des classes. C’est dans ce contexte de crise systémique du collège que le gouvernement socialiste commande, en urgence en 1981, un rapport à Louis Legrand, notamment directeur de l’Institut national de la recherche pédagogique (INRP), qui fait alors l’objet d’une concertation entre acteurs institutionnels, parents d’élèves, syndicats à une époque où la gauche est encore capable de trouver de véritables relais dans les milieux syndicaux et pédagogiques.
Un des ratés du collège unique serait le « choix » d’enseignants disciplinaires et non polyvalents comme en primaire. Pourquoi ?
Le collège unique est une réponse politique ambitieuse dans un contexte de démocratisation scolaire sans précédent alors que l’on a allongé la scolarité obligatoire de 14 à 16 ans, tout en supprimant les filières notamment en fin de cinquième. Il ne faut pas oublier que le collège unique fait alors l’objet d’un consensus dans le débat politique avant d’être remis en cause au début des années 1980.
Au-delà de la question de l’hétérogénéité qui se pose très vite, il a fallu d’abord faire face à la massification scolaire en trouvant au pied levé des enseignants… Un vivier potentiel existe alors dans l’enseignement primaire dans lequel cohabitent un enseignement secondaire avec les écoles primaires supérieures (EPS) ou les cours complémentaires dont les cours sont assurés par… des instituteurs avec les méthodes du primaire et donc le principe de la bivalence et d’un encadrement plus personnalisé. Se pose alors une question qui divise les spécialistes : le collège est-il le prolongement du primaire ou une préparation au lycée modèle de l’enseignement secondaire tel qu’il s’est façonné depuis le XIXe siècle ?
Au lieu de fluidifier le système éducatif en développant au collège un enseignement polyvalent avec le personnel, la pédagogie et le savoir-faire du primaire, on a eu tendance à étanchéiser le collège en le réservant à des professeurs spécialisés dans l’enseignement d’une discipline issus du secondaire. De façon symptomatique, les professeurs d’enseignement général de collèges (PEGC) créés dans l’urgence du recrutement face à l’explosion scolaire et issus en général du primaire, et qui enseignaient le plus souvent, deux matières, disparaissent finalement en 1986. La tradition pédagogique du primaire et la bivalence, pourtant envisagée, dans de nombreux projets de réformes avortées du collège depuis 1981, reculent face au magister du professeur certifié ou agrégé du secondaire qui n’enseigne qu’une seule matière.
Vous pointez du doigt le manque d’accompagnement par les enseignants des élèves français – en comparaison avec leurs camarades des pays de l’OCDE. Est-ce la conséquence de ce choix ?
En effet, depuis 2001 dans une démarche internationale comparative, les enquêtes PISA pointent de façon récurrente, la difficulté de compréhension des consignes, le manque de confiance des élèves français, une motivation faible et un manque de persévérance car, au final, nos élèves préfèrent ne pas répondre à une question plutôt que de se tromper…
Même s’il n’y a jamais de solutions miracles dans l’éducation, disons que, de toute évidence, la secondarisation du collège n’a pas facilité la scolarité des élèves qui n’ont pas les codes scolaires. D’ailleurs, dès 1981, le rapport Louis Legrand, évoqué plus haut préconise des mesures plus accompagnantes : l’aménagement dans les classes de sixième et de cinquième de temps de travail en groupes d’élèves de niveau hétérogène et des temps en groupes de même niveau, le renforcement des liens entre l’élémentaire et le secondaire pour faciliter le passage en sixième, l’importance de l’évaluation formative plutôt que sommative, l’allongement de la durée de présence des enseignants au collège avec des missions autres que l’enseignement, la mise en place d’un tutorat afin d’aider les élèves dans leur travail et leur vie scolaire et le renforcement du travail d’équipe pédagogique et pluridisciplinaire.
C’est une question plus politique que pédagogique finalement. Comment l’expliquer ?
C’est une question très politique qui tient à plusieurs facteurs largement hérités de notre histoire éducative laquelle est souvent parasitée voire empêchée par des postures idéologiques entre les défenseurs d’une école républicaine et méritocratique centrée sur la transmission des savoirs ou les défenseurs des « pédagogues ».
La question de l’accompagnement des élèves ou du tutorat est depuis le rapport Legrand un serpent de mer dans de nombreux rapports. Comme le travail collectif, appelé aussi concertation chez les enseignants, doit-il être intégré dans l’emploi du temps, alors même que la conception du métier reste plutôt très individualiste. Souvent perçue ou considérée comme un coin enfoncé dans l’essence même de la fonction qui est de transmettre, la vision collective, sauf dans certains établissements de type éducation prioritaire, n’est pas dans la culture du monde enseignant. Il s’agirait davantage, comme l’évoquent Philippe Champy et Roger-François Gauthier, d’une révolution des mentalités afin de « repenser les savoirs enseignés » (dans le livre Contre l’école injuste !) pour ne pas réduire l’élève à une seule discipline. C’est déjà le cas dans d’autres pays européens, dont les systèmes sont davantage adossés à un travail collectif, en fonction de compétences à acquérir, afin de rendre plus lisibles les attentes des enseignants pour les élèves et les parents soucieux de les aider et ainsi de faire baisser cette anxiété des élèves français relevée dans les enquêtes Pisa.
La réforme de recrutement des enseignants en proposant, comme le souhaitent Emmanuel Macron et Gabriel Attal, une formation dès l’après-bac, professionnalisante dans l’esprit des anciennes Ecoles normales, « écoles normales supérieures du professorat » (ENSP) semble réactiver le débat, sur la primarisation de l’enseignement envisagée au détriment de l’université.
Propos recueillis par Lilia Ben Hamouda