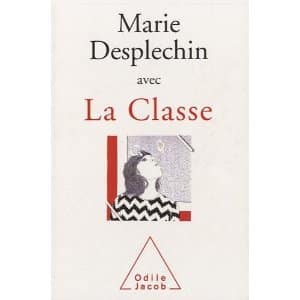La Classe ou comment brouiller le jeu scolaire
Sommes-nous assignés à résidence, géographique, sociale, culturelle, linguistique, scolaire ? C’est la question, dérangeante, qui hante le projet pédagogique présenté par la romancière Marie Desplechin dans son récent livre La classe. A sa concrète et donc modeste façon, dans le cadre d’un séminaire qu’elle animait à Sciences-Po Lille, elle a organisé la rencontre « sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie», en l’occurrence, plus radicale encore que Lautréamont, une collaboration entre des élèves de troisième d’un collège dit « des quartiers » et des étudiants en master de management des institutions culturelles : rendez-vous réguliers au collège Paul-Verlaine, séances d’entretiens éduquant l’étudiant à l’écoute et le collégien à l’estime de soi, travail d’écriture invitant à retranscrire de la façon la plus juste possible les témoignages des adolescents interrogés, leurs parcours et leurs aspirations. Le recueil, polyphonique, de ces « autoportraits à deux » vient de paraître, précédé d’une préface où Marie Despleschin explique le déroulement de l’atelier, ses enjeux et ses difficultés.
L’auteure raconte la naissance et les différentes étapes du projet, mené en étroite collaboration avec la principale du collège Paul-Verlaine, Cécile Trémolières, et deux professeures de français Laurence Dequidt et Marie-Juliette Robine. Il s’agit bien pour elles de lutter à l’intérieur même du système scolaire contre un « apartheid social », qui condamne au silence et aux clichés : « Nous avions été capables, tous ensemble de faire entendre la parole de gens qu’on n’écoute pas si souvent, faute aussi de les questionner. ». Le projet sert de révélateur, y compris pour les étudiants de Sciences-Po, qui expriment réticences voire hostilité, qui paraissent eux-mêmes emprisonnés dans leur logique élitiste d’appartenance à une « grande école », obnubilés par la réussite, la rentabilité du travail, les notes : « ils attendent qu’on leur fournisse des savoirs, des modes d’emploi », « je pense réalisation, ils pensent diplôme ». Les témoignages recueillis auprès des collégiens et soigneusement retranscrits dévoilent aussi certains traits de caractère récurrents, notamment l’importance de l’école (« serait-ce un des acquis de l’éducation prioritaire que les élèves aiment leur collège, à défaut de pouvoir entrer dans les exigences de la scolarité ? »), la place essentielle de la famille (« on apprendra pas mal de choses sur (…), la douleur des séparations, l’absence des pères et la place qu’occupent les mères adulées »), les connexions religieuses et géographiques (« affectivement, culturellement mondialisés, ils imaginent pourtant difficilement quitter l’endroit où ils sont nés »). L’essentiel est cependant ici dans ce qui se joue entre, dans cette relation singulière entre étudiants et collégiens que Marie Desplechin a su instaurée : le projet, fondé sur la rencontre, l’écoute et l’écriture, cherche à développer la « capacité d’empathie » chez les portraitistes (on ne peut faire « l’économie de ces multiples expériences empathiques qui permettent la déstabilisation du sujet », écrit Elisabeth de Fontenay citée par l’auteur) ; le plaisir du lecteur naît précisément du frottement entre les langages et les milieux (« L’émotion qui se dégage des portraits réside pour beaucoup dans le lien noué entre les deux parties (…). Il faut vraiment bien aimer quelqu’un pour en rendre loyalement l’image. Il faut l’aimer pour ce qu’il est, et ne vouloir ni le dénigrer ni l’améliorer. »)
L’école peut-elle être encore un lieu de mixité et non de ségrégation ? Ce beau défi, nous rappelle Marie Desplechin, est affaire de pédagogie autant que de politique. Cela suppose que, dans le théâtre scolaire et social, les différents acteurs bougent, pas simplement qu’aient lieu d’occasionnelles rencontres (par exemple, les journées d’immersion des CM2 en sixième ou de lycéens à l’université, les portes ouvertes en lycées professionnels), mais bien que se mettent en place des activités collaboratives (on se souvient peut-être d’un projet présenté par Claire Berest au Forum des enseignants innovants 2012 qui invitait une classe de seconde et une classe de sixième à échanger et partager autour des préjugés de genre, ou encore du travail intergénérationnel mené par Monique Argoualc’h, qui conduit ses élèves de classe relais à initier des personnes âgées aux joies du numérique). Cela suppose aussi de concevoir qu’une matière comme le français n’est pas à elle-même sa propre finalité, que l’écriture peut y avoir un sens autre que scolaire, qu’on peut s’élever par les mots pour apprendre à sortir de soi et partir à la rencontre de l’autre.
Avant sa palme d’or Entre les murs, sur l’enfermement et l’encombrement dans l’entre-soi d’une classe de collège, le cinéaste Laurent Cantet avait réalisé le beau film Ressources humaines, sur la difficulté de l’ascension scolaire et sociale vécue comme une trahison. Il s’achevait sur une question, terrible, que le projet de Marie Desplechin pose aussi d’une certaine façon, mais en invitant avec bonheur tous les pédagogues à faire enfin bouger les pièces sur l’échiquier : « Et toi, elle est où ta place ? »
Le livre :
http://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/classe_9782738128829.php
Sur France-Culture, une rencontre entre Marie Desplechin et Tanguy Viel : http://www.franceculture.fr/oeuvre-la-classe-de-marie-desplechin
Marie Desplechin :
« Travailler à une langue commune,
qui respecte la parole de chacun et la transmette aisément »
Marie Desplechin est journaliste, écrivaine et scénariste. Elle vient de faire paraître aux Editions Odile Jacob un ouvrage, La Classe, qui restitue un projet original : faire écrire par des étudiants de Sciences Po des autoportraits de collégiens, en l’occurrence des élèves de troisième du collège Paul-Verlaine, à Lille. Elle éclaire ici cette expérience déstabilisante, qui fait se rencontrer ceux qui se croisent à peine, qui mélange aussi les genres, en se situant quelque part entre la pédagogie, le journalisme et la littérature.
Comment ce projet est-il né ? quelles étaient vos motivations à l’origine ?
J’étais venue à Science Po Lille à l’invitation d’Hélène de Talhouet, qui dirigeait un master orienté vers les métiers de la culture, pour rencontrer ses élèves et leur parler de mon parcours « professionnel ». Nous avons déjeuné avec elle et le directeur de Science Po Lille, Pierre Matthiot. Dans la conversation, je m’étais fait la réflexion qu’il serait formidable tant pour le quartier que pour les étudiants que ces derniers travaillent hors des salles de cours, dans leur environnement, avec ceux qui y habitent et y travaillent. La politique, en somme. J’ai été prise au mot. Deux mois plus tard, nous avions rendez-vous dans un collège situé à un petit quart d’heure à pied de l’école. J’étais très contente parce que j’aime bien les collégiens, ce qu’ils disent m’intéresse. J’ai donc tenté de faire intervenir les étudiants comme j’interviens moi-même, pour favoriser l’accès à la parole de gens qu’on n’entend pas, soit qu’on ne pense pas à leur demander ce qu’ils savent du monde, ou que l’accès à l’écriture soit plus compliqué pour eux que pour d’autres, formés à la technique.
Vous racontez dans la préface que le projet a suscité quelques résistances chez les étudiants : sur quels aspects du projet portaient-elles ? comment les expliquez-vous ?
J’ai rencontré une opposition presque immédiate parmi les étudiants (pas tous, mais un groupe suffisamment influent pour entraîner une ambiance calamiteuse) qui n’a pas faibli et se poursuit aujourd’hui. J’ai eu beaucoup de mal à me l’expliquer, et j’hésite encore à en tirer des conclusions. Je crois que nous ne nous sommes pas compris du tout. J’avais dans l’idée de travailler « en conditions réelles » : on part sur un projet, sans garantie de réussite, on avance ensemble, et on voit. Eux étaient dans l’idée d’un « cours » : un exercice reproductible, dont les résultats sont connus d’avance, et qui est noté. J’ai tenté d’échapper aux notes, ridicules en « conditions réelles » et sur un projet collectif. Mais il semblait impensable de ne pas noter. (je n’ai jamais rencontré les responsables administratifs de l’école, je n’ai eu de contact qu’avec Hélène de Talhouet et Pierre Matthiot, il me semble que le projet est resté à la marge.de l’institution). J’ai donc assuré qu’aucune note ne serait pénalisante et qu’elles seraient toutes négociables, rien n’y a fait. J’avais par ailleurs demandé un compte-rendu de lecture sur un ouvrage approchant d’une « littérature du réel », et on m’a dit (à raison je crois) que les étudiants étaient écrasés de travail. Cette lecture, qui me semblait nécessaire pour aider à penser son propre travail d’écriture, a été prise comme une contrainte inutile. Enfin, demander à des élèves « de quartier » ce qu’ils pensaient de leur vie a été assimilé à une entreprise de voyeurisme, on m’a dit que je cherchais le « trash ». Les étudiants qui veulent bien faire du soutien scolaire aux enfants sont sans doute tétanisés à l’idée d’aller un peu plus loin. Je pense que leur vision de l’intervention sociale est essentiellement caritative. Par ailleurs, ce travail n’avait « pas de rapport avec leur cursus « (management des institutions culturelles), car il relevait plus du « journalisme ». Il me semblait à moi qu’il y avait une quantité de choses à apprendre de l’expérience, qu’elle réussisse ou qu’elle rate, et tant au point de vue du management que de la culture, mais je ne suis pas parvenue à faire partager ce sentiment. Bref, la défiance à été constante.
Cela dit, en classe (quatre séances en tout), les étudiants ont globalement joué le jeu (même si les quelques absences aux rencontres ont été de leur fait et non du fait des collégiens). Mais on devine dans les textes des investissements très différents. Seule une étudiante a bien voulu conserver des relations avec moi après la fin des cours obligatoires, et je lui en suis reconnaissante. Ce n’est sans doute pas un hasard si elle fait partie des rares élèves (deux sur quarante-deux) à venir d’une famille « issue de l’immigration ». J’ai le sentiment qu’elle a été la seule à me considérer comme une personne, et non comme un instrument diplômant (ou pas). Aucun n’a tenu à conserver un lien avec son collégien ou sa collégienne. Aucun ne m’a écrit ou téléphoné au moment de la parution des articles, de la fabrication du livre, de sa sortie. Les parutions dans Le Monde (signées par les auteurs) ont pu être considérées comme une manipulation de ma part. Et je ne parle même pas du livre, qui porte mon nom sur la couverture… Je suppose qu’on soupçonne des bénéfices considérables pour moi dans l’affaire (ce qui est idiot, financièrement c’est zéro, et pour l’image je me débrouille très bien autrement). Alors, je suis responsable en bonne partie de ce fiasco. Je n’aurais jamais dû accepter un cours obligatoire, mais un projet optionnel. J’aurais dû assumer un rôle d’adulte en situation de maître (autorité, vouvoiement etc.). Faire valoir, imposer… je ne sais pas quoi. Mais c’était mal parti, je ne tiens pas à être prof. Je voulais créer un objet de partage, essaimer un type d’écriture que j’ai pratiqué, inviter à la réflexion, mettre en commun l’expérience excitante de la « fabrication », ouvrir, former en fait… C’est un peu vaste pour quelqu’un qui a une idée aussi généreuse que foutraque de la pédagogie (surtout en direction des jeunes adultes).
Cela écrit, j’ai demandé, à la fin des « cours » des évaluations que quelques-uns ont bien voulu me remettre. Une dizaine étaient favorables, et même pour cinq ou six vraiment chaleureuses. Mais je me dis que le stress de la fin du parcours, des examens, des stages, de l’entrée si dure dans un monde professionnel fermé, empêchait de fait que les choses se passent bien, heureusement pour nous tous. J’en ai tiré une conclusion : les écoles sélectives ont une drôle de façon de former les esprits et les comportements. Une autre : si je dois travailler à nouveau avec des jeunes gens, ce sera dans un cadre optionnel, et plutôt avec des étudiants en université où l’idée de la rentabilité opérationnelle à court terme est peut-être moins présente que dans une école « d’excellence ». Ou alors, je chercherai à travailler avec des jeunes gens qui en ont terminé avec leurs études et le stress qu’elles génèrent.
Parmi les collaborations rares que le projet met en œuvre, il y a aussi celle entre professeurs et auteur : quels profits et plaisirs tirez-vous en tant qu’écrivain d’une telle coopération ?
J’ai une très grande satisfaction à être admise dans le monde professionnel des autres. Je suis curieuse, avide d’apprendre et de comprendre, de découvrir des logiques et des pratiques différentes de la mienne qui éclairent ma façon de penser et de vivre. Et ce d’autant plus que ce métier est « politique ». L’école est au centre de la société. Là, tout peut changer, tout peut se gripper. Je suis extrêmement reconnaissante à Cécile, Laurence et Marie-Juliette d’avoir partagé avec moi un peu de leur quotidien, de leurs doutes, de leurs satisfactions, et de poursuivre ce compagnonnage amical jusqu’à aujourd’hui.
Dans votre préface, vous citez quelques lignes de James Agee que vous dites considérer « comme un texte sacré » : en quoi éclairent-elles vos aspirations et démarches ?
L’histoire de ce livre (Louons maintenant les grands hommes) est très particulière. Parti pour faire un reportage, le jeune James Agee est happé par ceux qu’il rencontre, et écrit hors de toute raison ce volume excessif dont le propos sera pour finir non d’informer mais de rendre justice de manière exhaustive à l’humanité à laquelle il a compris qu’il appartenait, comme un frère, comme un sujet. Ce qui me touche dans ces quelques phrases de l’introduction est le respect stupéfié pour ce qu’il découvre de sacré, au sens religieux du terme, dans la figure de l’autre. Et la leçon qu’il en tire pour lui-même.
Parmi les invitations lancées aux étudiants, il y a celle à « apprendre, « entendre » et « ressentir » : l’école vous semble-t-elle selon vous éduquer suffisamment les jeunes à le faire ?
Si on parle de « l’école », en général, c’est non. Je ne pense pas énormément de bien de la manière dont « l’école » fonctionne. Je ne range pas « les enseignants » dans ce désappointement. « Les enseignants » sont soumis, comme les élèves (et les responsables d’établissements), à un système qui ne se prive pas de les abîmer et de faire souffrir. Mais ils sont aussi à même de faire un bien inestimable et même des miracles. J’ai eu la chance de rencontrer, dans le cours de ma scolarité, une institutrice puis des professeurs qui ont bouleversé mon existence en fabriquant mon rapport au monde et à la connaissance. Et j’ai la chance de connaître toujours des gens merveilleux qui exercent ce métier avec un talent et une foi qu’on dirait à l’épreuve de tout. J’ai une admiration mêlée d’envie pour ceux qui exercent un métier qui est évidemment beaucoup plus qu’un métier.
Dans l’invitation à « entendre », il y a ce souhait que les étudiants puissent restituer dans leurs textes la musique propre de chaque collégien interrogé : comment cette « musique » se manifeste-t-elle selon vous dans les portraits rédigés ? avez-vous accompagné les étudiants dans ce travail sur la langue ? dans quelle mesure ce souci de la voix habite-t-il aussi votre travail d’écrivain ?
Difficile de faire l’analyse stylistique de tout ce qui entre de technique dans un texte réussi… C’est un travail de détail, très fin, très ajusté. Très intuitif aussi. On le voit bien a postériori. A priori, ce serait une entreprise épuisante, et assez vaine.
Pour la qualité du rendu, tout dépend des portraits. Si vous prenez celui de Fenty, la musique y est, indéniablement. Je revois la jeune fille en lisant son texte. Je n’ai pas repris un mot. Et je n’aurais sûrement pas fait aussi bien. L’étudiante avait l’oreille (pas très loin du cœur). Il y a là un don flagrant. Pour d’autres en revanche, il y a eu une sorte de trahison. L’étudiant a par exemple « amélioré » le propos, pour lui donner une valeur plus « littéraire » à son goût. C’est un contre sens, et surtout un défaut de justesse de ton. Je n’y vois pas de « mauvaise intention », au contraire : il s’agit de redorer ce qui semble insatisfaisant, en fonction de son sens de la valeur. Mais c’est un manque de confiance dans l’autre. (Avec l’éditeur nous avons à quelques reprises pris le parti d’éliminer, à la relecture, des remarques qui apparaissaient clairement comme des ajouts « esthétiques », lexique désuet, formulations ampoulées, qui n’entraient clairement pas dans le propos du collégien.) Il y a enfin des maladresses (répétitions, syntaxe maladroite) sans grande conséquences, que nous avons rectifiées chaque fois qu’elles ne tenaient ni au sens ni au style du collégien. Pas grave, et même normal. Tout le monde ne peut pas avoir l’oreille absolue.
Entre le premier rendez-vous et le dernier (le quatrième), j’ai demandé qu’on m’envoie le travail en cours, et beaucoup suggéré, sans imposer (je tenais à ce que chacun soit responsable de son texte). J’ai été suivie, ou pas. Il m’est arrivé de proposer des exemples de reprise. Il est souvent plus aisé de travailler quand on a vu faire un autre. J’ai voulu faciliter l’écriture, enlever de la crainte, de l’inhibition (curieusement les étudiants de formation littéraire étaient les plus coincés, une injonction paralysante sans doute). Par ailleurs, j’ai essayé de convaincre ceux qui estimaient que leur collégien n’avait « rien à dire ». Je ne crois pas que personne ait « rien à dire ». Il faut juste attendre et entendre ce qui arrive. Mais bon… Il est plus difficile de travailler sur l’empathie que sur l’écriture…
Cela dit, la majorité des textes se tiennent bien, même si certains auraient pu être meilleurs. Mais sur une bonne trentaine d’entretiens, je me dis que globalement nous nous en sommes bien sortis.
Je suis persuadée, d’expérience, que chaque être a sa musique, comme il a son ADN. Elle peut être plus discrète, mais elle est là pour qui tend l’oreille. Pour mon propre travail, je ne sais pas… Écrire pour les enfants demande sans doute une certaine oreille. Par ailleurs, j’ai souvent écrit des textes co-signés, ou des textes pour d’autres, à partir de leur voix. C’est aussi une question de formation. Après des études de lettres classiques, j’ai fait une école de journalisme. J’aime et je connais une quantité de textes, d’écrivains, de journalistes, de sociologues aussi, qui travaillent à la croisée des genres. J’ai une quantité de noms et de titres à votre disposition pour une prochaine fois…
Vous soulignez qu’ « on retrouve les rédacteurs dans les textes » : comment cette présence affleure-t-elle ? est-elle le signe d’une distance ou d’une proximité ?
Quand on retrouve le rédacteur positivement, c’est son empathie qui éclaire le texte. Une « mise au service de ». On voit sa finesse, son goût du rythme, du mot juste, on devine le moment ou telle expression frappe son oreille, on suppose son sourire, son effarement, on épouse son écoute… On le voit écouter. Portraits d’Anissa, de Fenty à nouveau, de Mathilde, de Guillaume. Le texte est une reconstruction mais une reconstruction fidèle, attentive, respectueuse de la singularité du modèle.
Quand on le retrouve négativement, on pressent qu’il sonne faux. Ce mot-là ? Vraiment ? Répété ? Et cette phrase alambiquée ? Est-elle passée par la voix ? Qui parle comme ça ? Cette construction un peu ambitieuse, elle sert l’ambition de qui ? On voit l’écrivant écrire. On pèse le poids de son effort pour donner forme à ce qui n’apparaît pas clairement. C’est souvent un défaut de jeunesse. En faire trop, c’est une erreur que l’on apprend à corriger.
A travers votre projet se croisent et « se frottent » les milieux, les âges, les lieux, mais aussi peut-être les langues. Vous racontez par exemple que les « ne » explétifs ont finalement été rétablis dans les textes parce que leur élision aurait été discriminante : pouvez-vous expliquer ? de manière générale, comment faire selon vous pour que ces langues ne soient pas étrangères les unes aux autres ?
C’était une remarque des secrétaires de rédaction du Monde : on rétablit le ne explétif dans les propos de Nicolas Sarkozy, pas de raison qu’on n’applique pas la même règle aux collégiens de Verlaine. Je ne les remercierai jamais assez de cette leçon « professionnelle ». Cela dit, je pense que nos langues ne sont pas si étrangères les unes aux autres. On peut se comprendre entre générations, milieux et lieux, encore faut-il commencer par se parler, et s’écouter. Et le faire à hauteur d’individu, pas de génération, milieu ou lieu. Disons aussi que j’aime travailler à une « langue commune », qui respecte la parole de chacun et la transmette aisément. Ce que le documentaire sonore réussit grâce au montage et à la mise en scène du propos, le texte peut le faire par des moyens comparables. Il y a bien sûr une question de technique (maîtriser la langue écrite est une affaire assez compliquée), mais avant tout de vision, de projet. Bref, il ne suffit pas de savoir écrire. Mais il faut savoir écrire.
On sent que cette expérience a pu être dans une certaine mesure initiatique : finalement, en quoi a-t-elle changé selon vous les collégiens ? les étudiants ? vous-même peut-être ?
Je n’en sais rien… J’aimerais garder le contact avec certains des collégiens, retravailler avec eux pourquoi pas dans les années qui viennent. Avec certains, j’ai la certitude que n’être pas arrivée au bout de l’histoire, et même d’être passée à côté.
Ensuite, je ne crois pas qu’une seule expérience de ce type ait le pouvoir de changer la vie de qui que ce soit. Ce serait trop facile. Mais j’aimerais qu’elle reste un bon souvenir, un petit motif de fierté pour les collégiens, un repère utile en temps de doute : « ce qu’ils avaient à dire était une nouvelle pour leur pays ». Cela dit, j’ai constaté, en revenant au collège cet hiver, qu’une désormais lycéenne s’était lancée dans la rédaction de son autobiographie (qu’elle a bien l’intention de me faire lire)… Je corresponds avec une autre jeune fille à qui j’ai envoyé des livres. Il y aura peut-être sur certains l’effet d’une rencontre. Ce serait bien. Mais difficile à évaluer.
Pour les étudiants, c’est un mystère. J’aimerais savoir ce qu’ils deviennent. L’un d’eux m’a écrit dernièrement une lettre émouvante, sur ses réticences et sur ce qu’il avait compris, finalement, de l’expérience. C’est une très belle lettre de jeune homme, à la fois littéraire et juste. Je ne crois pas qu’il tienne a rester en contact, ce que je regrette. Mais il m’a fait le cadeau de me dire que quelque chose avait bougé. Je garderai, j’espère, des liens amicaux avec Cécile, Laurence et Marie-Juliette.
Le livre :
http://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/classe_9782738128829.php
Sur France-Culture, une rencontre entre Marie Desplechin et Tanguy Viel : http://www.franceculture.fr/oeuvre-la-classe-de-marie-desplechin