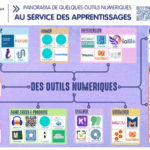Pourquoi porter aujourd’hui à l’écran « La Douleur » de Marguerite Duras, une œuvre autobiographique sur un sujet tragique –le récit de la jeune femme rongée par l’attente du retour des camps de concentration allemands de son mari résistant arrêté à Paris en juin 1944 ? Comment trouver le style cinématographique apte à transfigurer un texte dérangeant, à la lisière du témoignage, de l’introspection et de la fiction, qui suscite trouble et malaise lors de la sortie du livre en 1985 ? En s’attachant à la spécificité de l’écriture durassienne, le cinéaste Emmanuel Finkiel en recrée la précision sèche, la scansion obsédante et le propos radical, avec les moyens de son art. Il choisit de demeurer aux côtés de Marguerite, d’épouser son regard que la voix off prolonge en un ‘voyage intérieur’.
 Plus proche de l’évocation suggestive que de la reconstitution historique, la réalisation se focalise sur la description clinique du ‘désordre phénoménal de la pensée et du sentiment’ dans lequel plonge Marguerite, prise dans un maelstrom d’affects contradictoires, qu’elle nous livre sans pudeur. Dans ce temps suspendu, entre l’arrestation et la libération, nous l’accompagnons, visage fatigué, corps usé, prise entre la liaison secrète avec son camarade de résistance Dionys, la relation trouble entretenue avec un agent français de la Gestapo, supposé lui venir en aide, et le lien avec son mari absent, dans l’attente lancinante, exténuante, de sa présence à venir. Et un miracle se produit : tout en restant au plus près de la substance littéraire, « La Douleur » fait émerger l’expérience intime d’une jeune femme-à la fois créature tourmentée, résistante solide et écrivain en devenir-confrontée à l’innommable. Au-delà du point de vue de l’héroïne, incarnée jusqu’au vertige par la comédienne Mélanie Thierry, le film d’Emmanuel Finkiel lève aussi le voile sur une période historique peu explorée : dans la confusion des premiers temps de la Libération, la culpabilité des survivants, le silence des rescapés, l’horreur indicible des camps, la tentation de l’oubli.
Plus proche de l’évocation suggestive que de la reconstitution historique, la réalisation se focalise sur la description clinique du ‘désordre phénoménal de la pensée et du sentiment’ dans lequel plonge Marguerite, prise dans un maelstrom d’affects contradictoires, qu’elle nous livre sans pudeur. Dans ce temps suspendu, entre l’arrestation et la libération, nous l’accompagnons, visage fatigué, corps usé, prise entre la liaison secrète avec son camarade de résistance Dionys, la relation trouble entretenue avec un agent français de la Gestapo, supposé lui venir en aide, et le lien avec son mari absent, dans l’attente lancinante, exténuante, de sa présence à venir. Et un miracle se produit : tout en restant au plus près de la substance littéraire, « La Douleur » fait émerger l’expérience intime d’une jeune femme-à la fois créature tourmentée, résistante solide et écrivain en devenir-confrontée à l’innommable. Au-delà du point de vue de l’héroïne, incarnée jusqu’au vertige par la comédienne Mélanie Thierry, le film d’Emmanuel Finkiel lève aussi le voile sur une période historique peu explorée : dans la confusion des premiers temps de la Libération, la culpabilité des survivants, le silence des rescapés, l’horreur indicible des camps, la tentation de l’oubli.
La torture de l’attente exposée
Quelques indications de dates situent l’action. Dans une construction chronologique plus linéaire que dans le livre, la fiction suit les affres de Marguerite (Mélanie Thierry, saisissante) après l’arrestation (en juin 1944) de son mari Robert Antelme, écrivain et figure de la Résistance. Seule dans un appartement à Paris à côté du téléphone, dans l’angoisse suscitée par l’absence de nouvelles, les hypothèses, des plus raisonnables aux plus terribles, lui traversent la tête. Elle formule même à voix haute l’idée de sa propre mort à elle pour échapper à l’annonce de la disparition de son époux. Elle oscille périodiquement entre le sentiment de lâcheté et des accès de folie ou des élans d’espoir, parfois secouée par des crises de désespoir, ouvertement condamnées par son amant D. (Benjamin Biolay, juste), soutien constant, veilleur lucide.
Un concours de circonstances lui fait croiser le chemin de Rabier (Benoît Magimel en salaud magnifique), agent français de la Gestapo, responsable de l’arrestation de son mari (incarcéré à Fresnes avant d’être déporté). L’homme l’assure de son aide, sa position lui permettant de favoriser le contact avec le prisonnier. Au fil des rendez-vous inopinés, dans des lieux ouverts, à des heures insolites, dans le Paris encore sous la botte allemande, nous suivons les pas de Marguerite, tour à tour jeune intrépide, résistante aux aguets et séductrice consciente, face à cette ‘belle ordure’ (selon les termes du réalisateur) au jeu trouble. Entre le goût affiché pour la littérature française, la fascination pour l’intellectuelle et le souci d’obtenir des renseignements sur le réseau de résistance, sous-tendant l’attitude de son interlocuteur, Marguerite nous livre un visage, tantôt nu tantôt maquillé, aux émotions changeantes, tandis que sa voix off commente le paradoxe de sa situation, en un dédoublement perturbant.
La folie de l’absence
En réunissant les premiers textes constitutifs de « La Douleur », le cinéaste introduit une forme de suspense dans le déroulement du quotidien terrible de l’héroïne : le collaborateur Rabier (sujet du volet ‘Monsieur X. dit Pierre Rabier’) fait irruption dans son existence comme l’autre visage de la France de l’époque. D’un côté, Dionys, amant discret et camarade de résistance, de l’autre, l’auxiliaire zélé et convaincu des nazis. Ainsi l’abominable attente, dans ce non écoulement du temps, dans cette agonie silencieuse, Marguerite la comble-t-elle par la présence intermittente et contradictoire de deux hommes que tout oppose. Des fréquentations masculines qu’elle perçoit, plus ou moins consciemment, comme lâcheté et trahison par rapport à l’absent en danger de mort.
Subtilement, la mise en scène met au jour le passage rageur à l’action lorsque des informations nouvelles mettent Marguerite sur les traces de Robert à travers les témoignages de camarades revenus des camps. D’autres reviennent, la Libération de Paris se profile, et pourtant Robert ne revient pas, jusqu’au coup de téléphone d’Allemagne du chef de réseau, François Morland [François Mitterrand] enjoignant des camarades de venir rapatrier d’urgence, Robert Antelme, de Dachau à Paris, compte tenu de sa faiblesse extrême.
Au moment du retour du déporté, le réalisateur choisit de radicaliser le mouvement d’effroi et le hurlement de refus décrits par Duras dans son texte. Dans un premier temps, nous la voyons fuir physiquement l’appartement et la confrontation avec le rescapé. Dans son livre, Duras décrit ensuite avec précision la vision de ce corps méconnaissable, la lente et douloureuse reconstruction physique, la réappropriation corporelle, le rétablissement des principales fonctions naturelles jusqu’à la possibilité de se nourrir normalement. Le cinéaste, en revanche, amplifie son propos à l’extrême : il ne nous montre pas ce corps dévasté et le parti-pris ne fait pas qu’épouser la subjectivité de Marguerite. Il revendique l’impossibilité de la représentation, l’obscénité du cliché et de l’image convenue. Une radicalité portée jusqu’à la dernière image d’un jour sur une plage d’Italie en plein soleil. La voix off de Marguerite accompagne la silhouette frêle et floue de Robert avançant vers la mer et se découpant en contrejour dans le lointain, en un ultime plan incandescent et énigmatique.
Cinéma et écriture, subjectivité et correspondances
Le cinéaste Emmanuel Finkiel assume le caractère ‘brûlant’ de ces écrits de Marguerite Duras, laquelle se demande en 1985 en prélude à leur publication : ‘comment ai-je pu écrire cette chose que je ne sais pas nommer et qui m’épouvante quand je la relis ?’. En trouvant des voies aptes à figurer les méandres de la subjectivité de son héroïne, servie par l’interprétation subtile de Mélanie Thierry, il prend à bras-le-corps les questions dérangeantes soulevées par pareille entreprise d’écriture. En faisant résonner à nos oreilles la prose nerveuse et saccadée en voix off, il suggère par ses images les flux et reflux des affects à l’œuvre dans la tête de Marguerite, des affleurements conscients aux pulsions inconscientes, comme autant de mouvements contradictoires qui l’habitent successivement dans l’étirement temporel d’une attente épuisante. Aux frontières de la folie. Jusqu’au vertige. La mise en scène parvient même, sans juger, à rendre perceptible l’indécence scandaleuse d’une telle formulation, au regard du destin tragique subi par la plupart des déportés, compte tenu de l’entreprise d’anéantissement voulue par les nazis.
L’arrière-plan historique, du Paris occupé en 1944 à l’orée de sa libération en juin 1945, n’est pas qu’un décor mental au gré des pérégrinations de Marguerite. En quelques traits stylisés, se dessinent les lieux de détention et leurs cortège désolés de femmes aux visages inquiets en quête de visites ou de nouvelles des prisonniers, les restaurants cossus et bruyants où des convives français bien mis déjeunent en compagnie d’officiers allemands, les immeubles gris et les rues sans grande circulation automobile et leurs trottoirs lourds de dangers potentiels et d’arrestations imminentes. Nous saisissons ainsi d’où vient l’attirance du cinéaste pour de tels écrits, qui entrent en résonance, dès son remarquable premier film « Voyages » [1999], avec son histoire familiale, celle de son père en particulier, hanté par l’attente sans fin du retour d’un père, d’une mère et d’un petit frère, disparus à Auschwitz.
En un geste cinématographique d’une grande audace formelle, dans l’absolue fidélité à la démarche de Marguerite Duras, « La Douleur », le film d’Emmanuel Finkiel, nous donne à voir et à entendre la subjectivité d’un être humain confronté à une expérience ‘inhumaine’ –et qui s’efforce de restituer l’innommable-, à un moment charnière de notre histoire récente dont le cinéma et la littérature n’ont pas fini de fouiller la mémoire.
Samra Bonvoisin
« La Douleur », film d’Emmanuel Finkiel-sortie en salle le 24 janvier 2018