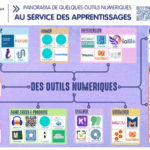Brillants débutants (Guillaume Brac, Thomas Cailley), cinéaste aguerrie (Léa Fazer) ou auteur confirmé (Pierre Salvatori), quatre réalisateurs français déclinent divers registres de la comédie et nous invitent à réfléchir sur le parcours d’apprentissage d’une jeunesse en quête d’idéal. Du dur désir d’aimer à la transcendance artistique en passant par l’aspiration à l’utopie et la relation complexe aux aînés, leurs films interrogent les aspirations et les rêves des nouvelles générations confrontées à l’ardente nécessité de s’inventer un avenir sans renier l’héritage, si lourd soit-il.
« Tonnerre » de Guillaume Brac
 De retour dans le petit village, Tonnerre, où il est né, réfugié chez son père, Maxime, musicien en crise d’inspiration, tombe ‘raide dingue’ de Mélodie, une très jeune journaliste venue l’interviewée. Las, le coup de foudre, les torrents d’amour et les cascades de rire se meuvent rapidement en douleur lancinante après la disparition brutale et inexpliquée de l’amante. Cette absence incompréhensible fait basculer le récit dans d’autres dimensions : de la comédie réaliste et terrienne au policier à connotation fantastique, au fil des manifestations de la violence et des blessures portées par un héros immature et malheureux. Ce dernier confond, en effet, passion monomaniaque et amour partagé, et refuse, pendant un certain temps, le réconfort paternel. Le papa, veuf et éternel séducteur, lui apparaît comme un homme vieillissant courant après sa jeunesse (il est aussi un acharné de la pratique intensive du vélo), sans craindre le ridicule. Par un bouleversant tour de force dramatique le jeune cinéaste, Guillaume Brac, accompagne son personnage vers une maturité, un accomplissement et une relation originale et fantasque à l’héritage familial. Porté par des interprètes exceptionnels de justesse et d’humanité (des acteurs professionnels comme Vincent Macaigne, Solène Rigot, Bernard Ménez, côtoyant des amateurs, habitants de la région), ce premier film réussi emprunte à la sécheresse stylisée de Maurice Pialat, au réalisme décalé de Jacques Rozier et trouve son propre style. Entre comédie poétique et drame burlesque, une première œuvre qui dépasse les promesses du brillant moyen métrage, salué par le public et la critique, précédemment réalisé et sorti en salles sous le titre « Un monde sans femmes ».
De retour dans le petit village, Tonnerre, où il est né, réfugié chez son père, Maxime, musicien en crise d’inspiration, tombe ‘raide dingue’ de Mélodie, une très jeune journaliste venue l’interviewée. Las, le coup de foudre, les torrents d’amour et les cascades de rire se meuvent rapidement en douleur lancinante après la disparition brutale et inexpliquée de l’amante. Cette absence incompréhensible fait basculer le récit dans d’autres dimensions : de la comédie réaliste et terrienne au policier à connotation fantastique, au fil des manifestations de la violence et des blessures portées par un héros immature et malheureux. Ce dernier confond, en effet, passion monomaniaque et amour partagé, et refuse, pendant un certain temps, le réconfort paternel. Le papa, veuf et éternel séducteur, lui apparaît comme un homme vieillissant courant après sa jeunesse (il est aussi un acharné de la pratique intensive du vélo), sans craindre le ridicule. Par un bouleversant tour de force dramatique le jeune cinéaste, Guillaume Brac, accompagne son personnage vers une maturité, un accomplissement et une relation originale et fantasque à l’héritage familial. Porté par des interprètes exceptionnels de justesse et d’humanité (des acteurs professionnels comme Vincent Macaigne, Solène Rigot, Bernard Ménez, côtoyant des amateurs, habitants de la région), ce premier film réussi emprunte à la sécheresse stylisée de Maurice Pialat, au réalisme décalé de Jacques Rozier et trouve son propre style. Entre comédie poétique et drame burlesque, une première œuvre qui dépasse les promesses du brillant moyen métrage, salué par le public et la critique, précédemment réalisé et sorti en salles sous le titre « Un monde sans femmes ».
Sortie en dvd chez Wild Side Video
« Les Combattants » de Thomas Cailley
 Un garçon, gauche et hésitant, et une fille, athlétique et déterminée, se défient sur un stand militaire. Arnaud et Madeleine, -ce sont les combattants-, se retrouvent embarqués dans un camp d’entraînement, par la volonté de la seconde, persuadée de l’imminence de la fin du monde et de la nécessité de se préparer à la survie en milieu hostile…A partir de ce renversement des rôles et des conventions (le personnage féminin domine, l’épreuve d’endurance comme étincelle de la naissance de l’amour), la comédie romanesque se métamorphose en fable à connotation politique. Dans le sillage fougueux des amoureux, de la fuite du camp aux enjambées en forêt et au ‘détachement’ du monde, les deux adolescents, tels des Robinson, mesurent leur amour, leurs corps, leurs êtres en formation à la nature. Et, peu à peu, pointe, sous la croyance de Madeleine en une fin du monde programmée, le pouvoir de résistance des deux ‘survivants’. A leur façon, détournée, imaginative et rebelle, « Les Combattants » s’insurgent contre la défiguration progressive des paysages naturels et la perspective d’une société condamnant sa jeunesse à une précarité sans fin. Réalisé par les frères Cailley (Thomas à la mise en scène et David à la lumière, après une première formation de sciences politiques suivie d’études à la Fémis, pour le premier, un CAPES de physique, quelques années d’enseignement, suivies d’un passage à l’école Louis Lumière, pour le second), salué lors de sa présentation à la Quinzaine des réalisateurs du dernier festival de Cannes, ce premier film, magnifié par la présence époustouflante à l’écran d’Adèle Haenel, n’engendre ni résignation ni désespoir. Sa puissance d’évocation ouvre à l’imagination des pistes insoupçonnées.
Un garçon, gauche et hésitant, et une fille, athlétique et déterminée, se défient sur un stand militaire. Arnaud et Madeleine, -ce sont les combattants-, se retrouvent embarqués dans un camp d’entraînement, par la volonté de la seconde, persuadée de l’imminence de la fin du monde et de la nécessité de se préparer à la survie en milieu hostile…A partir de ce renversement des rôles et des conventions (le personnage féminin domine, l’épreuve d’endurance comme étincelle de la naissance de l’amour), la comédie romanesque se métamorphose en fable à connotation politique. Dans le sillage fougueux des amoureux, de la fuite du camp aux enjambées en forêt et au ‘détachement’ du monde, les deux adolescents, tels des Robinson, mesurent leur amour, leurs corps, leurs êtres en formation à la nature. Et, peu à peu, pointe, sous la croyance de Madeleine en une fin du monde programmée, le pouvoir de résistance des deux ‘survivants’. A leur façon, détournée, imaginative et rebelle, « Les Combattants » s’insurgent contre la défiguration progressive des paysages naturels et la perspective d’une société condamnant sa jeunesse à une précarité sans fin. Réalisé par les frères Cailley (Thomas à la mise en scène et David à la lumière, après une première formation de sciences politiques suivie d’études à la Fémis, pour le premier, un CAPES de physique, quelques années d’enseignement, suivies d’un passage à l’école Louis Lumière, pour le second), salué lors de sa présentation à la Quinzaine des réalisateurs du dernier festival de Cannes, ce premier film, magnifié par la présence époustouflante à l’écran d’Adèle Haenel, n’engendre ni résignation ni désespoir. Sa puissance d’évocation ouvre à l’imagination des pistes insoupçonnées.
Toujours à l’affiche : « Maestro » de Léa Fazer
 Henri (Pio Marmaï), jeune comédien, adepte du star system, rêve de travailler au sein d’une grosse production américaine et de connaître ainsi succès et fortune. En toute inconscience, il est engagé pour jouer dans un film de Cédric Rovère (Michael Lonsdale), figure prestigieuse du cinéma d’auteur. Ce dernier réalise une adaptation des « Amours d’Astrée et de Céladon » ; un tournage court, au budget modeste, qui ne correspond pas du tout aux aspirations initiales du jeune écervelé. L’intelligence du metteur en scène et le rayonnement de sa partenaire (Déborah François) bouleversent la désinvolture et la superficialité du novice et lui font vivre, à son grand étonnement, une expérience artistique et affective inédite. Le vieux cinéaste, pour sa part, ne se prend pas seulement au jeu de la transmission. L’innocence et la fantaisie de cet acteur inexpérimenté stimulent son imagination et sa propre inspiration. En s’inspirant de l’expérience vécue, sur le tournage des « Amours d’Astrée et de Céladon », par Jocelyn Quivrin, -jeune comédien prématurément disparu alors qu’il travaillait sur ce scénario même-, la cinéaste Léa Fazer a relevé le défi, achevé et porté à l’écran le script de son ami. Elle s’émancipe, se détache de l’héritage cinématographique d’Eric Rohmer et réussit une œuvre lumineuse où s’entremêlent harmonieusement la naissance de l’amour, la découverte du travail de mise en scène et la mise en abyme du cinéma. Une miraculeuse alchimie s’opère sous nos yeux : l’amour et l’art envahissent Henri sans qu’il en ait totalement conscience dans une saisie propre au cinéma « rohmérien ». Poésie et sensualité, romanesque empreint de vérité, le style de Léa Fazer prend sa liberté tout en respectant l’esprit du maître. Et elle parvient à rendre palpable le pacte de transmission qui lie bientôt le réalisateur patenté et le jeune comédien en pleine mue intérieure. Et, au-delà, « Maestro » devient une belle incarnation du geste de transmission. Comme le confie la cinéaste : « j’ai rêvé cet accès à la poésie, et le film est devenu un récit d’apprentissage-qui reflète également mon propre apprentissage ».
Henri (Pio Marmaï), jeune comédien, adepte du star system, rêve de travailler au sein d’une grosse production américaine et de connaître ainsi succès et fortune. En toute inconscience, il est engagé pour jouer dans un film de Cédric Rovère (Michael Lonsdale), figure prestigieuse du cinéma d’auteur. Ce dernier réalise une adaptation des « Amours d’Astrée et de Céladon » ; un tournage court, au budget modeste, qui ne correspond pas du tout aux aspirations initiales du jeune écervelé. L’intelligence du metteur en scène et le rayonnement de sa partenaire (Déborah François) bouleversent la désinvolture et la superficialité du novice et lui font vivre, à son grand étonnement, une expérience artistique et affective inédite. Le vieux cinéaste, pour sa part, ne se prend pas seulement au jeu de la transmission. L’innocence et la fantaisie de cet acteur inexpérimenté stimulent son imagination et sa propre inspiration. En s’inspirant de l’expérience vécue, sur le tournage des « Amours d’Astrée et de Céladon », par Jocelyn Quivrin, -jeune comédien prématurément disparu alors qu’il travaillait sur ce scénario même-, la cinéaste Léa Fazer a relevé le défi, achevé et porté à l’écran le script de son ami. Elle s’émancipe, se détache de l’héritage cinématographique d’Eric Rohmer et réussit une œuvre lumineuse où s’entremêlent harmonieusement la naissance de l’amour, la découverte du travail de mise en scène et la mise en abyme du cinéma. Une miraculeuse alchimie s’opère sous nos yeux : l’amour et l’art envahissent Henri sans qu’il en ait totalement conscience dans une saisie propre au cinéma « rohmérien ». Poésie et sensualité, romanesque empreint de vérité, le style de Léa Fazer prend sa liberté tout en respectant l’esprit du maître. Et elle parvient à rendre palpable le pacte de transmission qui lie bientôt le réalisateur patenté et le jeune comédien en pleine mue intérieure. Et, au-delà, « Maestro » devient une belle incarnation du geste de transmission. Comme le confie la cinéaste : « j’ai rêvé cet accès à la poésie, et le film est devenu un récit d’apprentissage-qui reflète également mon propre apprentissage ».
Toujours à l’affiche : « Dans la cour » de Pierre Salvadori
 Sous des dehors de comédie sociale, un drôle de drame se joue « Dans la cour » de Pierre Salvatori. Antoine (Gustave Kerven), éternel adolescent de quarante ans, vieil « ours » et musicien usé, décide de renoncer à son art. Embauché comme gardien d’immeuble et logé au rez-de-chaussée, il noue une relation intense, faite d’écoute et de tendresse, avec une jeune retraitée (Catherine Deneuve) qui veille avec bienveillance sur les habitants de la résidence, en particulier les plus fragiles. Pourtant l’âge et l’usure du temps n’épargnent pas Mathilde. Une grande fissure apparue dans le mur de son appartement sème la panique en elle et l’appel à la raison de son époux n’y fait rien. Antoine semble le seul capable de prendre en charge la folie de cette femme fantasque et changeante. Loin de se réduire à ce duo insolite et touchant, la comédie réunit dans un espace réduit (la cour commune et les appartements individuels) bien des figures de la solitude contemporaine, revêtues des symptômes d’une société repliée sur elle-même en autant de ‘particularismes’ ou d’égoïsmes. Ainsi certains, au risque d’en payer le prix (fort), essaient-ils la solidarité et la création d’un lien, même ténu, avec les autres. Le personnage de Mathilde est de ceux-là. On peut regretter que le cinéaste décide in fine de faire mourir Antoine, seule incarnation de la générosité et du désintéressement. Un signe des temps, sans doute.
Sous des dehors de comédie sociale, un drôle de drame se joue « Dans la cour » de Pierre Salvatori. Antoine (Gustave Kerven), éternel adolescent de quarante ans, vieil « ours » et musicien usé, décide de renoncer à son art. Embauché comme gardien d’immeuble et logé au rez-de-chaussée, il noue une relation intense, faite d’écoute et de tendresse, avec une jeune retraitée (Catherine Deneuve) qui veille avec bienveillance sur les habitants de la résidence, en particulier les plus fragiles. Pourtant l’âge et l’usure du temps n’épargnent pas Mathilde. Une grande fissure apparue dans le mur de son appartement sème la panique en elle et l’appel à la raison de son époux n’y fait rien. Antoine semble le seul capable de prendre en charge la folie de cette femme fantasque et changeante. Loin de se réduire à ce duo insolite et touchant, la comédie réunit dans un espace réduit (la cour commune et les appartements individuels) bien des figures de la solitude contemporaine, revêtues des symptômes d’une société repliée sur elle-même en autant de ‘particularismes’ ou d’égoïsmes. Ainsi certains, au risque d’en payer le prix (fort), essaient-ils la solidarité et la création d’un lien, même ténu, avec les autres. Le personnage de Mathilde est de ceux-là. On peut regretter que le cinéaste décide in fine de faire mourir Antoine, seule incarnation de la générosité et du désintéressement. Un signe des temps, sans doute.
Sortie en DVD chez Wild Side Video
Samra Bonvoisin