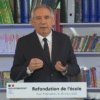« Entre 2000 et 2020, les enseignants ont ainsi perdu entre 15 % à 20 % de leur pouvoir d’achat », rappelle Yannick Trigance, conseiller régional d’Île-de-France. Baisse des candidats, salaires insuffisants… L’élu réagit aux annonces du Premier ministre sur la réforme de la formation des professeur.es. « Nous sommes très loin d’une « refondation » de l’école »
« Entre 2000 et 2020, les enseignants ont ainsi perdu entre 15 % à 20 % de leur pouvoir d’achat », rappelle Yannick Trigance, conseiller régional d’Île-de-France. Baisse des candidats, salaires insuffisants… L’élu réagit aux annonces du Premier ministre sur la réforme de la formation des professeur.es. « Nous sommes très loin d’une « refondation » de l’école »
« Nous considérons que l’éducation est la mère de toutes les batailles. C’est là que tout se joue ». Outre le fait qu’elle résonne comme un poncif rabâché à l’envi, mais cependant en total décalage avec la situation dégradée de l’école sous la gouvernance macroniste, cette déclaration de François Bayrou lancée le vendredi 28 mars à l’occasion de la présentation de la réforme de la formation des enseignants, présente des aspects intéressants – dont l’élargissement du spectre social rendu possible grâce au recrutement à Bac+3 – mais sans doute bien insuffisants pour relancer l’attractivité d’un métier que 72 % des enseignants apprécient, mais que seuls 15 % conseilleraient à leur entourage.
Avec depuis 2021 une baisse de 45 % de candidats au concours du premier degré et de 21 % dans le second degré, avec 4000 postes restés vacants en 2023, auxquels s’ajoute un nombre de démissions 5 fois plus élevé qu’il y a 10 ans dont 30 % de professeurs stagiaires qui renoncent à la carrière, l’urgence de la question de l’attractivité du métier se pose avec acuité.
Si l’avancement du recrutement au niveau de la licence dès 2026 pour devenir professeur des écoles, enseignant du second degré et CPE – conseiller principal d’éducation – constitue une avancée, tout comme la rémunération des deux années de formation en M1 et M2, pour autant nous sommes très loin d’une « refondation » de l’école annoncée par le Premier Ministre et la Ministre de l’Éducation nationale lors de leur déplacement dans une école de Rueil-Malmaison.
Car au-delà du recrutement, l’attractivité du métier passe immanquablement par la question des salaires non réglée à ce jour. Après 15 années de carrière, les enseignants français du 1 er degré sont payés 14 % de moins que leurs collègues de l’OCDE et ceux du second degré 20 % de moins.
Entre 2000 et 2020, les enseignants ont ainsi perdu entre 15 % à 20 % de leur pouvoir d’achat avec 70 % des professeurs des écoles et 50 % des certifiés qui aujourd’hui perçoivent moins de 2500 euros mensuels nets, primes et heures supplémentaires comprises quand dans le même temps leurs homologues de catégorie A de la fonction publique gagnent 1000 euros de plus.
Reniée une fois l’élection passée, la promesse présidentielle d’une augmentation de 10 % pour tous les enseignants sans mission supplémentaire a considérablement blessé les enseignants qui, rappelons-le, font le plus d’heures devant les élèves devant les classes les plus chargées.
Essentiellement basée sur l’acceptation par les enseignants des charges supplémentaires de travail définies dans un fameux « pacte » décrié par une grande majorité de la profession, une revalorisation digne de ce nom devrait en réalité se traduire par une révision des grilles indiciaires, indépendamment des indemnités et des primes non prises en compte dans les retraites, et par un point d’indice calé à minima sur l’inflation.
A cette question des salaires vient s’ajouter celle du contenu de la formation initiale, de la formation continue aujourd’hui inexistante, des conditions de travail – effectifs de classe qui pourraient être abaissés du fait de la baisse de la démographie scolaire, accueil des enfants en situation de handicap …- mais également du système de mutation nationale des enseignants du second degré qui trop souvent propulse de jeunes enseignants à des centaines de kilomètres de leur domicile.
Soyons lucides : les mesures annoncées par le Premier Ministre et la Ministre de l’éducation nationale doivent impérativement être accompagnées de mesures bien plus engageantes si l’on veut mettre fin aux « job dating » pour recruter et enrayer l’augmentation exponentielle de contractuels, de démissions et de burn-out.
Bref, si l’on veut résolument replacer le métier d’enseignant au coeur d’un véritable projet de société.
C’est un enjeu majeur pour l’Ecole de la République et pour l’avenir de notre jeunesse qui a tant besoin de nos enseignants.
Il reste tant à faire.
Yannick Trigance