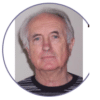Une organisation claire qui met en perspective la diversité des situations
L’ouvrage est composé de quatre grandes parties : « Disposer de son corps », « Sphère privée », « Espaces publics », « Inégalités et luttes », qui permettent d’évoquer « la diversité des situations féminines et des formes d’inégalités » à travers le monde et de croiser approches et champs d’observation.
Chaque partie aborde environ dix problématiques clairement délimitées et afférant à sa thématique éponyme. Ainsi la première, consacrée au corps, s’intéresse-t-elle à la santé, au contrôle des naissances, ou encore à toutes les formes de violences sexuelles. Les deux suivantes, axées sur la « Sphère privée » et les « Espaces privés », évoquent, par exemple, le nom des femmes mariées et la transmission du nom aux enfants, l’articulation entre la vie familiale et la vie active, la scolarisation des filles, l’accès à l’emploi ou la représentation des femmes dans le monde de la culture… Et la dernière « Inégalités et luttes » rappelle le rôle joué par les organisations de femmes dans le monde, les avancées politiques, mais aussi les plafonds de verre encore très présents …
Observation précise et réflexion nuancée
Une double page est consacrée à chaque questionnement : elle s’appuie sur des données précises et objectives (sources administratives nationales et internationales, enquêtes statistiques, données juridiques, événements historiques…) et s’article autour de trois à quatre cartes et/ou graphiques, accompagné·es d’une analyse nuancée, « sans complaisance ni parti pris ». Le tout stimule la curiosité, favorise le questionnement et invite à se méfier des conclusions hâtives.
A titre d’illustration, dans la première partie « Disposer de son corps » on apprend par exemple que si « partout dans le monde les femmes vivent plus longtemps que les hommes », à l’échelle mondiale la population en réalité se masculinise – en raison de la préférence dans quelques pays d’Asie pour les garçons. On apprend aussi à nuancer cet avantage, en réalité « notablement » réduit, dans certaines régions du monde, par une « mortalité assez forte » liée aux grossesses et accouchements et des « conditions de vie plus défavorables » pour les femmes. Quant à l’accès à la contraception, « condition de l’émancipation féminine », s’il a beaucoup progressé, on observe qu’il n’est pas « garanti dans tous les pays et à chacune » et qu’il « reste soumis à des contraintes qui entravent parfois l’exercice d’une liberté réelle ». On constate aussi que ce sont deux femmes sur trois qui vivent dans un pays où l’lVG, « pratique fréquente à l’échelle mondiale », est interdite ou soumise à des restrictions légales qui en rendent « la pratique moins sûre »…
On retrouve cette démarche critique vigilante tout au long de l’ouvrage, et ce jusqu’aux dernières pages. L’Atlas se conclut d’ailleurs sur une double page évoquant les « Indices d’inégalités de genre », indices développés par plusieurs organisations internationales pour synthétiser les « informations relatives aux inégalités de genre ». L’article met en garde sur la définition donnée dans ce cadre aux inégalités entre femmes et hommes, définition qui « conduit de facto à faire des pays les plus développés ceux qui sont les moins inégalitaires en termes de genre ». Conçus par des organisations qui « appartiennent généralement » à ces pays économiquement développés, ces indices « peuvent donc difficilement capter la spécificité des rapports de genre dans différents contextes socio-économiques ». Classer les pays à partir de tels indices, c’est donc prendre le risque de participer à la « racialisation du sexisme ». Dernière mise en garde invitant à un dernier pas de côté.
D’un maniement très souple, l’ouvrage est clair, et sa lecture passionnante. Une vraie mine d’informations, et un formidable outil à exploiter avec les classes, notamment en HGEMC et HGGSP, et en SES.
Claire Berest