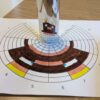Voilà une hypothèse fort stimulante à l’heure où le métier d’enseignant ressemble davantage à un repoussoir qu’à une vocation. Les enseignants sont-ils les nouveaux prolétaires ? La question, posée par l’enseignant, chercheur et militant syndicaliste Frédéric Grimaud possède une double entrée : comprendre comment s’est petit à petit prolétarisé le métier, et saisir la balle au bond pour penser les modalités de son émancipation. L’expression peut heurter. Personne ne conteste qu’il existe des catégories sociales beaucoup plus précarisées que les enseignants qui, même victimes d’une baisse considérable de leur niveau de vie, restent assimilables aux classes moyennes pour certains, voire à la petite bourgeoisie pour d’autres ; qu’ils jouissent d’un confort matériel plus ou moins important, et, pour les titulaires, ne vivent pas le risque permanent de perdre leur travail. Mais Frédéric Grimaud ne pose pas la question de la prolétarisation comme un état de fait statistiquement opératoire pour les courbes des économistes, il la travaille comme un processus, on pourrait dire une mécanique qui affecte le métier et le transforme si radicalement que celles et ceux qui s’y sont engagés ne s’y retrouvent parfois plus.
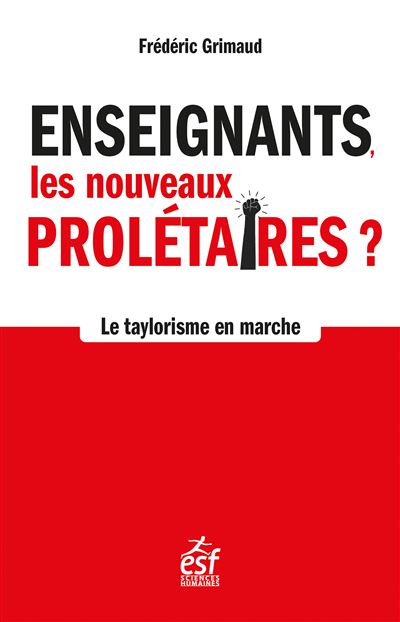 Comment le taylorisme permet de comprendre la transformation du métier
Comment le taylorisme permet de comprendre la transformation du métier
Frederic Taylor est l’homme de la rationalisation du travail. Pour cet américain de la seconde moitié du XIXe siècle, le travail ouvrier doit s’appuyer sur une organisation permettant d’améliorer la productivité et le rendement. Tout le monde a en tête la naissance du travail à la chaîne et l’image de Charlie Chaplin dans Les temps modernes. Mais quel rapport avec le métier d’enseignant ?
La pensée de Taylor a réussi à quitter les usines pour s’adapter au monde de l’entreprise sous la forme d’une réflexion sur le management. C’est l’origine de la fameuse « culture des résultats » et celle du New Public Management qui aujourd’hui fait mouche dans les services publics autant que dans le monde de l’entreprise. Grimaud détaille dans son livre comment le virage managérial affecte l’école publique, surtout depuis le bulldozer lancé contre elle par Jean-Michel Blanquer. Tous les enseignants se retrouveront dans cet inventaire de coups portés au métier : imposition des « bonnes pratiques », évaluations compulsives, culte des données probantes, etc. Le résultat en est une dépossession de leurs compétences et le sentiment d’être transformés en agents d’exécution de décisions qui leur échappent. Personne n’a signé pour ça.
Une mécanique destructrice
Les penseurs de la rationalisation du service public et les technocrates qui en appliquent consciencieusement tous les préceptes savent très bien à quelle sauce ils mangent les enseignants. Ils savent qu’à force de réduire le budget alloué aux conditions matérielles d’enseignement, ils les préparent à craquer. Peu leur importe, car la précarisation de la société étant générale, ils trouveront toujours des volontaires remplaçants, recrutés en speed dating la veille voire après la rentrée scolaire. Ils savent qu’ils les enverront devant des élèves difficiles, là où plus personne ne veut aller et qu’ils ont tout à y gagner : pouvoir prétendre dans l’urgence et devant les médias qu’il y a « un enseignant devant chaque élève », fournir du « kit pédagogique » à foison aux débutants pour les « accompagner », continuer ainsi à savonner la planche de la liberté pédagogique, et enfin profiter à plus long terme de la baisse de qualité de l’enseignement pour justifier un nouveau dégraissage dans les écoles en fermant de plus en plus de classes. C’est un cercle vertueux pour eux, fatal pour nous, et dont il est difficile de s’extraire. C’est pourquoi en comprendre la mécanique est salutaire, et c’est ce à quoi nous invite ce petit livre très efficace.
Tout y passe : l’augmentation de la charge de travail, les risques psychosociaux que cela génère, la mise en place du salaire différentiel pour introduire de la concurrence entre enseignants et fissurer voire détruire le collectif, le sabotage de la formation initiale et continue, le renforcement des hiérarchies intermédiaires, l’encouragement de l’autoritarisme etc. La liste est longue, presque vertigineuse et pose naturellement la question de la possibilité de sortir de ce piège qui, comme le rappelle l’auteur, en a déjà mené certaines et certains à quitter le navire, quitte à se donner la mort sur leur lieu de travail.
Que faire ?
C’est l’objet du dernier chapitre : comment résister ? Grimaud rappelle fort justement l’importance de reprendre la main sur le métier en plaidant pour ce qui en fait la saveur et pour notre qualité d’expert·es de notre travail. Qu’est-ce qu’enseigner ? C’est peut-être d’abord bricoler, à la manière de l’artisan ; Freinet disait « tâtonner ». Car nous travaillons avec des êtres vivants et aucune science cognitive ne peut répondre exhaustivement à la question de savoir comment un enfant apprend en évacuant la question fondamentale de son environnement, notamment social. Aussi parce que l’alchimie d’une classe reste quelque-chose de mystérieux et nous savons toutes et tous qu’un même exercice dans deux classes différentes n’aboutit jamais au même résultat.
Surtout, Frédéric Grimaud rappelle que rien ne sera possible sans retrouver le collectif. Ce dernier existe encore, peut-être plus là où on avait l’habitude de le voir, parce que certaines salles des maîtres ou des profs s’essoufflent ; mais les syndicats restent actifs, de même que les associations ou collectifs militants. Reprendre la main sur son travail, c’est aussi accepter de le mettre en débat, d’en retrouver la dimension commune, quitte à se disputer un bon coup ! Qui parle encore de son travail parmi nous ?
La résistance et la désobéissance ne peuvent être que collectives, sans quoi on se met en danger et nous le sommes déjà suffisamment. Au final, cette prolétarisation a donc peut-être du bon : venir nous chantonner un vieux slogan à l’oreille : « prolétaires de tous les pays, unissez-vous !»
Laurence De Cock