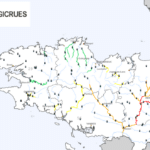Comment inventer une forme originale pour suggérer à l’écran le déchirement d’un couple amoureux, en se détachant des (nombreux) cinéastes maîtres en la matière ? Et l’onde de choc engendrée par la séparation chez une petite fille brutalement privée d’un père défaillant ? Pour son premier film, « Tout est pardonné », Sélection Quinzaine des réalisateurs à Cannes et Prix Louis Delluc 2007, la jeune cinéaste (26 ans alors) Mia Hansen-Love entre dans la cour des grands avec une évidence impressionnante. Pour retracer, sur une longue période de onze années, entre Vienne, Paris et Caracas, le destin mouvementé de Victor et Annette, les deux parents aimants, leur douloureuse rupture, et le cheminement intérieur de Paméla, leur enfant chérie, la réalisatrice choisit une mise en scène parcellaire, pleine de trous noirs et de fulgurances lumineuses. En nous offrant ainsi la liberté d’entrer tour à tour dans la subjectivité des trois protagonistes sans les juger. Et in fine se dessine le portrait éblouissant d’une jeune fille sensible qui, renouant avec un père à nouveau capable d’aimer, affronte l’immensité du monde et marche vers ses dangers.
La douleur d’aimer
 Vienne, 1995. Premier volet de l’histoire en trois temps. Commencées dans la nuit bleutée et scintillante jusqu’à l’aube claire découvrant la ville en plans larges, les premières scènes pénètrent dans le quotidien d’un jeune couple. Dans la capitale autrichienne, Annette originaire de ce pays (Marie-Christine Friedrich) et Victor né en France (Paul Blain) vivent avec leur petite fille Paméla (Victoire Rousseau dans le rôle de Paméla enfant). Victor cultive son désir d’écriture de poèsies dans le refus du travail salarié et une disponibilité à son enfant de six ans : dialogue avec les poupées (à qui il faut trouver un prénom) sur le tapis du salon, jeux de balles dans les rues autour de la maison. Annette les retrouve en rentrant du travail et, en quelques embrassades, atteste de sa passion pour l’un et de son amour pour l’autre.
Vienne, 1995. Premier volet de l’histoire en trois temps. Commencées dans la nuit bleutée et scintillante jusqu’à l’aube claire découvrant la ville en plans larges, les premières scènes pénètrent dans le quotidien d’un jeune couple. Dans la capitale autrichienne, Annette originaire de ce pays (Marie-Christine Friedrich) et Victor né en France (Paul Blain) vivent avec leur petite fille Paméla (Victoire Rousseau dans le rôle de Paméla enfant). Victor cultive son désir d’écriture de poèsies dans le refus du travail salarié et une disponibilité à son enfant de six ans : dialogue avec les poupées (à qui il faut trouver un prénom) sur le tapis du salon, jeux de balles dans les rues autour de la maison. Annette les retrouve en rentrant du travail et, en quelques embrassades, atteste de sa passion pour l’un et de son amour pour l’autre.
Pourtant, nous décelons rapidement la discordance qui fragilise le couple et compromet l’épanouissement de Paméla. Indécis et changeant, Victor s’offre des virées nocturnes et un emploi du temps rythmé par des marches répétées entre grandes rues, parcs et escaliers d’immeubles, soirées enfumées et dansantes. Des nuits dehors sous l’emprise de la drogue.
Annette cependant, toujours amoureuse, espère que leur retour à Paris –deuxième volet, quelque temps plus tard- , permettra à Victor de sortir de la nasse. Il n’en est rien. Tout en figurant la souffrance grandissante de l’épouse trahie et de la mère attentive assumant son rôle, la cinéaste ne détourne pas le regard devant la ‘descente aux enfers’ de Victor confronté à son impuissance à vivre, au désir persistant d’aimer Annette, à la tendre affection envers Paméla. Le filmage d’un affrontement au sein du couple (jusqu’aux coups portés par Victor sur sa femme) nous saisit en un éclair et quelques plans terribles : le point de non-retour est atteint et, au petit déjeun, dans la lumière pâle autour de la table, le face-à-face silencieux du père et de la mère est ponctué par les seuls bruits de bouche de Paméla, croquant ses biscottes, unique manifestation d’un désastre familial et d’une détresse enfantine.
Victor continue à couler à pic, sous nos yeux remplis d’effroi, dans une spirale d’autodestruction que même son médecin (et ami) ne peut enrayer. Une jeune toxicomane à la beauté inquiète et au regard perdu l’héberge. Un amour infernal voué à un dénouement tragique.
Annette, lors d’une ultime marche aux côtés de Victor dans la rue, s’arrêt quelques lourds instants face à lui assis contre un mur et lui annonce, dans la lumière automnale, le corps secoué de larmes déchirantes, qu’elle part pour Caracas avec Paméla, qu’elle ne peut lui pardonner et lance : ‘Je ne veux plus jamais te voir’.
Le temps retrouvé : mise en scène lumineuse d’une renaissance
Onze plus tard –troisième volet-, à Paris. Après une période dont nous ignorons tout (le périple en Amérique latine de la mère et de sa fille étant resté hors-champ). Paméla (Constance Rousseau dans le rôle de Pamela adolescente), belle brune à l’abondante chevelure bouclée et au teint diaphane, lycéenne en Terminale, vit chez sa mère avec son beau-père et ses demi-frères. Avec son amie Judith et d’autres camarades, elle donne l’image d’une personne épanouie, sensible et rêveuse.
Lorsque Martine (Carole Franck), la sœur de son père, la contacte, d’abord réticente, elle accepte une rencontre dans un café. Au fil de l’échange et des propos de son interlocutrice, elle découvre des pans entiers de l’histoire paternelle, la rupture non souhaitée, la terrible chute, la traversée d’une longue dépression, la lente reconstruction…et le désir formulé de revoir sa fille. Sa mère n’en sait rien et Paméla décide seule d’un premier rendez-vous avec Victor, puis d’autres rencontres. Et le miracle d’heureuses retrouvailles se produit.
D’où vient l’étrangeté du phénomène ? Du mystère que recèle la personnalité de Paméla. Contrairement au séisme intime attendu, conséquence prévisible d’un traumatisme ancien, l’adolescente accueille son père avec une écoute attentive, une bienveillance affichée et une grande curiosité quant aux bribes enfouies de leur (court) passé commun.
Aux antipodes de l’amertume d’une mère, enfermée dans le refus de pardonner à l’être tant aimé à l’origine de ses tourments (une figure du pardon impossible que ce troisième volet relègue sans cesse à la périphérie de la fiction), Paméla assume son choix et découvre dans la franchise et la liberté les ‘goûts et les couleurs’ de son père, son petit appartement rempli de tableaux et de livres, son goût (qu’elle partage) pour les marches prolongées dans les jardins, les parcs et les chemins de traverse.
Pendant les vacances à la campagne ensoleillée et ses hauteurs boisées, entre la complicité joyeuse près de la rivière avec des petits cousins à l’imaginaire foisonnant, aux jeux secrètement gardés et les chaleureux repas de famille en plein air, l’adolescente conserve une chambre à soi. A l’abri des regards, elle entretien une correspondance, régulière, simple et profonde, avec Victor le père retrouvé. L’un et l’autre tracent des ponts invisibles reliant des temporalités différentes, des vécus inconnus jusqu’alors. Et les lettres échangées dans leur tendre évidence inventent la filiation que chacun pensait à jamais perdue.
En donnant, dans des temporalités différentes, la possibilité aux trois protagonistes du drame de déployer leur subjectivité, d’aimer, de souffrir et de recomposer les fragments d’existence du passé, Mia Hansen-Love nous permet de voyager dans les plis du temps et de l’histoire individuelle de ses personnages, puisque subsistent des béances, des moments lacunaires auxquels nous n’accédons jamais, préservant ainsi la part de mystère des êtres ici incarnés. Et Paméla, héroïne vulnérable et jeune fille intrépide, dans « Tout est pardonné », retient à sa façon la leçon de son père en citant les mots (approximativement traduits) du poète : ‘ce qui décline aujourd’hui se lèvera dans une renaissance […].Certaines choses restent enfouies dans la nuit. Prends garde et reste vigilante…’.
Pamela peut alors nous tourner le dos, s’avancer sous le soleil d’un pas alerte vers la forêt épaisse, tandis que sa frêle silhouette s’éloigne, en une vision d’une inquiétante étrangeté.
Samra Bonvoisin
« Tout est pardonné », film de Mia Hansen-Love-Sélection Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2007 et Prix Louis Delluc.
Visible jusqu’au 14.04.21 sur France.tv