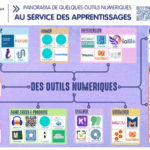Depuis le renoncement à imposer une certification (C2i2e) d’une véritable maîtrise du numérique pour les métiers de l’enseignement, on ne cesse d’entendre dire que le problème est la formation des enseignants. Eux-mêmes d’ailleurs, à l’instar de leurs dirigeants, entonnent volontiers ce refrain sans jamais aller beaucoup plus loin. N’oublions pas l’histoire de l’informatique et du numérique scolaire et rappelons ici que dès 1983, ces mêmes propos faisaient florès dans les colloques et autres séminaires aussi bien scientifiques que politiques. Pas de plan sans un volet formation… Le grand plan numérique envisage d’ailleurs trois journées de formation et les DAN vont en parler (ainsi que de leur propre formation) dans leurs journées de regroupement. Les publications de toutes sortes qui confirment ce manque de formation oublient toujours de désigner ce que l’on appelle réellement formation et quelles sont les modalités spécifiques du développement des compétences numériques dans les contextes d’enseignement. En d’autres termes qu’est-ce qu’on désigne lorsque l’on emploie le terme formation sans entrer dans le détail, même en adossant à ce mot celui d’accompagnement ?
 En 1999, la publication de l’ouvrage « Multimédiatiser l’école ? » (Hachette éducation, Bruno Devauchelle 1999) faisait le point sur ce qu’il semblait possible de définir comme cadre pour progresser, pour « monter en compétences ». Resté suffisamment confidentiel, ce propos n’a évidemment pas réellement touché une institution qui a continué de parler de formation et de la traduire en « journées » comme vient de le faire la ministre de l’Éducation le 25 août dernier. Plus récemment, la mise en place d’un programme de formation à distance (9h annuelle) pour les enseignants du primaire laissait envisager quelques évolutions et certains enseignants formateurs ont tenté d’ouvrir des portes. Le dispositif M@gister pour rendre possible cette formation à distance se mettait en place. Malheureusement on s’aperçoit que tout cela ne semble pas faire réellement changer les choses et que, en présence ou à distance, on reproduit les mêmes schémas. Depuis quelque temps, on parle de la formation en établissement, en amenant le formateur faire des journées ou des demi-journées de formation « sur site », au plus près des équipes et de leurs besoins. Certains ont même osé l’idée d’établissement formateur, mais aussi d’établissement apprenant.
En 1999, la publication de l’ouvrage « Multimédiatiser l’école ? » (Hachette éducation, Bruno Devauchelle 1999) faisait le point sur ce qu’il semblait possible de définir comme cadre pour progresser, pour « monter en compétences ». Resté suffisamment confidentiel, ce propos n’a évidemment pas réellement touché une institution qui a continué de parler de formation et de la traduire en « journées » comme vient de le faire la ministre de l’Éducation le 25 août dernier. Plus récemment, la mise en place d’un programme de formation à distance (9h annuelle) pour les enseignants du primaire laissait envisager quelques évolutions et certains enseignants formateurs ont tenté d’ouvrir des portes. Le dispositif M@gister pour rendre possible cette formation à distance se mettait en place. Malheureusement on s’aperçoit que tout cela ne semble pas faire réellement changer les choses et que, en présence ou à distance, on reproduit les mêmes schémas. Depuis quelque temps, on parle de la formation en établissement, en amenant le formateur faire des journées ou des demi-journées de formation « sur site », au plus près des équipes et de leurs besoins. Certains ont même osé l’idée d’établissement formateur, mais aussi d’établissement apprenant.
Aux journées de stage traditionnelles, on a ajouté l’accompagnement, la formation à distance ou hybride, la formation sur site. Mais à chaque fois on a oublié d’analyser ce qui constituait le cœur même : à savoir le développement des compétences en cours d’activité professionnelle. D’ailleurs les travaux de « didactique professionnelle » ont bien montré, à l’instar de ceux sur l’autoformation, que d’autres modèles existent et fonctionnent. C’est d’ailleurs pour cela que les enseignants déclarent de manière récurrente et dans d’importantes proportions qu’ils se forment tout seuls, qu’ils apprennent en autoformation bien plus que dans les dispositifs de formation proposés. Cela ne peut être considéré comme un défaut de la formation, même si on peut l’interroger, mais plutôt comme un défaut de pensée de la formation et de l’ingénierie de formation. Cela est parfois un problème de formateur, plus à l’aise dans la technique informatique que dans la pédagogie. Une première conception peut se dégager qui articule de manière stratégique et complémentaire plusieurs modèles : le stage externe inter établissement, le stage interne pour un groupe spécifique au sein de l’établissement, les journées internes en établissement, les sessions courtes de formation sur besoins, les temps de co-formation et enfin l’accompagnement formatif.
Reprenons les fondements : la formation des adultes, à la différence de l’enseignement scolaire, repose d’abord sur l’idée que pour se développer il ne suffit pas d’accumuler des connaissances, mais il faut aussi les digérer et se transformer soi-même. Formation vaut transformation et non pas formatage. Or économiquement le formatage est beaucoup plus économique que la transformation des personnes. De plus le formatage s’accommode bien de la forme scolaire alors que la transformation des personnes a bien du mal à y entrer. De Pierre Caspar à Philippe Carrée, de Jean Pierre Boutinet à Jacques Ardoino, etc… nombreux sont ceux qui ont montré la vanité du formatage et la force de la trans-formation. Parce qu’ils ne dissocient pas le sujet de l’objet, la situation de son contexte, l’individu du collectif, le local du global, le maintenant du pour toujours, ces travaux nous ont proposé des voies que le monde politique et économique a toujours refusé d’emprunter. Pourquoi ? Peut-être parce que la réussite des publicitaires à formater les conduites leur a semblé plus rentable que le lent travail éducatif si improbable dans l’espace et dans le temps. Et peut-être aussi que l’histoire de la formation continue, qui n’a guère plus de cinquante années (statutairement) a d’abord été soit une copie de l’enseignement scolaire, soit une sorte d’espace d’échange et de co-construction. Mais rapidement des travaux ont donné des directions plus orientées (le travail du cabinet INSEP sous la houlette de gens comme E. Verne, J. Piveteau et D. Noyé et bien d’autres).
Mais alors que faire ? Penser la formation en système et en globalité avant d’aller dans l’opérationnel. Passer d’abord de « former » à « se former » ! Concevoir les organisations, les institutions comme des espaces d’apprendre et de comprendre et non pas des structures administratives aux rouages bien huilés et auto-suffisants ! Permettre dès les premiers pas dans le monde académique à un enfant de se percevoir comme « en développement » avant de se comprendre comme « devant se conformer ». Développer cette capacité d’autodirection dans l’apprentissage pour en faire une modalité ordinaire. Valoriser le recours aux autres pour se former, en présence ou à distance. Organiser les espaces de formation de manières ouverte mais aussi parfois intégrée. Ne pas se cantonner à un modèle unique, mais au contraire permettre des formes adaptées aux contenus de formation et aux personnes qui font le parcours pour se former.
Il n’y a pas de recette miracle mais bien un état d’esprit à construire. Ainsi, pourquoi ne pas doter chaque personne d’un « capital formation » pour la vie professionnelle ? Capital fixé initialement pour le minimum obligatoire mais bien sûr évolutif en fonction des trajectoires. Ainsi, se former au numérique supposerait plusieurs étapes, plusieurs modalités qui varieraient selon les individus. Malheureusement, la dimension économique et la dimension réglementaire prennent un malin plaisir à renforcer une culture de l’immobilisme même dans la formation continue. On voit cependant apparaître des assouplissements autour du dispositif dit hybride, mais aussi du côté des environnements apprenants ou co-apprenants.
L’abandon d’une certification officielle avant même qu’elle soit complètement déployée a renvoyé chaque ESPE à ses propres choix. Plus globalement les hésitations permanentes dans les impulsions politiques, le jeu des lobbys, celui des médias, et le poids des matériels de toutes sortes dans ce développement ont contribué à rendre de plus en plus difficile toute formation. Il serait toujours facile de s’en tenir à la seule dimension de la maîtrise technique et c’est ainsi qu’ont dérivé les formations, depuis le plan IPT jusqu’aux dernières sessions de formation sur les ENT et autres tablettes. Mais on sait depuis longtemps que la maîtrise technique n’est qu’un aspect du problème. L’autre aspect, celui de l’utilisation en situation, relève d’une problématique qui n’est pas seulement du ressort de la formation traditionnelle, mais plutôt d’un management cognitif qui reste encore à inventer, en particulier à l’échelle de nombreuses équipes éducatives.
Bruno Devauchelle