Par François Jarraud
C’est le débat du mois. En critiquant l’approche par compétences, Philippe Meirieu s’est-il renié ? Appelle-t-il l’Ecole à un retour en arrière ? C’est ce que pensent Denis Meuret, Daniel Andler, Norberto Bottani, Aletta Grisay et Marc Gurgand qui publient dans le Café pédagogique une tribune retentissante. Philippe Meirieu leur répond…
Tribune : « Ecole : Le retour en arrière mène à une impasse »
Par Denis Meuret, Daniel Andler, Norberto Bottani, Aletta Grisay et Marc Gurgand
Revenant sur la tribune donnée au Monde par M Gauchet et P Meirieu, cinq experts éducatifs, Denis Meuret, Daniel Andler, Norberto Bottani, Aletta Grisay et Marc Gurgand, dénoncent « la réconciliation des républicains et des pédagogues ». Ils y voient un danger pour l’Ecole et probablement un recentrage pour P. Meirieu. « Un enseignement fondé essentiellement, non pas même sur la culture, mais sur la transmission du patrimoine culturel, l’accès aux œuvres, l’élision du technique, le mépris du professionnel risque de susciter, en particulier de la part des jeunes de milieux populaires, un rejet de l’école et de la culture dangereux pour la démocratie ».
 Dans Le Monde du 3 septembre, le débat entre Marcel Gauchet et Philippe Meirieu sur l’école manifeste avec éclat une réconciliation des républicains et des pédagogues que l’on pourrait trouver bienvenue si elle ne se faisait au nom d’une conception de l’école qui la conduit dans une impasse.
Dans Le Monde du 3 septembre, le débat entre Marcel Gauchet et Philippe Meirieu sur l’école manifeste avec éclat une réconciliation des républicains et des pédagogues que l’on pourrait trouver bienvenue si elle ne se faisait au nom d’une conception de l’école qui la conduit dans une impasse.
Le refrain est connu : face à une société permissive, ennemie de l’intelligence et de l’effort, l’école est le dernier rempart de la civilisation ; elle seule conduit les individus à l’humanité à travers la transmission du patrimoine culturel. Il présente toutefois ici des accents nouveaux : on n’avait pas encore mis en avant les effets délétères sur l’éducation parentale du fait que les enfants soient aujourd’hui désirés.
Ce récit pose quelques problèmes. D’abord, s’il était vrai, ce serait un réquisitoire sévère sur l’école qui a formé les générations ayant façonné le monde d’aujourd’hui — soit que l’école ait eu des effets négatifs, soit qu’elle ait été impuissante à empêcher une telle décadence morale et civique. Or cette école, que nous avons fréquentée, ressemblait davantage à celle que les auteurs nous proposent qu’à celle qu’ils critiquent. Ensuite, c’est curieux, on ne lit jamais ce type de déploration sur l’éducation parentale et sur la déculturation de la société qu’en préambule à des textes sur l’école. Les sociologues de la famille, eux, nous décrivent des parents de classe moyenne (trop) obsédés par la réussite scolaire de leurs enfants, des parents de classes populaires maladroits dans leur rapport à l’école mais pas insoucieux de la scolarité de leurs enfants, non pas des familles uniquement soucieuses de « l’épanouissement affectif » de leurs enfants.
Sans doute, nos sociétés démocratiques présentent-t-elles des évolutions inquiétantes (montée des inégalités, du populisme), contre lesquelles il importe que l’école prenne sa part de l’action. Mais, d’une part, à tant demander à l’école, il semble qu’on renonce à rendre d’autres acteurs (les entreprises, les média, le politique) comptable de ce qu’ils font de l’humanité des individus. D’autre part, tout de même, il est difficile de diagnostiquer une « déculturation » quand le nombre de découvertes scientifiques, de créations artistiques, de livres publiés, etc. n’a jamais été aussi grand, sans parler de l’allongement de la durée des études. Quoi qu’on pense des média ou d’internet, il est certainement faux que la société actuelle nous enjoigne « de ne surtout pas chercher à comprendre ce qui nous environne » et se contente de nous inciter à l’achat dans les supermarchés. Enfin, les sociétés d’aujourd’hui sont en fait favorables à l’apprentissage à beaucoup d’égards (la multiplication des occasions d’apprendre, l’accroissement des ressources qui y sont consacrées, l’accord général sur l’importance de la réussite scolaire).
Ce discours alarmiste semble avoir surtout une fonction rhétorique, qui est de justifier une certaine forme d’école et d’en conjurer une autre. Si la culture est à ce point menacée, il est clair que l’école doit la défendre. L’école n’est alors plus justifiée par sa capacité à préparer des citoyens pour le monde qui vient, mais seulement par sa capacité à conserver vivante, fut-ce chez un petit nombre, cette élévation d’esprit dont témoignent les grandes œuvres du passé. Si les parents sont à ce point permissifs, décérébrés et décérébrants, il faut en effet couper l’école des familles.
Ainsi, au-delà de certaines formulations heureuses (« maîtriser par l’esprit les choses que l’on fait », par exemple) la conception de l’école qui nous est proposée est réactionnaire ( au sens strict du terme puisqu’ on nous appelle à « retrouver les fondements de l’école», comme si l’histoire de l’école n’était qu’une suite de renoncements à un idéal posé lors d’une incertaine origine ) ; elle est négative (on demande à l’école d’être « contre », contre l’immédiateté, contre les pulsions, les familles, la technique et l’économie, contre tout ce qui ne sert qu’à «faire tourner la boutique ») ; elle est étroite (cantonnée en réalité aux enseignements littéraires, ce que montre le fait que le texte devient fort étrange dès qu’il sort de ce domaine, par exemple quand il propose la méditation des œuvres scientifiques comme modalité de l’enseignement des sciences).
Il y a fort à parier que la plupart des élèves déserteraient, pour des formes individuelles et marchandes d’apprentissage, une école ainsi conçue.
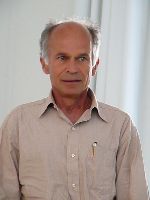 On peut se demander, cependant, si les deux auteurs croient vraiment à la possibilité d’une telle école, et si le modèle qu’ils proposent n’est pas destiné surtout à récuser un certain mode de gouvernement de l’école, préventivement, pourrait-on dire, tant ce modèle reste marginal dans notre pays. Le mode de gouvernement que condamnent les auteurs rassemble, dans «une vision purement économique du problème (éducatif), élaborée et développée à l’échelle internationale », les évaluations internationales, PISA au premier chef, mais aussi l’ensemble des évaluations nationales qui auraient la mauvaise idée de mesurer les compétences des élèves. Bref, les auteurs s’insurgent contre ce que l’on appelle dans les pays anglo-saxons « les politiques éducatives fondées sur les données », c’est-à-dire sur les résultats des élèves à des épreuves scolaires, utilisées pour évaluer, et donc éventuellement réorienter, des pratiques d’enseignement ou des politiques d’établissement.
On peut se demander, cependant, si les deux auteurs croient vraiment à la possibilité d’une telle école, et si le modèle qu’ils proposent n’est pas destiné surtout à récuser un certain mode de gouvernement de l’école, préventivement, pourrait-on dire, tant ce modèle reste marginal dans notre pays. Le mode de gouvernement que condamnent les auteurs rassemble, dans «une vision purement économique du problème (éducatif), élaborée et développée à l’échelle internationale », les évaluations internationales, PISA au premier chef, mais aussi l’ensemble des évaluations nationales qui auraient la mauvaise idée de mesurer les compétences des élèves. Bref, les auteurs s’insurgent contre ce que l’on appelle dans les pays anglo-saxons « les politiques éducatives fondées sur les données », c’est-à-dire sur les résultats des élèves à des épreuves scolaires, utilisées pour évaluer, et donc éventuellement réorienter, des pratiques d’enseignement ou des politiques d’établissement.
Notre propos n’est pas ici de défendre chacune des évaluations, chacune des initiatives prises par l’administration française qui se rapprochent de ce modèle. Sans doute, ce qui est proposé ici ou là en son nom est-il critiquable et perfectible. Il importe cependant de souligner que la critique des auteurs méconnait gravement la sophistication des évaluations internationales, en particulier celle de PISA. Par exemple, la conception de la compréhension de l’écrit développée dans PISA est infiniment plus riche que ce qu’indique la sentence énoncée par l’un des auteurs : « lire, ce n’est pas seulement déchiffrer, c’est aussi comprendre ». Nous aimerions savoir : Nos deux auteurs nous demandent-ils, oui ou non, d’ignorer ce que PISA nous apprend sur la dégradation dramatique du niveau de nos élèves les plus faibles, sur l’accroissement de l’impact de l’origine sociale sur les compétences des élèves, au motif qu’il ne s’agit là que d’une conception « très discutable des performances » des systèmes éducatifs ? Par ailleurs, s’il « ne fait pas partie de la mission de l’école de transmettre des compétences, si nécessaire soient-elles », quelle institution doit-elle les transmettre ?
Plus grave, cette critique définit la culture, le sens, l’humanité même, par opposition à ce qui est utile dans le monde (les « compétences » qui servent à « faire tourner la boutique »), une opposition dénoncée depuis fort longtemps comme reproduisant celle qui sépare les « classes de loisirs » et les « classes travailleuses ». Cette opposition méconnait que, fort heureusement, l’économie aujourd’hui a besoin de toutes les compétences, aussi bien de compétences techniques que de compétences générales qui sont aussi utiles dans le domaine civique ou culturel.
Plus généralement, il est aberrant d’exclure de l’humanité une dimension – celle du travail – qui mobilise aujourd’hui l’essentiel du temps et des capacités des individus. Il nous semble au contraire que l’école doit reposer sur une vision globale et unifiée de l’expérience humaine. Un enseignement fondé essentiellement, non pas même sur la culture, mais sur la transmission du patrimoine culturel, l’accès aux œuvres, l’élision du technique, le mépris du professionnel risque de susciter, en particulier de la part des jeunes de milieux populaires, un rejet de l’école et de la culture dangereux pour la démocratie.
Daniel Andler, professeur de philosophie des sciences à Paris 4, membre de l’Institut Universitaire de France.
Norberto Bottani, ancien responsable du Service de la Recherche en Education de la république de Genève, ancien responsable à l’OCDE de l’élaboration du système d’indicateurs « Regards sur l’éducation ».
Aletta Grisay , chercheuse en Education, membre du Technical Advisory Group du programme PISA.
Marc Gurgand, économiste de l’éducation, professeur associé à l’Ecole d’Economie de Paris.
Denis Meuret , professeur de sciences de l’éducation à l’université de Bourgogne, membre de l’Institut Universitaire de France.
Liens :
L’école française n’est pas gouvernée
http://cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pa[…]
Meirieu : « Je ne peux accepter que l’idéologie des compétences devienne une « théorie de l’apprentissage »
http://cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2011/09/05Meirieu.aspx
Et la réponse : Qui veut revenir en arrière ?
Eléments de réponse au texte de Daniel Andler, Norberto Bottani, Aletta Grisay, Marc Gurguand et Denis Meuret : « Ecole : le retour en arrière mène à une impasse »
Par Philippe Meirieu
« Dire de l’école qu’elle doit avoir une ambition culturelle – dans tous les domaines de la culture -…, ne relève nullement de la déploration nostalgique. Soyons clairs : l’école française n’a jamais fait cela, ou alors, de manière marginale, dans quelques enclaves pour héritiers… Mais elle doit, aujourd’hui, l’ambitionner pour tous. Il n’est pas question pour moi de revenir en arrière : la construction d’une école exigeante et émancipatrice pour tous, avec une « pédagogie des situations », mobilisatrice et rigoureuse, reste à faire. C’est un beau chantier d’avenir ». Dans cette tribune Philippe Meirieu répond point par point aux critiques formulées par Daniel Andler, Norberto Bottani, Aletta Grisay, Marc Gurguand et Denis Meuret dans un texte publié par le Café pédagogique le 28 septembre.
 Alors que les anti-pédagogues (que certains s’obstinent à nommer « républicains », comme s’ils étaient propriétaires de la République !) ne désarment pas et m’accusent toujours aussi violemment d’avoir saboté l’école, sapé l’autorité des professeurs et liquidé la culture, des collègues chercheurs en éducation – et dont j’apprécie les travaux – me traitent, dans le Café pédagogique, de « réactionnaire » et affirment que mes analyses « conduisent à une impasse ». Ils qualifient ainsi les propos tenus dans les colonnes du Monde qui a publié, le 3 septembre 2011, des extraits d’un débat que j’ai eu avec Marcel Gauchet dans le cadre du « Théâtre des idées » à Avignon.
Alors que les anti-pédagogues (que certains s’obstinent à nommer « républicains », comme s’ils étaient propriétaires de la République !) ne désarment pas et m’accusent toujours aussi violemment d’avoir saboté l’école, sapé l’autorité des professeurs et liquidé la culture, des collègues chercheurs en éducation – et dont j’apprécie les travaux – me traitent, dans le Café pédagogique, de « réactionnaire » et affirment que mes analyses « conduisent à une impasse ». Ils qualifient ainsi les propos tenus dans les colonnes du Monde qui a publié, le 3 septembre 2011, des extraits d’un débat que j’ai eu avec Marcel Gauchet dans le cadre du « Théâtre des idées » à Avignon.
Précisons d’abord deux points de méthode. D’abord, même si j’assume totalement les propos retranscrits dans Le Monde (propos que j’ai relus et validés), je précise qu’il ne s’agit que de courts extraits d’une longue discussion de deux heures. Au cours de ce débat, nous avons abordé d’autres questions et ouvert d’autres perspectives, répondant partiellement aux interrogations et objections de mes collègues. J’espère que le texte complet de cet entretien paraîtra bientôt et lèvera quelques ambiguïtés. En attendant, et pour compléter ces extraits, je me permets de renvoyer à l’ouvrage qui retranscrit les entretiens que j’ai eus, il y a quelques mois, avec le psychanalyste Jean-Bertrand Pontalis, publiés en février 2011 aux éditions Jacob-Duvernet sous le titre « L’école et son miroir ». Cette lecture pourra permettre, je pense, de lever le soupçon d’opportunisme et de « recentrage » qui semble courir à la suite de l’article du Monde…
Ensuite, toujours sur la méthode, je dois dire ma surprise de voir les rédacteurs du texte paru dans le Café pédagogique citer indifféremment des propos de Marcel Gauchet et de moi-même sans jamais en préciser l’auteur. Certes, nous avons, Marcel Gauchet et moi, de vraies convergences, mais nous exprimons aussi de vraies différences qui devraient interdire tout amalgame. Sur les questions de l’autorité, de l’entrée dans l’écrit et même des « compétences », nos discours ne sont nullement superposables. Et l’on peut légitimement demander à des chercheurs qui se veulent rigoureux d’attribuer au moins les citations à leur auteur… si ce n’est de repérer et d’expliciter les spécificités de chaque apport.
Sur le fond, je souhaite simplement apporter ici quelques précisions afin, non de clore le débat, mais de lui permettre de se poursuivre de manière constructive.
Je ne considère pas mon propos comme « alarmiste » et, a fortiori, nostalgique. Je constate, au même titre que Bernard Stiegler – qui peut quand même difficilement être traité de « réactionnaire » ! – que les psycho-pouvoirs prennent aujourd’hui une ampleur toute particulière. Instrumentalisés par le marché, ils contribuent à l’avènement de ce que Stiegler nomme « le capitalisme pulsionnel » et dont les effets sur les capacités d’attention et de réflexion de nos élèves paraissent difficilement contestables.
Dire cela n’est pas nier que les technologies de l’information et de la communication peuvent contribuer à l’émergence d’une « société de la connaissance », mais c’est interroger les conditions que requiert cette émergence. Des travaux existent sur ce point qui semblent montrer que les choses ne sont pas spontanées. Un prochain ouvrage que nous publierons en janvier avec Bernard Stiegler et Denis Kambouchner permettra, peut-être, de clarifier un peu les positions respectives sur ce point.
Mais, en attendant, je persiste à affirmer qu’il ne suffit pas qu’il existe des « occasions d’apprendre » ou des « ressources » à disposition des « apprenants » pour que les personnes apprennent. C’est ce que j’ai montré dans mes travaux sur les interactions entre pairs dès 1983 et que je n’ai cessé de vérifier depuis. Nul n’est obligé, il est vrai, de connaître ces travaux, mais on peut, au moins, aujourd’hui, se méfier de l’allant-de-soi de la vulgate libérale-libertaire selon laquelle il suffirait de fournir des « occasions » et des « ressources » à tous les sujets pour qu’ils engagent, avec le même engouement et les mêmes chances de réussite, des apprentissages. Quant à « l’accord général sur l’importance de la réussite scolaire », il ne garantit pas que les élèves sont eux-mêmes partie prenante de cette volonté de « réussir »… et, le fussent-ils, on ne peut en déduire qu’ils vont se mettre à apprendre : la distinction de Piaget entre « réussir » et « comprendre » reste pertinente et nous invite à construire des situations pédagogiques dans lesquelles, effectivement, le désir de réussir engrène sur la volonté de comprendre. Ce n’est pas revenir en arrière que de chercher à mettre en place ce type de situations. Et ce n’est pas aller de l’avant que de laisser chacune et chacun s’aventurer sans autre bagage que sa culture familiale dans une « société de la connaissance » encore fort inégalitaire.
 Concernant précisément les familles, je n’ai jamais dit, ni sous-entendu, que les parents étaient « permissifs, décérébrés et décérébrants ». Tout au contraire. Je ne cesse d’expliquer qu’ils sont souvent simplement démunis et que les questions auxquelles ils sont affrontés (« Comment aider ses enfants à utiliser leurs téléphones portables ? », « Comment faire avec un adolescent qui passe cinq heures par nuit devant World of Warcraft ? ») sont de vraies questions, inédites mais tout à fait sérieuses et qui méritent une réflexion collective à la hauteur des enjeux. Pour avoir longtemps accompagné des parents dans un travail sur la parentalité, je suis convaincu que le vrai mépris des familles est, aujourd’hui, du côté de ceux et celles qui imaginent que ces questions, et bien d’autres, se résolvent spontanément. Ce n’est pas en ignorant les problèmes des familles qu’on ira de l’avant. Et je ne vois pas pourquoi les considérer comme des questions sociales et pédagogiques dignes d’intérêt serait un retour en arrière.
Concernant précisément les familles, je n’ai jamais dit, ni sous-entendu, que les parents étaient « permissifs, décérébrés et décérébrants ». Tout au contraire. Je ne cesse d’expliquer qu’ils sont souvent simplement démunis et que les questions auxquelles ils sont affrontés (« Comment aider ses enfants à utiliser leurs téléphones portables ? », « Comment faire avec un adolescent qui passe cinq heures par nuit devant World of Warcraft ? ») sont de vraies questions, inédites mais tout à fait sérieuses et qui méritent une réflexion collective à la hauteur des enjeux. Pour avoir longtemps accompagné des parents dans un travail sur la parentalité, je suis convaincu que le vrai mépris des familles est, aujourd’hui, du côté de ceux et celles qui imaginent que ces questions, et bien d’autres, se résolvent spontanément. Ce n’est pas en ignorant les problèmes des familles qu’on ira de l’avant. Et je ne vois pas pourquoi les considérer comme des questions sociales et pédagogiques dignes d’intérêt serait un retour en arrière.
Par ailleurs, contrairement à ce que l’usage des guillemets pourrait laisser penser (1), je n’ai jamais dit ni écrit que les parents n’étaient préoccupés que par « l’épanouissement affectif » de leurs enfants et se désintéressaient de leur réussite scolaire. J’ai dit que les parents sont aujourd’hui dans une situation où il leur est plus difficile de refuser quoi que ce soit à leurs enfants. Y compris, à l’occasion, pour favoriser leur réussite scolaire ! Ce n’est vraiment pas la même chose. Et, puisque mes collègues convoquent les sociologues, je les invite à regarder du côté des psychologues et des pédopsychiatres. Je ne suis pourtant pas un aficionado des contempteurs de Mai 68 et j’ai souvent bagarré contre les injonctions au retour de l’autorité qui ne cachent que fort mal, à vrai dire, leur nostalgie de l’autoritarisme. Mais quand même, nous ne pouvons ignorer les pathologies de la toute-puissance et les souffrances qu’elles engendrent. D’autant plus que ces pathologies sont exaltées par les médias et les politiques réunis. Au point de ringardiser le travail pédagogique indispensable de construction du cadre et d’élaboration de la loi. En vieil adepte de la « pédagogie institutionnelle », je crois, avec Fernand Oury, que l’éducation ne peut se confondre avec la simple contemplation bienveillante des « petits Emile au cul rose ». Et je suis convaincu que toute abdication, dans ce domaine, nous prépare de terribles retours en arrière vers le despotisme, de la part des spécialistes bien connus du « je vous l’avais bien dit » !
Mais la vraie critique du texte de mes collègues porte sur ma conception des rapports entre l’école et la culture : ils m’accusent de promouvoir une école « fondée essentiellement sur la transmission du patrimoine culturel, l’accès aux œuvres et le mépris du professionnel ». Est-ce parce que je critique la réduction des objectifs de l’enseignement à une vision béhavioriste des compétences ? Auquel cas, ce sont eux qui méprisent « le travail » et « les classes laborieuses » : comment peut-on prétendre qu’un métier – quel qu’il soit – se réduit à une somme de compétences reproductibles ? Comment peut-on ignorer la dimension fondamentalement culturelle de toute profession, tant dans le rapport complexe, et construit tout au long de son histoire, qu’elle entretient avec le monde, que dans la manière dont elle organise le collectif de ceux qui la pratiquent ?… Mais peut-être mes collègues craignent-ils que je promeuve une vision passéiste de la culture, réduite à la seule rencontre des œuvres littéraires académiques appelées jadis « humanités » ? A ce sujet, ils notent que mon texte « devient étrange (…) quand, par exemple, il propose la méditation des œuvres scientifiques comme modalité de l’enseignement des sciences ». Etrange lapsus calami de leur part : moi-même (puisque c’est moi qui intervient ici dans l’entretien) ne parle évidemment pas de « méditation », mais de « médiation ». Et il me semble, si mes collègues veulent bien regarder ce que je dis vraiment, qu’il y a là quelque chose de parfaitement entendable : un interrupteur comme un moteur à explosion, un composant électronique comme un circuit électrique sont bien, au beau sens du mot, des « œuvres » de l’intelligence humaine et peuvent bien constituer des médiations pour entrer dans la compréhension technologique et scientifique des choses. Je crois même que tous les professeurs de technologie font cela au quotidien. J’ai même été convaincu par des didacticiens des sciences fort estimables – même si leurs thèses sont, évidemment, discutables – que la médiation par l’histoire des sciences, par la compréhension des ruptures épistémologiques et des conditions d’élaboration des savoirs, peut efficacement permettre d’accéder à un haut niveau de connaissance scientifique, et cela dès les petites classes. Mes collègues peuvent contester cette thèse, mais je ne vois pas en quoi elle constituerait un « retour en arrière ». Tout au contraire, j’ai tendance à penser qu’un enseignement qui permet de comprendre que les théories scientifiques ne sont pas des « essences éternelles et immuables », mais qu’elles sont des « œuvres » construites par les hommes pour leur possible émancipation, serait un enseignement qui nous ferait faire un sacré bond en avant !
Enfin, bien sûr, reste la question des évaluations nationales et internationales. Je n’ai jamais sous-estimé PISA et j’ai commenté, à plusieurs reprises, les résultats de cette enquête sur ce site du Café pédagogique. J’ai même souvent souligné la finesse de certaines analyses de PISA et dit à quel point il nous fallait les prendre au sérieux. En revanche, je crois qu’il ne faut pas confondre le tableau de bord avec le moteur ni imaginer que le fait de disposer d’une bonne carte dispense de choisir sa destination. Je ne demande pas, contrairement à ce que disent mes collègues, d’ « ignorer PISA ». Mais je préfère qu’on ne confie pas, ni à PISA ni à aucun autre système d’évaluation, le soin de définir nos curricula et nos méthodes pédagogiques. Je dénonce l’hégémonie du « modèle de l’évaluation » qui, érigé en politique éducative et en théorie de l’apprentissage, fait passer l’école sous les fourches caudines de l’employabilité béhavioriste.
Aucun mépris pour « l’utile » là-dedans. Aucune condescendance à l’égard de « ce qui fait tourner la boutique ». Mais, tout au contraire, une revendication, sans doute utopique, pour que « ce qui fait tourner la boutique » soit une pensée et non une mécanique. Une revendication pour que nos élèves deviennent, dans toutes les sections (générales, professionnelles et technologiques), des êtres conscients des enjeux de leur histoire et non des « bêtes à QCM »… Dire de l’école qu’elle doit avoir une ambition culturelle – dans tous les domaines de la culture -, affirmer qu’elle doit aider à se concentrer, à penser, à examiner de manière exigeante les vulgates en circulation, ne relève nullement de la déploration nostalgique. Soyons clairs : l’école française n’a jamais fait cela, ou alors, de manière marginale, dans quelques enclaves pour héritiers… Mais elle doit, aujourd’hui, l’ambitionner pour tous. Il n’est pas question pour moi de revenir en arrière : la construction d’une école exigeante et émancipatrice pour tous, avec une « pédagogie des situations », mobilisatrice et rigoureuse, reste à faire. C’est un beau chantier d’avenir.
Philippe Meirieu
Liens :
La tribune de Daniel Andler, Norberto Bottani, Aletta Grisay, Marc Gurguand et Denis Meuret
http://cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2011/09/280911Tribune.aspx
Je ne peux accepter que l’idéologie des compétences devienne une « théorie de l’apprentissage
http://cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2011/09/05Meirieu.aspx
Ce qui fonde la pédagogie
http://cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/20[…]
Cesser d’arroser là où c’est mouillé (sur Pisa)
http://cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2010/12/0712[…]
Note :
Un lecteur nous signale qu’une citation prêtée à P. Meirieu, dans la tribune de D. Andler et alii, est erronée. » Cette tribune cite, entre guillemets, donc présentés comme propos réellement prononcés, la phrase suivante : s’il « ne fait pas partie de la mission de l’école de transmettre des compétence (sic), aussi nécessaires soient-elles… ». Fort surpris de trouver une telle assertion sous la plume de Philippe Meirieu, dont je connais les idées, je suis allé voir ce qu’il en était réellement dans leur interview et j’ai trouvé la phrase suivante : »La mission de l’école ne doit pas se réduire à l’acquisition d’une somme de compétences, aussi nécessaires soient-elles, mais elle relève de l’accès à la pensée ». Je constate donc que la citation a été tronquée, et gravement, car dire que la transmission des compétences « ne fait pas partie de la mission de l’école » et dire que la mission de l’école ne doit pas « se réduire » à « l’acquisition d’une somme de compétences », ce n’est évidemment pas du tout la même chose. »
A voir également : Compétences : Meirieu s’explique à nouveau
Accusé de « trahison » pour avoir pris quelque distance avec l’approche par compétences pratiquée dans l’éducation nationale, Philippe Meirieu s’en explique sur son site dans un dialogue avec Luc Cédelle. « Je me suis toujours méfié de la totémisation des compétences et, a fortiori, de leur hégémonie, pour plusieurs raisons fondamentales », explique-t-il. « D’abord, parce que le pilotage de l’enseignement ou de la formation par les référentiels de compétences me paraît porter en lui la dérive de l’atomisation des savoirs en une multitude de « comportements observables ». Dès lors, en effet, que l’on veut absolument vérifier l’acquisition des compétences de manière « parfaitement objective », on est amené à découper cette acquisition en unités sur lesquelles aucune hésitation ne sera possible et à propos desquelles on pourra dire sans hésitation « acquis » ou « non acquis »… Disparues les situations d’apprentissage ! Disparue la mobilisation autour d’un projet. Disparu le « tâtonnement expérimental » cher à Célestin Freinet. Disparu le travail réflexif et la pensée qui prend le temps d’explorer le monde. Telle est la dérive béhavioriste – comportementaliste – de l’utilisation des compétences que je vois émerger un peu partout ».
Pour lui c’est une conception dégradée de l’éducation qui est à l’oeuvre. « C’est une dérive qui se prête, évidemment, fort bien à une utilisation « économiste » de la formation initiale et continue : ne plus former chez les personnes que ce qui sera immédiatement utilisable, négociable, mesurable et rétribuable. Mais c’est aussi une dérive qui cadre parfaitement avec le modèle actuel de l’individualisation : le caddy de supermarché. Voilà, en effet, la forme parfaite de l’individualisation contemporaine en matière d’éducation et de formation : chacun choisit « ce qu’il veut », c’est-à-dire ce qu’il peut « se payer », dans une offre dont la quantité est censée garantir la qualité. Et chacun « est reconnu dans sa différence » : aucun caddy ne correspond à un autre ! C’est là ce qu’on nous propose aujourd’hui sous le nom d’ « individualisation » ! »
Sur le site de P Meirieu
http://www.meirieu.com/nouveautesblocnotes_dernier.htm
|
Sur le site du Café
|










