Par Rémi Brissiaud
– L’analyse classique de la compétence à résoudre des problèmes
– Les concepteurs des programmes, des évaluations et du concours : tous perplexes !
– « Le nombre au cycle2 » : un ouvrage dont la lecture laisse perplexe
– Les dilemmes de l’automatisation des procédures et de la symbolisation des opérations
– Une note de synthèse de l’inspection générale particulièrement inquiétante
Maître de conférences de psychologie à l’Université de Cergy-Pontoise, Rémi Brissiaud est un des meilleurs spécialistes de l’apprentissage des mathématiques au primaire, une période où on sait qu’il est fortement prédictif de la réussite scolaire. Dans cet article il exprime ses inquiétudes sur le décalage entre les savoirs universitaires sur les apprentissages mathématiques, les méthodes recommandées au primaire et même les épreuves des concours d’enseignement. Au passage il égratigne un ouvrage pédagogique publié par la Dgesco (ministère) sur « Le nombre au cycle 2″ et le récent rapport de l’Inspection générale sur l’application des nouveaux programmes du primaire. Entre savoirs savants et aspirations politiques, les nouveaux programmes n’ont aps su réellement choisir. De ce fait, il interroge » Quel serait le sens d’une formation universitaire et quel serait le sens d’un concours où les candidats seraient conduits, le jour du concours, à taire ce qu’ils ont appris lors de leur formation ? »
 Alors que les programmes de 1985, 1995 et 2002 étaient en forte continuité, ceux de 2008 se sont affichés en rupture sur un point au moins : il convient d’accorder plus d’importance à la mémorisation des relations numériques (« huit plus quatre égale douze » ; « quatre fois huit, trente-deux », etc.) ainsi qu’à l’automatisation des savoir-faire, dont les techniques opératoires. Dans le même temps, ces nouveaux programmes ont continué de mettre l’accent sur la résolution de problèmes. On y lit que celle-ci « fait l’objet d’un apprentissage progressif et contribue à construire le sens des opérations ». Mais comment concilier ces divers objectifs ? Comment se coordonnent la mémorisation des relations numériques, l’automatisation des savoir-faire et la compréhension des opérations arithmétiques ?
Alors que les programmes de 1985, 1995 et 2002 étaient en forte continuité, ceux de 2008 se sont affichés en rupture sur un point au moins : il convient d’accorder plus d’importance à la mémorisation des relations numériques (« huit plus quatre égale douze » ; « quatre fois huit, trente-deux », etc.) ainsi qu’à l’automatisation des savoir-faire, dont les techniques opératoires. Dans le même temps, ces nouveaux programmes ont continué de mettre l’accent sur la résolution de problèmes. On y lit que celle-ci « fait l’objet d’un apprentissage progressif et contribue à construire le sens des opérations ». Mais comment concilier ces divers objectifs ? Comment se coordonnent la mémorisation des relations numériques, l’automatisation des savoir-faire et la compréhension des opérations arithmétiques ?
Malheureusement, l’injonction de rédiger ces nouveaux programmes a précédé toute étude sérieuse de leur faisabilité, soit par recensement et confrontation des résultats de recherches existantes, soit par la mise en œuvre de nouvelles expérimentations. Cela a laissé des traces à l’école élémentaire. L’une d’elles est que les professeurs des écoles manquent de repères concernant l’une de leurs principales missions : l’enseignement des opérations arithmétiques.
Le phénomène ne touche pas seulement les enseignants de terrain parce que, comme cela va être montré, les concepteurs des programmes 2008, ceux des épreuves d’évaluation annuelles et ceux des « sujets 0 » des futures épreuves pédagogiques de recrutement, sont, eux aussi, en proie à de nombreuses incertitudes. Le ministère a récemment mis en ligne sur education.gouv un ouvrage qui est le premier censé servir d’accompagnement pédagogique aux nouveaux programmes. Son titre est : Le nombre au cycle 2 (voir le lien en fin d’article). On aurait pu espérer qu’il eût permis d’aller vers plus de certitudes. Or, nous verrons que sa lecture laisse tout autant perplexe. De manière encore plus récente, la note de synthèse 2010 de l’inspection générale sur l’application des nouveaux programmes (voir le lien en fin d’article) rapporte-t-elle ces incertitudes des autorités ministérielles et de leurs collaborateurs ? Non, elle les passe sous silence et, par conséquent, la posture de recommandation que les inspecteurs généraux adoptent ne peut que créer un profond malaise tant chez les professeurs d’écoles qui reçoivent ces recommandations que chez les équipes de circonscription qui sont censées les transmettre. Ces dernières sont d’ailleurs directement interpellées dans la note de synthèse lorsqu’on y lit : « Les (difficultés) tiennent moins à un manque de connaissance des programmes par les maîtres qu’à une insuffisante compréhension des enjeux et des modalités des apprentissages premiers pour eux et pour nombre de leurs formateurs ».
Dans six mois environ, les candidats au nouveau concours de professeur des écoles passeront une épreuve pédagogique orale. Il serait important que, d’ici là, il y ait une meilleure diffusion des connaissances scientifiques permettant de penser l’articulation entre la mémorisation des relations numériques, l’automatisation des savoir-faire et la compréhension des opérations arithmétiques. Une première théorie, insuffisamment diffusée bien qu’elle ait près de 20 ans et qu’elle rende compte d’un grand nombre de phénomènes couramment observés par les pédagogues, est la théorisation de la distinction entre connaissances procédurales et connaissances déclaratives que Jean-Paul Fischer a avancée en 1992. Ce sera l’une des principales références théoriques de ce texte. Cette approche, cependant, laisse pour l’essentiel en suspens la question de la compréhension des opérations. Bien que cette question soit déjà abordée dans ce premier texte, c’est seulement dans un second, intitulé : La pédagogie et la didactique des opérations arithmétiques à l’école (2) : distinguer la compréhension des situations et celle des opérations, que sera présenté un cadre théorique susceptible de répondre sur ce sujet à la plupart des interrogations des pédagogues. Cette suite sera ultérieurement publiée ici même.
En fait, pour que la question de la progressivité de l’apprentissage des opérations arithmétiques ne plonge plus les acteurs du système éducatif dans autant de perplexité, il conviendrait de montrer comment on peut rentrer dans un rapport expérimental à cette question. C’est ce qu’on se propose de faire dans ce texte en montrant que toute pratique pédagogique conduit à gérer deux dilemmes : celui de l’automatisation des procédures et celui de la symbolisation des opérations arithmétiques.
Mais auparavant, comme la confusion des mots est l’un des principaux obstacles à la pensée, on rappellera comment, classiquement, on analyse la compétence à résoudre des problèmes arithmétiques. Cela sera aussi un moyen de rappeler que les programmes de 2002 n’étaient pas exempts de critiques. Rappelons-le : ce qui est extrêmement regrettable dans ce qui s’est passé ces dernières années, ce n’est pas que les programmes aient été changés, c’est la façon dont ce changement a été conduit.
L’analyse classique de la compétence à résoudre des problèmes
Connaissances procédurales, déclaratives et conceptuelles
Parmi les ressources cognitives que la compétence à résoudre des problèmes arithmétiques mobilise, il est classique de distinguer des connaissances procédurales ou savoir-faire (savoir compter, savoir poser et exécuter les opérations arithmétiques…) et des connaissances déclaratives ou « savoir que… » (savoir que « neuf plus quatre égale treize » ; savoir que « quatre fois huit, trente-deux », par exemple). Cependant, les chercheurs et pédagogues anglophones distinguent une troisième sorte de connaissances qui peuvent renvoyer soit à des savoir-faire, soit à des « savoir que » et qui sont qualifiées de « conceptuelles ». Rittle-Johnson & Siegler (1998) les définissent ainsi : « conceptual knowledge is defined as implicit or explicit understanding of the principles governing a domain ». Ainsi, lorsqu’on parle de « connaissances conceptuelles » d’une opération arithmétique, cela rend compte de la compréhension (understanding) de cette opération (cette notion de compréhension est précisée plus loin).
C’est à cette analyse que se réfèrent par exemple les chercheurs d’une commission du Département de l’Éducation des USA (2008) qui étaient récemment chargés de rédiger une synthèse des connaissances disponibles concernant les apprentissages arithmétiques à l’école. Ils insistent sur le fait que : Conceptual understanding of mathematical operations, fluent execution of procedures, and fast access to number combinations together support effective and efficient problem solving » (p. 26). Ce que l’on peut reformuler ainsi : Comprendre les opérations arithmétiques, disposer de techniques de calcul automatisées et avoir bien mémorisé les principales relations numériques sont les trois ingrédients qui, ensemble, participent à la formation de la compétence en résolution de problèmes.
Qu’est-ce que comprendre une opération arithmétique ?
Pour le dire simplement, et en français, avoir une connaissance conceptuelle de la soustraction, par exemple, c’est avoir acquis « le sens », ou plutôt « les sens », de cette opération. Illustrons cette pluralité des sens d’une même opération, en prenant pour exemple la soustraction. On sait que la différence entre 2 grandeurs (entre 2 collections, entre 2 longueurs, entre 2 aires, etc.) peut se définir comme « ce qui dépasse lorsqu’on met en correspondance ce qui est pareil dans les 2 grandeurs ».

Grâce à cette mise en correspondance, on comprend que « ce qui est différent » est à la fois ce qu’il faut ajouter à la petite grandeur pour obtenir la grande, et ce qui reste lorsqu’on retire la petite grandeur à la grande. Comprendre cela, que ce soit explicitement ou de manière intuitive, conduit à l’idée que la soustraction permet à la fois de :
* comparer deux grandeurs (lorsqu’on cherche ce qui est différent),
* déterminer le complément qu’il faut ajouter à la petite grandeur pour obtenir la grande,
* déterminer ce qui reste lorsqu’on retire la petite grandeur à la grande.
On a là les trois principaux « sens » de la soustraction arithmétique.
De même, la division a ÷ b permet de résoudre à la fois des problèmes dits de partition (ceux où l’on cherche la valeur d’une part ou, plus généralement, la « valeur à l’unité » : 4 objets identiques valent 60, quel est le prix d’un objet ?, par exemple) mais aussi les problèmes de quotition où il faut chercher : « En a combien de fois b ? » (Si l’on veut faire un 10 000 m autour d’une piste de 368 m, combien de tours faut-il faire ?, par exemple). Ce sont là les deux principaux sens de la division arithmétique.
Qu’en est-il des propriétés conceptuelles de l’addition et de la multiplication ? La principale de ces propriétés, commune à ces deux opérations, est la commutativité : « a + b = b + a » et « a x b = b x a ». Avoir acquis la commutativité de l’addition conduit, par exemple, à savoir que 10 ans après l’an 2000, ou 2000 ans après l’an 10, sont deux façons différentes de désigner la même année. Pour calculer 10 + 2000, on peut effectuer un autre ajout que celui qui correspond au déroulement temporel de l’« histoire » ou un autre ajout que celui correspondant à une lecture de gauche à droite de cette addition. De même, avoir acquis la commutativité de la multiplication conduit à comprendre que le nombre 2, lorsqu’il est répété 37 fois (2 + 2 + 2…) conduit au même résultat que 37 répété 2 fois : 37 + 37 (on peut donc effectuer une autre répétition que celle dont on parle dans un énoncé de problème). Ainsi, dans le cas de l’addition et de la multiplication, la pluralité des sens de ces opérations renvoie pour l’essentiel à la pluralité des sens de leur utilisation : on peut calculer dans un sens ou dans l’autre.
En résumé, la compréhension des opérations arithmétiques renvoie à l’utilisation de ce qu’on pourrait appeler leur « aspect couteau suisse » : une seule opération (la soustraction, par exemple) a des usages très différents (la comparaison, la recherche d’un complément et celle d’un reste, pour la soustraction). C’est d’ailleurs l’un des principaux reproches que l’on pouvait faire aux programmes de 2002 et aux textes pédagogiques qui les accompagnaient : ne pas suffisamment souligner cette propriété des opérations arithmétiques. Rappelons qu’à l’époque, l’ensemble constitué des programmes des cycles 2 et 3 et de leurs documents d’application, formait un document de 108 pages. Or, nulle part il n’était dit que la propriété essentielle de la division est d’être un traitement commun aux problèmes de quotition et de partition. Nulle part il n’était dit, en s’exprimant de façon moins générale, que la division par n est un traitement commun aux problèmes de groupement par n et de partage en n parts égales (Brissiaud, 2006).
Les conceptions naïves des opérations
Quand quelqu’un sait résoudre les trois principaux types de problèmes qui donnent sens à la soustraction, on peut dire de cette personne qu’elle dispose d’une première compréhension de cette opération. Des chercheurs comme Gérard Vergnaud ont insisté sur le fait que certains problèmes de soustraction restent mal résolus au collège, montrant ainsi qu’une compréhension approfondie est un processus de longue haleine. Cependant, ce sont évidemment les débuts de la conceptualisation de cette opération qui intéressent prioritairement les professeurs des écoles. Or lorsqu’une personne sait utiliser la soustraction pour déterminer à la fois un reste, un complément et pour procéder à une comparaison, cela atteste du fait que, pour elle, l’usage de la soustraction ne se réduit plus à la seule recherche d’un reste. En effet, derrière la notion de « connaissance conceptuelle d’une opération », il y a l’idée fondamentale que, pour chacune des opérations arithmétiques, l’un des sens est plus saillant que les autres et qu’il risque d’empêcher l’accès aux autres sens : de nombreux élèves pensent longtemps que la soustraction ne s’utilise que dans un contexte de retrait. Il n’y a pas de début de compréhension d’une opération sans accès à au moins un autre sens que celui qui est saillant. Ainsi, l’addition arithmétique n’est pas un simple ajout, la soustraction arithmétique n’est pas un simple retrait, la multiplication arithmétique n’est pas une simple répétition à l’identique et la division n’est pas un simple partage. L’élève qui penserait cela pour l’une ou l’autre de ces opérations disposerait seulement de ce que certains chercheurs appellent une « conception naïve » de cette opération (Sander, 2008), conception qu’il convient tout aussi bien de qualifier de « stéréotypée » parce que le mot « naïf », en l’occurrence, renvoie à l’idée d’une élaboration insuffisante.
C’est évidemment dans le fonctionnement quotidien des mots « additionner », « soustraire », « multiplier » et « diviser » que les conceptions naïves trouvent leur origine. Si, face à une assiette de gâteaux, vous demandez à quelqu’un de diviser le tas de gâteaux par 4, la personne fera systématiquement 4 parts égales ; jamais elle ne se mettra à grouper les gâteaux par 4. Et pourtant, diviser par 4 permet tout autant de savoir combien de groupes de 4 gâteaux il est possible de former que de les partager en 4 parts égales. L’école a évidemment pour responsabilité de mettre l’accent sur les sens des opérations qui ne sont pas portés par le langage quotidien. C’est là un autre reproche qu’on pouvait faire aux programmes de 2002 et aux textes pédagogiques qui les accompagnaient : ils n’étaient pas suffisamment attentifs à cette responsabilité. Concernant la soustraction, par exemple, les programmes officiels recommandaient une pratique pédagogique conduisant à un risque majeur d’enfermement dans une conception naïve de cette opération : il était recommandé d’associer étroitement la soustraction au comptage à rebours, et cela durant tout le cycle 2 (Brissiaud, 2006).
En prolongeant la métaphore du couteau, favoriser la compréhension des opérations arithmétiques, c’est éviter que les élèves les considèrent comme des couteaux à une lame plutôt que comme des couteaux suisses.
La façon classique d’évaluer la compréhension des opérations
Il est important de souligner que pour être crédité d’une connaissance conceptuelle de la multiplication, par exemple, il n’est pas nécessaire qu’un élève connaisse le mot commutativité, ni qu’il sache définir cette propriété : l’essentiel est qu’il l’utilise de façon ordinaire lors des résolutions de problème. La définition précédemment avancée des connaissances conceptuelles est : « conceptual knowledge is defined as implicit or explicit understanding of the principles governing a domain ». Il n’est donc pas obligatoire que l’élève sache verbaliser cette sorte de connaissance pour la lui attribuer ; lorsque ce n’est pas le cas, on dit de cette connaissance conceptuelle qu’elle est implicite.
Ainsi, utiliser la soustraction pour résoudre aussi bien des problèmes de comparaison, de détermination d’un reste ou d’un complément, utiliser la division pour résoudre aussi bien des problèmes de quotition que de partition, c’est-à-dire, plus généralement, faire usage de l’aspect « couteau suisse » des opérations arithmétiques, tous ces comportements révèlent l’usage de connaissances conceptuelles. Classiquement, c’est ainsi qu’on évalue la compréhension des opérations chez les élèves : on leur propose des problèmes variés, en étant particulièrement attentif à proposer d’autres problèmes que ceux qui correspondent aux sens typiques des opérations. En effet, si l’on veut diagnostiquer les élèves qui n’ont qu’une conception stéréotypée des opérations, il est nécessaire de proposer des problèmes qui mettent en échec leur résolution à partir d’une telle conception.
Les concepteurs des programmes, des évaluations et du concours : tous perplexes !
Des concepteurs des programmes perplexes
 Rappelons qu’en 2008, on a failli revenir au programme de 1945 avec, notamment, l’enseignement de la technique opératoire des 4 opérations dès le CP. Un rapport sénatorial de 2007 le recommandait explicitement et, en 2008, la première version des programmes ayant été proposée à la discussion des enseignants, faisait effectivement ce choix. Ce retour était prôné par les défenseurs de méthodes fondées sur un enseignement expositif, enseignement qu’ils supposent être le seul à pouvoir être progressif et exigeant du point de vue de la mémorisation des relations numériques (« quatre fois huit, trente-deux) et l’automatisation des techniques opératoires.
Rappelons qu’en 2008, on a failli revenir au programme de 1945 avec, notamment, l’enseignement de la technique opératoire des 4 opérations dès le CP. Un rapport sénatorial de 2007 le recommandait explicitement et, en 2008, la première version des programmes ayant été proposée à la discussion des enseignants, faisait effectivement ce choix. Ce retour était prôné par les défenseurs de méthodes fondées sur un enseignement expositif, enseignement qu’ils supposent être le seul à pouvoir être progressif et exigeant du point de vue de la mémorisation des relations numériques (« quatre fois huit, trente-deux) et l’automatisation des techniques opératoires.
L’opération arithmétique pour laquelle le changement aurait été le plus brutal est évidemment la division (les documents d’application des programmes de 2002 recommandaient de n’enseigner la technique opératoire de la division qu’au CM2). Nous avons été quelques uns à « prendre la plume » pour montrer qu’un tel coup de balancier serait assurément néfaste et pour argumenter en faveur de l’introduction de la division dès le CE2, mais au CE2 seulement. En 2008, c’était d’ailleurs ce qu’une majorité de maîtres avaient, de fait, déjà choisi de faire. L’argument le plus important en faveur d’une introduction de la division au CE2 est que son enseignement, s’il est trop précoce, conduit les élèves les plus fragiles à s’enfermer dans la conception naïve de cette opération, conception selon laquelle « diviser, c’est partager et c’est seulement partager ». Ainsi, lorsqu’on examine les manuels d’avant 1970, alors que la division était au programme du CE1, on s’aperçoit que la plupart des maîtres avaient renoncé à enseigner le fait que cette opération permet de résoudre à la fois des problèmes de partition et de quotition, rabattant ainsi le sens de la division sur le seul partage. L’explication la plus probable d’un tel renoncement à enseigner ce qui, pourtant, figurait au programme, est évidemment que les élèves, de façon systématique, ne comprenaient pas ce qu’on essayait de leur enseigner. Quelles que soient les pratiques pédagogiques, très peu d’élèves de cycle 2 peuvent s’approprier l’aspect « couteau suisse » de la division.
C’est pourquoi, en 2008, la proposition raisonnable qui était avancée pour les nouveaux programmes consistait à :
a) Programmer l’enseignement de la résolution des deux types de problèmes : partition et quotition dès le cycle 2 (GS, CP et CE1). Considérer cependant qu’à ce niveau de la scolarité, leurs résolutions s’effectuent de manières indépendantes, la compréhension du lien qui existe entre eux (existence d’une opération qui permet de résoudre l’un et l’autre), étant au-delà de la capacité de compréhension de la plupart des élèves.
b) Faire de la définition de la division (« C’est une opération qui consiste à rechercher deux nombres : le quotient et le reste tels que … »), de la symbolisation correspondante (introduction des mots division, quotient, reste, introduction des lettres q et r, du symbole « ÷ », etc.) et faire de l’enseignement de la technique posée, un ensemble d’événements de la scolarité au CE2, en insistant évidemment sur la propriété conceptuelle de cette opération : elle permet de résoudre à la fois des problèmes de partition et de quotition.
On peut donc se réjouir que ce point de vue soit celui que les programmes de 2008 ont retenu. En effet, dans le bref texte présentant les programmes de mathématiques au cycle 2, on lit : « (les élèves) apprennent les techniques opératoires de l’addition et de la soustraction, celle de la multiplication et apprennent à résoudre des problèmes faisant intervenir ces opérations. Les problèmes de groupement et de partage permettent une première approche de la division pour des nombres inférieurs à 100. » Très clairement, la division est dans ce texte traitée différemment des autres opérations arithmétiques et on y parle seulement d’approcher cette opération à travers la résolution de problèmes de groupement (quotition) et de partage (partition).
Tout irait-il pour le mieux dans le meilleur des monde ? Non parce qu’en se reportant aux tableaux donnés en annexes des programmes qui présentent des progressions censées « donner des repères aux équipes pédagogiques pour organiser la progressivité des apprentissages », on lit qu’il convient au CE1 que les élèves apprennent à « diviser par 2 et par 5 des nombres inférieurs à 100 (quotient exact entier) ». Doit-on en conclure qu’il faudrait aller plus loin à ce niveau que l’approche de la division figurant dans les programmes à travers la résolution de problèmes de partage en 2 et 5 et de problèmes de groupement par 2 et par 5 ? Dans la hiérarchie des textes, le premier (les programmes) prime sur le second qui n’est là que pour servir de « repère », mais le manque de cohérence entre ces textes reflète assurément l’incertitude de leurs rédacteurs.
Des concepteurs des épreuves d’évaluation perplexes
Commençons par un exemple qui ne concerne pas les opérations arithmétiques mais qui est particulièrement révélateur des hésitations des concepteurs des nouvelles évaluations nationales. Alors qu’en 2009 le ministère présentait ces épreuves comme un outil d’évaluation permettant à la fois un bilan et un diagnostic, il est clairement apparu que, concernant les nombres décimaux en CM2, elles ne permettaient ni l’un, ni l’autre : la plupart des items censés évaluer la connaissance des nombres décimaux pouvaient être résolus en utilisant des règles portant sur les nombres entiers. C’est pourquoi les concepteurs de ces épreuves ont décidé, en 2010, de faire évoluer leur contenu de manière sensible. Ainsi, en 2009 il était demandé aux élèves d’écrire en chiffres et sous la dictée : « vingt-neuf unités et trois dixièmes » (29,3). En 2010, il leur a été demandé d’écrire : « dix-huit unités et trois centièmes » (18,03). Dans le premier cas, l’élève qui écrit les deux nombres qu’il entend dans l’ordre où il les entend (vingt-neuf et trois) en les séparant par une virgule, écrit 29,3. Il donne ainsi la réponse correcte même s’il n’a pas été attentif au fait que le chiffre 3 désigne des dixièmes. Dans le second cas, ce comportement conduit à écrire 18,3, c’est-à-dire à une réponse erronée (oubli du zéro intercalaire) ; dorénavant, les pédagogues peuvent identifier les élèves qui ne savent pas ce que sont des centièmes. De même, en 2009 il était demandé aux élèves de poser et de calculer la soustraction « 45,69 – 7,08 » (même nombre de chiffres après la virgule). En 2010, il leur a été demandé de calculer « 138,85 – 49,2 » (pas le même nombre de chiffres après la virgule). Les enseignants savent que la première de ces tâches, contrairement à la seconde, peut être réussie sans rien comprendre aux nombres décimaux : les élèves posent l’opération comme s’il s’agissait d’entiers et il leur suffit pour réussir de ne pas oublier de reporter la virgule. De même, en 2009 il était demandé aux élèves de compléter l’égalité suivante (sans poser l’opération) : « 1,5 x 4 = … ». En 2010, la même tâche leur a été proposée mais l’égalité est d’une tout autre nature : « 0,8 = 8 x … ». De manière évidente, cette dernière tâche requiert un niveau de compréhension des décimaux bien supérieur.
Bref, en 2010, les concepteurs de l’épreuve ont remplacé certains items de l’épreuve 2009 qui ne nécessitaient pas une compréhension approfondie des nombres décimaux par d’autres qui l’exigent : il n’y a rien d’étonnant, ni d’inquiétant d’ailleurs, à ce que les pourcentages de réussite soient moins élevés. Dans un autre contexte, cet ajustement des exigences n’aurait rien eu de scandaleux et aurait même pu être considéré comme un progrès : concernant les nombres décimaux, les épreuves de 2010, du moins lorsqu’elles sont proposées en fin de CM2, permettent assurément un meilleur bilan et un meilleur diagnostic que celles de 2009. Cependant, dans le contexte actuel, celui d’une confusion entre un outil d’évaluation diagnostique proposé en milieu d’année et un outil de régulation de la politique éducative qui devrait l’être en fin d’année, des pourcentages de réussite moindres risquaient d’être interprétés comme significatifs d’une baisse de niveau. Pour tenter de sauver la situation, le ministère a demandé à la DEPP de procéder aux péréquations nécessaires pour que la baisse de performances ne soit plus apparente. Les inconvénients de ce choix sont nombreux, notamment le fait que l’opacité de ce traitement fasse obstacle à une interprétation simple des résultats. Quel type d’épreuves seront retenues en 2011 ? Celles où les réussites ont une forte probabilité d’être superficielles ? Et si les épreuves retenues sont les plus difficiles, mais aussi les plus instructives, est-ce que ce sera avec ou sans péréquations ?
Revenons maintenant à la problématique de l’enseignement des opérations arithmétiques. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ni les épreuves de 2010, ni celles de 2009, n’évaluent au CM2 la compréhension des opérations arithmétiques. Nous avons vu que la méthode classique pour le faire consiste à proposer des problèmes dont les énoncés renvoient aux différents sens de l’opération choisie. Aucune des 4 opérations ne voit sa compréhension évaluée de cette manière. Concernant la division par exemple, il est proposé un problème de partition (recherche de la valeur à l’unité), ce qui correspond au sens typique de cette opération, mais aucun de quotition (En a combien de fois b ?). On peut donc penser que, comme dans le cas des nombres décimaux, cela évoluera dans les prochaines années. Attention, cependant, si le choix était fait en 2011 d’inclure un ou plusieurs problèmes de quotition dans l’épreuve : comme ce sens de la division n’est pas le plus facile à s’approprier, le ou les problèmes correspondants risquent de ne pas être très bien réussis. Faudra-t-il une nouvelle péréquation pour en tenir compte ? Incertitude quant au contenu des épreuves, incertitude quant à la manière de traiter les résultats obtenus.
Des concepteurs des « sujets 0 » pour le concours de recrutement perplexes
Le nouveau concours de professeur des écoles comporte une épreuve orale à caractère pédagogique et didactique. Elle consiste en la « présentation de la préparation d’une séquence d’enseignement en mathématiques ». Puis, « l’entretien avec le jury porte sur l’exposé et sur la progression de l’enseignement des mathématiques à l’école primaire ». Il est dit que le candidat pourra être interrogé sur les procédures d’évaluation qu’il choisirait et que durant l’entretien, on jugera de « (sa) capacité à expliquer et justifier ses choix didactiques et pédagogiques ».
Des exemples de sujets ont été publiés sur le site du ministère (ils sont dénommés « sujets 0 ») avec l’avertissement : « Les exemples de sujets sont accompagnés d’éléments de réponse attendus qui ne constituent pas des corrigés modèles, mais qui peuvent guider les candidats et les préparateurs » Cet avertissement est étonnant parce que n’importe quel lecteur est surtout frappé, dans le cas des mathématiques, par l’absence de tels éléments de réponse : on est très loin de « corrigés modèles ». C’est ainsi qu’en mathématiques, l’ensemble des sujets proposés forment un et un seul fichier téléchargeable alors que les concepteurs des « sujets 0 » de français, eux, ont éprouvé le besoin de mettre neuf fichiers téléchargeables en ligne. Comment expliquer qu’en mathématiques, il y ait aussi peu d’éléments de réponses ?
Une explication vraisemblable est que les auteurs des « sujets 0 », face à la tâche qui leur était demandée, se sont retrouvés très perplexes. Préparer une séquence nécessite évidemment de la situer dans une progression : il est impossible de justifier ce qui est fait un jour donné sans se référer à ce que les élèves ont déjà appris et à ce qu’ils vont apprendre les jours suivants. À quelle(s) progression(s) pour l’enseignement des opérations arithmétiques les concepteurs des « sujets 0 » devaient-ils se référer ? Laquelle des progressions envisageables serait celle qui permettrait le mieux à la fois la mémorisation des relations numériques, l’automatisation des procédures et la compréhension des opérations ? Répondre à cette question n’est pas une tâche si simple et les rédacteurs des « sujets 0 » de mathématiques, plutôt que de s’y risquer, semblent avoir préféré se taire : alors qu’il leur était demandé des éléments de réponse, ils en sont restés au stade des questions.
« Le nombre au cycle2 » : un ouvrage dont la lecture laisse perplexe
 Devant tant d’incertitudes, le ministère se devait de susciter une ou des publications destinées à les lever dans la mesure du possible. D’où l’ouvrage collectif intitulé : Le nombre au cycle 2 (voir le lien en fin d’article) (septembre 2010). Les inspecteurs généraux qui ont préfacé le document souhaitent : « que cet ouvrage soit largement connu et exploité par les enseignants, les équipes de circonscription, tous les formateurs. » Pour favoriser une telle exploitation, une lecture critique complète des différents textes serait nécessaire mais seul le lien entre l’automatisation des savoir-faire, la mémorisation des relations numériques et la résolution de problèmes arithmétiques, seront abordés ici.
Devant tant d’incertitudes, le ministère se devait de susciter une ou des publications destinées à les lever dans la mesure du possible. D’où l’ouvrage collectif intitulé : Le nombre au cycle 2 (voir le lien en fin d’article) (septembre 2010). Les inspecteurs généraux qui ont préfacé le document souhaitent : « que cet ouvrage soit largement connu et exploité par les enseignants, les équipes de circonscription, tous les formateurs. » Pour favoriser une telle exploitation, une lecture critique complète des différents textes serait nécessaire mais seul le lien entre l’automatisation des savoir-faire, la mémorisation des relations numériques et la résolution de problèmes arithmétiques, seront abordés ici.
Comme il fallait s’y attendre le « mot vedette » de cette publication est « automatisation ». Ce mot, ainsi que ceux qui lui sont apparentés tels que « automatisé » et « automatisme », sont employés 63 fois dans un texte de 90 pages alors qu’ils n’étaient utilisés que 7 fois dans les 45 pages du document d’application des programmes de cycle 2 de 2002. Ce grand nombre résulte en partie du fait que l’emploi qui en est fait est plutôt relâché : dans ce document, les procédures sont considérées comme s’automatisant, ce qui correspond à l’emploi normal de la notion d’automatisation, mais, de manière plus étonnante, les connaissances déclaratives sont également considérées comme susceptibles de s’automatiser, de même que la reconnaissance de l’opération arithmétique permettant de résoudre un problème. Ces deux derniers emplois du mot « automatisation » ne correspondent pas à son usage scientifique et ils n’aident guère à comprendre les phénomènes qui nous intéressent ici.
Les procédures s’automatisent, les connaissances déclaratives se consolident…
 Comme cela a été souligné dans l’introduction de ce texte, il s’agit d’un domaine de recherche où, en France, les travaux de référence sont ceux de Jean-Paul Fischer (1992). Ce qui suit s’en inspire donc grandement. Rappelons d’abord ce qu’est l’automatisation d’une procédure en prenant comme exemple la conduite automobile. Souvent, un conducteur débutant ne supporte aucune distraction, il ne supporte même pas qu’on lui parle quand il est au volant ; en revanche, cette activité de parole devient ordinaire lorsque la conduite est plus automatisée. Lorsqu’une procédure s’automatise, son exécution devient de plus en plus autonome au sens où elle nécessite de moins en moins de ressources cognitives, laissant ainsi la possibilité de faire autre chose en même temps. Avec l’exercice, donc, les procédures s’automatisent. Peut-on parler d’une automatisation des connaissances déclaratives qui serait consécutive à leur emploi ? Non, parce que les connaissances déclaratives, lorsqu’on les utilise, ne se transforment pas aussi profondément que les connaissances procédurales. En revanche, J.P. Fischer considère qu’elles se consolident : on se remémore plus facilement un fait que l’on a fréquemment évoqué, par exemple.
Comme cela a été souligné dans l’introduction de ce texte, il s’agit d’un domaine de recherche où, en France, les travaux de référence sont ceux de Jean-Paul Fischer (1992). Ce qui suit s’en inspire donc grandement. Rappelons d’abord ce qu’est l’automatisation d’une procédure en prenant comme exemple la conduite automobile. Souvent, un conducteur débutant ne supporte aucune distraction, il ne supporte même pas qu’on lui parle quand il est au volant ; en revanche, cette activité de parole devient ordinaire lorsque la conduite est plus automatisée. Lorsqu’une procédure s’automatise, son exécution devient de plus en plus autonome au sens où elle nécessite de moins en moins de ressources cognitives, laissant ainsi la possibilité de faire autre chose en même temps. Avec l’exercice, donc, les procédures s’automatisent. Peut-on parler d’une automatisation des connaissances déclaratives qui serait consécutive à leur emploi ? Non, parce que les connaissances déclaratives, lorsqu’on les utilise, ne se transforment pas aussi profondément que les connaissances procédurales. En revanche, J.P. Fischer considère qu’elles se consolident : on se remémore plus facilement un fait que l’on a fréquemment évoqué, par exemple.
Le sous-titre précédent : « Les procédures s’automatisent, les connaissances déclaratives se consolident… » se termine par des points de suspension parce que deux autres processus fondamentaux mériteraient d’y figurer, des processus qui explicitent la façon dont les connaissances déclaratives et procédurales se coordonnent :
* L’inclusion de connaissances déclaratives dans une procédure : à partir de la connaissance déclarative de la décomposition « sept, c’est cinq plus deux », par exemple, il est possible de calculer 5 + 7 sous la forme 5 + 5 + 2 = 10 + 2. Lorsqu’on utilise cette stratégie, la décomposition de 7 (connaissance déclarative) est incluse dans la procédure d’ajout. Nous allons voir que ce processus joue un rôle fondamental dans le progrès.
* La formation de connaissances déclaratives : cela peut surprendre mais l’accès à une connaissance déclarative telle que « sept, c’est cinq plus deux » est un processus psychologique extrêmement difficile à étudier. Il suffit d’avoir vu des enfants de maternelle qui savent précocement réciter que « un et un, deux ; deux et deux, quatre ; quatre et quatre, huit » alors qu’ils ne comprennent pas les nombres quatre et huit, pour prendre conscience qu’un apprentissage purement « par cœur » ne conduit pas nécessairement à une connaissance déclarative. Ce qui est énoncé verbalement doit en effet être interprétable en termes d’actions : si je réunis une collection de 4 objets à une autre collection de 4 objets et si je dénombre le tout, je trouve le même résultat que si j’avais dénombré d’emblée une collection de 8 objets. En mathématiques, les connaissances déclaratives gardent donc partie liée avec les connaissances procédurales. Avançons une définition des connaissances déclaratives : elles sont l’expression verbale et condensée du fait que des procédures différentes conduisent au même résultat. « 4 fois 8, 32 », par exemple, signifie que si je réunis 4 collections de 8 unités et si je dénombre le tout ainsi formé, j’obtiens le même résultat que si je forme différemment une collection de 32 unités (en comptant 1 à 1, par exemple).
Éviter un usage relâché du mot « automatisation » : l’exemple du surcomptage
Pourquoi faut-il éviter un usage relâché du mot « automatisation » ? La réponse est simple : cela a pour effet de masquer le rôle ambivalent de l’automatisation, c’est-à-dire de l’exercice. En fait, tout dépend de ce que l’on exerce. Prenons l’exemple du surcomptage. Pour déterminer 5 + 7, par exemple, certains pédagogues enseignent qu’on peut procéder de la manière suivante : on « positionne » le surcomptage en disant le premier nombre, 5, puis 6 (1 doigt est levé), 7 (un 2e doigt est levé), 8 (un 3e doigt est levé)… 12 (un 7e doigt est levé). Comme l’enfant voit qu’il a levé 7 doigts, il s’arrête et fournit comme réponse le dernier mot prononcé : 12. Il est évidemment plus économique de commencer le surcomptage à 7 avant de lever 5 doigts mais, même quand un enfant s’y prend ainsi, cela ne le conduit pas à former la connaissance déclarative : « sept plus cinq, douze ».
En effet, quand un enfant détermine 7 + 5 en disant : 7, 8(1), 9 (2), 10 (3), 11 (4), 12 (5), il prononce un grand nombre de mots entre l’énoncé du problème, 7 + 5, et sa solution : 12. Les mots huit, neuf, dix, onze qu’il prononce, ont pour effet que quand l’enfant accède à la solution, 12, les données du problème, 7 et 5, ne sont plus présentes en mémoire immédiate et le phénomène de formation de l’unité déclarative « sept plus cinq, douze » ne peut pas se produire. Un enfant peut exercer le surcomptage, l’automatiser tant que faire se peut, s’il ne dispose pas d’autre moyen d’obtenir le résultat, cela ne le conduira pas à la formation d’une connaissance déclarative, c’est-à-dire à la mémorisation. L’une des principales preuves empiriques de ce phénomène est le fait, bien établi, que les enfants en difficulté grave et durable dans leurs apprentissages numériques restent longtemps prisonniers de l’usage du surcomptage et ne mémorisent donc pas les résultats d’additions élémentaires. C’est d’ailleurs un cas extrêmement fréquent chez les élèves de SEGPA. L’école française, avant 1990, avait banni l’enseignement du comptage et, donc, du surcomptage, de l’ensemble des pratiques pédagogiques considérées comme acceptables dans une classe ; l’école d’aujourd’hui se doit d’en faire un usage prudent.
Un grand nombre de résultats (pour une revue, voir Brissiaud, 1989, 2004) conduisent à penser que la mémorisation des résultats d’additions élémentaires est favorisé lorsque les enfants utilisent des stratégies de « décomposition-recomposition » telles que : 5 + 7 = 5 + 5 + 2 = 10 + 2 (un autre exemple en est le « passage de la dizaine : 9 + 7 = 9 + 1 + 6 = 10 + 6).
* Cela s’explique premièrement du fait que l’inclusion de connaissances déclaratives (ici : « sept, c’est cinq plus deux ») au sein d’une procédure, conduit à ce que les données de l’énoncé et le résultat soient mis en relation beaucoup plus directement que dans le cas du surcomptage : 5 + 7 c’est 5 + 5, 10 ; et encore 2, 12. Cette procédure est suffisamment brève pour que le phénomène de formation d’une unité déclarative : « cinq plus sept, douze » ait lieu.
* Cela s’explique deuxièmement du fait que l’usage d’une connaissance déclarative telle que « sept, c’est cinq plus deux », consolide celle-ci.
Au final, l’intérêt de la théorie de J. P. Fischer est de montrer que l’usage de stratégies de décomposition-recomposition fait entrer dans un cercle vertueux : à partir de premières connaissances déclaratives, l’enfant les consolide en les utilisant ; dans le même temps, il en forme de nouvelles qu’il pourra ultérieurement inclure dans d’autres stratégies de décomposition-recomposition, etc.
L’analyse précédente est fondamentale parce qu’elle conduit à se méfier d’un enseignement systématique du surcomptage à l’école et, surtout, de son exercice dans un but d’automatisation. Pourtant, ce serait assurément le meilleur moyen pour qu’à court terme, les élèves sachent donner les résultats des additions élémentaires. Il est en effet beaucoup plus facile d’enseigner le surcomptage que l’usage de stratégies de décomposition-recomposition. Les professeurs de CP et de CE1 sont ainsi devant ce dilemme : à court terme, si l’on s’intéresse seulement à l’obtention du résultat, mieux vaut enseigner et faire automatiser le surcomptage ; à long terme ce choix pédagogique fait vraisemblablement le lit de la difficulté grave et durable en calcul. Soyons encore plus précis : à court terme, si l’on s’intéresse seulement aux résultats des élèves lors de l’évaluation terminale de CE1, mieux vaut enseigner et faire automatiser le surcomptage ; à long terme… Ce dilemme de l’automatisation, c’est-à-dire le rôle ambivalent de l’automatisation de la procédure qui est la plus facile à automatiser, mérite assurément d’être présenté aux professeurs d’écoles comme cela vient d’être fait.
Éviter un usage relâché du mot « automatisation » : l’exemple de l’addition en colonnes
Les auteurs d’un chapitre intitulé « Dialectique entre sens et technique : l’exemple du calcul mental » soulignent qu’en fin de cycle 2, la moitié environ des élèves qu’ils ont observés ne savent pas calculer mentalement 45 + 16 autrement qu’en « posant l’addition dans leur tête ». Cette stratégie est évidemment très peu efficiente : elle a un coût en mémoire extrêmement important lorsque les nombres de l’addition ne sont pas donnés par écrit et l’échec est important. Des stratégies alternatives consistent soit à calculer 45 + 16 = 45 + 10 + 6 = 55 + 6 = 61, stratégie qu’on peut appeler addition naturelle parce que c’est celle qui est utilisée par les peuples sans écriture (Brissiaud, 1989, 2004), soit 45 + 16 = 40 + 10 + 5 + 6 = 50 + 11, soit encore 45 + 16 = 45 + 20 – 4, etc. Le fait qu’une moitié des élèves soient, à l’entrée au CE2, enfermés dans la simulation mentale d’une addition en colonnes, c’est-à-dire dans l’exécution d’un calcul dont la logique est celle de l’écrit, n’est pas bon signe pour l’enseignement des nombres à l’école en France. Surtout lorsque l’on sait que les performances en calcul mental à ce moment de la scolarité, permettent la meilleure prédiction concernant ce que seront, globalement, les performances en mathématiques en 6e (Suchaud, 2007).
La théorie de J. P. Fischer rend parfaitement compte des conditions du progrès : toutes les stratégies alternatives (addition naturelle, etc.) exigent en effet de connaître une décomposition déclarative du nombre 16 et de l’inclure dans la procédure d’ajout. L’élève qui n’a pas facilement accès au fait que « seize, c’est dix et encore six » ou « seize, c’est vingt moins quatre », n’accède pas au calcul mental de 45 + 16. L’absence de connaissances déclaratives conduit donc un élève à ne disposer que d’une seule stratégie : la simulation mentale de la technique en colonnes.
Fondamentalement, les auteurs de ce chapitre du document « Le nombre au cycle 2 », font la même analyse des faibles performances en calcul mental à l’entrée au CE2. Cependant, ils ont un usage relâché du mot automatisation qui obscurcit considérablement leur propos. Ainsi, plutôt que de considérer les décompositions comme étant des connaissances déclaratives susceptibles de se consolider, ils parlent de l’« automatisation des décompositions », ce qui les conduit à écrire : « La connaissance et la maîtrise d’un nombre insuffisant de procédures automatisées (ils veulent dire : d’un nombre insuffisant de décompositions) peuvent donc conduire l’élève à adopter, en calcul, un comportement automatisé (les auteurs veulent dire : à faire un usage systématique d’une addition posée dans la tête) ». Cette phrase, en l’absence des parenthèses qui permettent de la comprendre, est paradoxale (le lecteur est invité à la relire en sautant les parenthèses). Ce paradoxe apparent sert même de sous-titre au texte : il y aurait un « paradoxe de l’automatisme ». Peut-on se permettre de le dire : l’analyse théorique de l’inclusion de la connaissance déclarative : « seize, c’est dix et encore six » dans le calcul de 45 + 16, ne conduit pas plus à un paradoxe que celle de l’inclusion de la connaissance déclarative : « sept, c’est cinq et encore deux » dans le calcul de 5 + 7. C’est seulement la confusion des mots qui laisse penser à l’existence d’un paradoxe.
En revanche, il est important de poursuivre le parallèle entre ces deux exemples et il se peut qu’en fait, les auteurs aient voulu parler du « dilemme pédagogique de l’automatisation ». En effet, de même qu’une pédagogie qui met l’accent sur l’exercice du surcomptage au détriment de l’usage de stratégies de décomposition-recomposition, risque d’enfermer les élèves dans l’usage du seul surcomptage, une pédagogie qui met l’accent sur le calcul en colonnes des additions risque d’enfermer les élèves dans l’usage systématique de cette stratégie en calcul mental. On peut même aller plus loin et regretter qu’en France, si peu de pédagogues fassent le choix qui est celui de la plupart des états fédéraux allemands, de la Grande Bretagne et de bien d’autres pays encore : l’enseignement de l’addition en colonnes y est repoussé au CE1, laissant ainsi le temps de travailler de manière systématique l’addition mentale de deux nombres de deux chiffres à l’aide d’une stratégie de décomposition-recomposition. Comme on n’a jamais vu un élève s’enfermer dans le calcul d’une addition à l’aide des stratégies qui conduisent à un calcul mental performant, c’est un choix pédagogique responsable que d’aménager une plage de temps où ces stratégies sont les seules que l’enfant ait à sa disposition. À condition, bien entendu, que cet enseignement du calcul mental de deux nombres à deux chiffres soit tout aussi systématique que celui de l’addition en colonnes dans la pédagogie traditionnelle, afin de ne pas retarder la mémorisation des faits numériques élémentaires.
Une « automatisation » impossible à atteindre
Toujours dans le même ouvrage, les auteurs du chapitre sur la résolution des problèmes additifs et soustractifs se fixent comme objectif, dès le cycle 2, d’ « automatiser l’utilisation de la soustraction pour la résolution d’un problème où l’on recherche l’état initial connaissant la transformation positive et l’état final » (p. 60).
Un exemple d’un tel problème est : « La mariée a ajouté 24 fleurs à son bouquet. Le bouquet en compte maintenant 182. Combien y avait-il de fleurs avant ? ». Soyons clair et allons d’emblée à la conclusion qui sera la nôtre : la reconnaissance immédiate de ce type de problèmes en tant que problème de soustraction, ce que les auteurs appellent l’ « automatisation de l’utilisation de la soustraction » pour résoudre ce type de problème, est impossible pour la quasi-totalité des enfants en fin de cycle 2. De plus, vouloir l’atteindre comme cela est recommandé dans ce chapitre, conduit le plus souvent à des pratiques pédagogiques qui créent de l’échec scolaire sur le long terme. Dans ce cas, on n’est donc pas face à un « dilemme de l’automatisation » au sens où, comme dans le cas du surcomptage et de l’addition en colonnes, l’exercice d’une procédure pourrait avoir un effet bénéfique mais où il conviendrait d’être prudent parce que cet exercice risque de faire obstacle à l’élaboration et à l’exercice d’autres stratégies qui, sur le long terme, conduisent plus sûrement au progrès. On est dans une situation où viser l’automatisation est tout simplement irréaliste et doit presque sûrement être évité.
Signalons d’abord que les psychologues ne parleraient pas d’automatisation dans ce cas, mais plutôt de « reconnaissance déclarative de l’opération arithmétique ». En effet, lorsque les chercheurs ont tenté de modéliser le fait qu’un « expert », face à l’énoncé précédent, sait d’emblée qu’il s’agit d’un problème de soustraction, ils ont fait l’hypothèse que cet « expert » dispose d’une connaissance déclarative qu’ils ont appelée un « schéma de problèmes ». L’usage de cette connaissance déclarative, dans le même temps que la personne comprend l’énoncé, lui permet de le reconnaître comme appartenant à la catégorie des problèmes de soustraction. Mais peu importe, dans ce cas, qu’on parle d’automatisation ou de reconnaissance déclarative de l’opération car quel que soit le mode d’expression adopté, l’idée véhiculée est la même, à savoir que le processus de reconnaissance de l’opération arithmétique est tellement imbriqué dans le processus de compréhension de l’énoncé que l’un ne va pas sans l’autre ou, pour le dire autrement : dès qu’un enfant comprend l’énoncé du problème, il sait qu’il s’agit d’un problème de soustraction.
Or, considérons ces deux problèmes qui sont du même type (Brissiaud & Sander, 2010) :
Problème 1 : « Pour son anniversaire, Leila reçoit 3 € qu’elle met dans sa tirelire. Maintenant, elle a 41 € dans sa tirelire. Combien d’euros avait-elle avant son anniversaire ? »
Problème 2 : « Pour son anniversaire, Leila reçoit 38 € qu’elle met dans sa tirelire. Maintenant, elle a 41 € dans sa tirelire. Combien d’euros avait-elle avant son anniversaire ? »
À l’entrée au CE2, le problème 1 est mieux résolu que le problème 2 (50% de réussite environ contre 30% environ). Lorsqu’on s’intéresse aux élèves qui réussissent, 80% utilisent la soustraction pour résoudre le problème 1. En revanche, ils ne sont que 11% à l’utiliser pour résoudre le problème 2. Presque tous les élèves qui réussissent le problème 2, écrivent : 38 + 3 = 41, c’est-à-dire une égalité où le résultat (le nombre 3) n’est pas à droite du signe « = » comme ce serait le cas avec l’égalité 41 – 38 = 3. Or, leurs résolutions d’autres problèmes de soustraction montrent une préférence affirmée pour une égalité où le résultat est à droite du signe « = ». Cette préférence ne suffit donc pas : pour résoudre le problème 2, à l’entrée du CE2, les élèves n’utilisent pas la soustraction. Le fait que les élèves qui réussissent n’utilisent pas la même stratégie pour l’un et l’autre problème n’est pas compatible avec un usage de la soustraction qui serait « automatisé ».
Et ce résultat n’est pas isolé : de manière générale, les chercheurs qui utilisaient la notion de schéma de problèmes, celle qui correspond à une reconnaissance directe de l’opération arithmétique, ne l’utilisent plus qu’exceptionnellement aujourd’hui, préférant distinguer, y compris chez l’adulte, une phase de compréhension de l’énoncé et une phase de raisonnement qui ne s’automatisent pas (on peut, par exemple, comparer Devidal, Fayol & Barrouillet, 1997 et Thevenot, Devidal, Barrouillet & Fayol, 2007). En fait, il n’y a vraisemblablement que les problèmes les plus standards et qui sont énoncés sous la forme la plus classique possible, dont la résolution se fasse à terme par reconnaissance directe de l’opération arithmétique. Ce n’est vraisemblablement jamais le cas pour la plupart des problèmes de division, par exemple (la deuxième partie de ce texte, qui paraîtra ultérieurement, éclairera ce point).
Une « automatisation » dangereuse à viser
 Quelle est la pratique pédagogique recommandée par les auteurs du chapitre consacré aux problèmes d’addition et de soustraction, celle qui est censée permettre aux élèves de progresser vers la reconnaissance directe de l’opération arithmétique ? Elle consiste, face à un énoncé de problème, à faire adopter aux élèves un questionnement de type métacognitif. Ils doivent en effet comprendre l’énoncé et le réinterpréter dans les termes d’une « grille de compréhension » : s’agit-il d’un « problème avec une action » ? ou d’un « problème sans action ? » Connaît-on la quantité avant l’action ? Et celle après l’action ? etc. Cette pratique pédagogique a fait l’objet de peu de recherches au cycle 2 (quand elle est adoptée, c’est le plus souvent dans de plus grandes classes). Il existe quand même une recherche menée à ce niveau de la scolarité : celle de Willis & Fuson (1988). Or, lorsqu’on analyse les résultats qu’ils observent (Brissiaud, 1995), on s’aperçoit qu’après ce type d’intervention pédagogique, certains problèmes sont moins bien réussis que ce qui est habituellement observé. Remarquons de plus que ces chercheurs se sont cantonnés à des problèmes d’addition et de soustraction et qu’ils ne les ont proposés qu’à des élèves qualifiés de « bons » et « moyens ». Il est certain que s’ils avaient mélangé ces problèmes à d’autres de multiplication ou de division et s’ils les avaient proposés à des élèves faibles, le phénomène de « dérapage pédagogique » observé aurait eu des conséquences néfastes encore plus importantes.
Quelle est la pratique pédagogique recommandée par les auteurs du chapitre consacré aux problèmes d’addition et de soustraction, celle qui est censée permettre aux élèves de progresser vers la reconnaissance directe de l’opération arithmétique ? Elle consiste, face à un énoncé de problème, à faire adopter aux élèves un questionnement de type métacognitif. Ils doivent en effet comprendre l’énoncé et le réinterpréter dans les termes d’une « grille de compréhension » : s’agit-il d’un « problème avec une action » ? ou d’un « problème sans action ? » Connaît-on la quantité avant l’action ? Et celle après l’action ? etc. Cette pratique pédagogique a fait l’objet de peu de recherches au cycle 2 (quand elle est adoptée, c’est le plus souvent dans de plus grandes classes). Il existe quand même une recherche menée à ce niveau de la scolarité : celle de Willis & Fuson (1988). Or, lorsqu’on analyse les résultats qu’ils observent (Brissiaud, 1995), on s’aperçoit qu’après ce type d’intervention pédagogique, certains problèmes sont moins bien réussis que ce qui est habituellement observé. Remarquons de plus que ces chercheurs se sont cantonnés à des problèmes d’addition et de soustraction et qu’ils ne les ont proposés qu’à des élèves qualifiés de « bons » et « moyens ». Il est certain que s’ils avaient mélangé ces problèmes à d’autres de multiplication ou de division et s’ils les avaient proposés à des élèves faibles, le phénomène de « dérapage pédagogique » observé aurait eu des conséquences néfastes encore plus importantes.
On remarquera d’ailleurs que les auteurs du chapitre suivant, celui qui est consacré à la résolution des problèmes de multiplication et de division, évoquent ce phénomène de dérapage pédagogique (p. 70) : « On constate que l’élève associe souvent la résolution du problème au calcul d’une opération dans une démarche techniciste : il prend systématiquement les nombres présents dans l’énoncé et les soumet à l’opération qu’il maîtrise le mieux (addition). Le contrat pédagogique est alors à (re)poser. » Un tel phénomène trouve très clairement son origine dans le fait qu’on ne laisse pas suffisamment les élèves se représenter les situations décrites dans les énoncés avec les outils cognitifs qui sont les leurs. Au cycle 2, obliger les élèves à réinterpréter un énoncé de problème dans les termes d’une grille de compréhension, conduit les plus faibles d’entre eux à ne plus chercher à comprendre les énoncés et à sélectionner une opération arithmétique à partir d’indices contextuels (l’élève choisit la dernière opération étudiée, il devine l’opération à partir de la taille des nombres, etc.) C’est ce que prouvent les résultats de Willis & Fuson et c’est ce qu’observent couramment les professeurs d’écoles qui ont une certaine expérience.
Bref, pour résoudre un problème, les élèves doivent d’abord comprendre la situation qui est décrite dans l’énoncé. La plupart du temps, cela ne suffit pas : il leur faut de plus arithmétiser cette situation (Brissiaud, 2002 ; Brissiaud & Sander, 2010). Vouloir qu’en fin de cycle 2 les élèves reconnaissent d’emblée l’opération arithmétique pour tel ou tel type de problème arithmétique, alors les meilleurs élèves réussissent en utilisant une autre stratégie, ne peut conduire qu’à une extension du dérapage pédagogique qui vient d’être décrit.
Comme il est gênant d’être seulement critique, esquissons ce qu’est une pratique pédagogique alternative, dont on peut regretter qu’elle ne soit pas évoquée dans l’ouvrage. Elle s’articule autour de deux types de séquences en classe :
* Des leçons dont l’objectif est que les élèves s’approprient le sens de la soustraction, en exerçant la résolution de problèmes de comparaison, de recherche du résultat d’un retrait et de recherche d’un complément. Ainsi, on enseigne seulement l’usage de 3 des lames du « couteau suisse » alors que les auteurs de l’ouvrage recommandent que cet enseignement les concernent toutes (7 en tout). Par ailleurs, les schémas concernant la comparaison qui figurent au début de ce texte, montrent qu’il est assez facile d’interpréter les situations de comparaison en termes de recherche du résultat d’un retrait et de recherche d’un complément (voir aussi : Richard & Sander, 2003 ; Brissiaud, 2009). C’est pourquoi, à ce niveau de la scolarité, il est stratégique de mettre l’accent sur ces problèmes de comparaison.
* Des séquences qu’on peut appeler « Ateliers de Résolution de Problèmes » où une grande variété de problèmes est proposée. Y prennent place des problèmes de partition et de quotition, par exemple, mais aussi ceux où, comme dans le problème de la mariée, l’on cherche la valeur d’un état initial. Cependant, dans ces séquences, le contrat pédagogique est bien différent : on y insiste seulement sur la compréhension des énoncés et les élèves sont invités à comprendre les situations à l’aide des outils cognitifs qui sont les leurs. Si certains élèves utilisent la « bonne opération arithmétique » pour les résoudre, tant mieux ; cependant, à ce niveau de la scolarité, aucune pratique pédagogique volontariste ne vise une généralisation de ce comportement.
Le dilemme de la symbolisation des opérations
Avant de commenter le chapitre concernant la résolution des problèmes de multiplication et de division, il est intéressant de souligner combien les idées avancées par Michel Fayol dans un chapitre qui sert d’introduction à l’ouvrage, sont proches de celles qui sont exposées ici. Nous avons vu au début de ce texte que « l’addition arithmétique n’est pas un simple ajout, la soustraction arithmétique n’est pas un simple retrait, la multiplication arithmétique n’est pas une simple répétition à l’identique et la division n’est pas un simple partage ». Le même propos est tenu par Michel Fayol : « Le fait que les enfants perçoivent et comprennent très précocement et facilement les effets des transformations affectant la quantité (ajout, retrait, partage…) laisse souvent penser à tort qu’ils maîtrisent ou au moins comprennent les opérations (addition, soustraction, multiplication, division…). Cette surestimation des capacités des enfants est d’autant plus vraie lorsque les dites opérations ne font que simuler le déroulement des transformations : si Paul a 3 billes et que je lui en donne 4, le fait de transcrire 3 + 4 = 7 n’assure en rien que l’addition est acquise ! ». Un peu plus loin, il écrit : « (des) chercheurs ont relevé que les enfants les plus faibles tendent à ce limiter à cette conception stéréotypée des opérations, sans que nous soyons en mesure de faire la part de ce qui tient aux difficultés propres à ces élèves et aux modalités d’intervention pédagogique. »
Michel Fayol utilise donc l’opposition entre « transformations » et « opérations » pour exprimer celle que nous avons avancée entre conception naïve et compréhension des opérations. Reformulé avec les mots qui ont été les nôtres, il dit que les élèves les plus faibles s’enferment dans une conception naïve, stéréotypée des opérations arithmétiques et qu’il est probable que les pratiques pédagogiques soient l’un des facteurs explicatifs d’un tel phénomène. Or, il est très facile d’expliciter une pratique pédagogique pouvant être mise en cause : quand on est bien conscient du fait que les opérations ne sont pas seulement des transformations, convient-il d’appeler multiplication et de noter avec le symbole « x », une simple transformation : la répétition à l’identique ? Et convient-il d’appeler division et de noter avec le symbole « ÷ », une simple transformation : le partage ? Ou bien faut-il, dans un cas comme dans l’autre, ne parler de multiplication et de division qu’à partir du moment où l’on a commencé à enseigner les propriétés conceptuelles de ces opérations, celles qui instaurent la rupture entre transformations et opérations ?
D’où le dilemme pédagogique de la symbolisation des opérations, largement présenté dans Brissiaud (2006) :
* Comme les enfants comprennent précocement les transformations, si l’on choisit à l’école de s’exprimer de manière relâchée, il est facile de faire croire aux enfants ainsi qu’à leurs parents qu’ils y étudient précocement la multiplication et la division alors qu’ils ne font qu’étudier les transformations correspondantes (répétition à l’identique et partage). Comme l’époque est plutôt à considérer qu’il faudrait solliciter les enfants plus précocement, ce choix pédagogique présente l’avantage de laisser croire que c’est le cas. C’est donc pour les enseignants une façon d’obtenir à bon compte une certaine « paix scolaire ».
* On peut aussi considérer qu’il convient à l’école de mettre d’emblée les « bons mots » sur « les bonnes idées » et, donc, de retarder de quelques mois l’introduction du signe « x » et de quelques mois celle du signe « ÷ » (comme la partie principale des programmes l’y autorise), jusqu’au moment où l’on peut enseigner les propriétés conceptuelles des opérations. Sur le long terme, il est très raisonnable de penser que ce retard apparent s’avérera en fait une avance, surtout pour les élèves les plus faibles qui risquent de ne jamais accéder aux propriétés conceptuelles des opérations.
*
Comment ce dilemme est-il traité dans le chapitre consacré à la résolution des problèmes de multiplication et de division ? Il est tout simplement passé sous silence. Cela est considéré comme une évidence qu’il faudrait introduire le mot « multiplication » et le signe « x » dès le CP et qu’il conviendrait d’introduire le mot « division » et le signe « ÷ » dès le CE1. À aucun moment il n’y a une tentative d’explication de la façon dont on pourrait enseigner la commutativité de la multiplication au CP : le mot n’est même pas écrit dans le chapitre. Aucun développement pédagogique non plus quant à la façon dont on pourrait expliquer à des enfants de CE1 que les problèmes de partition et de quotition, au-delà de leur apparence très différente, peuvent être résolus à l’aide de la même opération arithmétique. Le dilemme de la symbolisation est donc non seulement passé sous silence, mais il est tranché dans un sens, celui du retour aux choix faits avant 1970, sans qu’à aucun moment une tentative d’explication de ce choix ne soit faite. Ce choix semble fait parce que ce serait celui des programmes, ce qui ne correspond pas à la réalité.
Les dilemmes de l’automatisation des procédures et de la symbolisation des opérations
L’origine de ces dilemmes : quelle articulation entre connaissances quotidiennes et scolaires ?
 Remarquons d’abord que ces deux dilemmes s’énoncent de manières proches :
Remarquons d’abord que ces deux dilemmes s’énoncent de manières proches :
* Le dilemme de l’automatisation des procédures : lorsqu’on s’intéresse aux principales tâches arithmétiques à l’école (dénombrement, addition de 2 nombres à 1 chiffres, de 2 nombres à 2 chiffres, etc.), la procédure qu’il serait le plus simple et le plus facile d’exercer (le comptage, le surcomptage, l’addition en colonnes, etc.) fait un usage extrêmement limité des connaissances déclaratives et ce n’est pas celle qui, à terme, conduit à un bon équilibre entre connaissances procédurales et connaissances déclaratives. L’automatisation de cette procédure, mais de cette procédure seulement, est d’ailleurs couramment observée chez les élèves en difficulté grave et durable. Faut-il exercer précocement cette procédure ou bien mettre l’accent sur d’autres procédures qui, parce qu’elles incluent des connaissances déclaratives, conduisent à un meilleur équilibre ?
* Le dilemme de la symbolisation des opérations arithmétiques : le sens des opérations qu’il serait le plus simple et le plus facile d’associer aux noms et aux symboles des opérations (additionner c’est ajouter, soustraire c’est retirer, multiplier c’est répéter à l’identique, partager c’est diviser) reste limité au sens porté par le langage quotidien. L’acquisition de ce sens, mais de ce sens seulement, est d’ailleurs couramment observée chez les élèves en difficulté grave et durable. Faut-il précocement associer le nom et les symboles des opérations à ce sens ou bien différer légèrement l’usage de ces symboles afin de mettre d’emblée l’accent sur les autres sens, ceux qui risquent de faire défaut ?
*
Cette proximité de formulations n’est évidemment pas le fait du hasard : les deux dilemmes ont des raisons profondes communes. Ils renvoient l’un et l’autre à la manière dont il convient de gérer à l’école l’articulation entre ce que Vygotski (1934/1997) appelait les concepts quotidiens et les concepts scolaires. Comme Vygotski, les chercheurs sont nombreux à mettre en garde les pédagogues contre le choix consistant à rabattre le savoir scolaire sur le savoir quotidien et à plaider pour une certaine rupture entre les deux : programmer la réussite, ce n’est pas seulement s’adapter à ce que les élèves savent déjà faire, c’est d’emblée créer les conditions favorisant l’acquisition de ce qu’ils ne savent pas encore faire (cf. la notion de zone de développement prochain).
Des dilemmes qui expliquent les « mouvements de balanciers » des programmes
On perçoit mieux le caractère fondamental de ces dilemmes lorsqu’on sait qu’ils structurent l’histoire des programmes scolaires. Ainsi, concernant le comptage, l’école de la 3e République considérait l’enseignement de cette procédure comme un apprentissage premier incontournable à l’école : il s’agissait d’y apprendre à « Lire, écrire, compter ». Comme, de manière répétée, les maîtres ont constaté que les enfants en difficulté grave et durable s’enferment dans l’usage de procédures de comptage, son enseignement a été tout simplement banni de l’école maternelle et élémentaire pendant plusieurs dizaines d’années, entre 1950 et 1990. Les moyens pédagogiques utilisés pour favoriser ce bannissement ont varié durant cette période. Entre 1950 et 1970, c’est en introduisant les nombres l’un après l’autre que les maîtres pouvaient se dispenser d’enseigner le comptage. Après 1970 (« période piagétienne »), c’est en préconisant des activités « pré-numériques » (classement, rangement) que le même résultat a été obtenu. Avant qu’un nouveau « coup de balancier », en 1990, réhabilite l’enseignement du comptage et que les programmes en viennent à viser que les enfants de grande section d’école maternelle sachent compter et écrire les nombres jusqu’à 30 (voir Brissiaud, 2007).
Concernant la symbolisation des opérations arithmétiques, on observe le même mouvement de balancier : les 4 signes opératoires étaient introduits dès le CP jusqu’en 1970 avant qu’à cette date, il n’y en ait plus qu’un, le signe « + » qui soit enseigné à ce niveau de la scolarité. Le balancier est alors parti très loin dans l’autre sens, induisant la réaction de 2008.
De façon générale, l’école française a beaucoup de mal à gérer les dilemmes de l’automatisation des procédures et de la symbolisation des opérations arithmétiques, parce qu’elle idéologise le débat plutôt que de le gérer de manière expérimentale.
Des dilemmes qui peuvent être gérés expérimentalement dans le cadre des programmes 2008
Il faut insister là-dessus : si l’on considère que les progressions fournies par niveau de classe sont de simples repères destinés à aider les maîtres lorsque ces repères entrent dans la perspective de leurs options d’enseignement, les programmes de 2008, tels qu’ils sont, autorisent les maîtres à n’introduire le mot « multiplication » et le signe « x » qu’au CE1, ils les autorisent à n’introduire le mot « division » et les symboles qui vont avec qu’au CE2 (sinon, on ne comprend pas pourquoi la division est, dans les programmes, traitée différemment des autres opérations). Ils autorisent donc les équipes de cycles, dans leur ensemble, à avoir un rapport expérimental à la question pédagogique posée par le dilemme de la symbolisation des opérations arithmétiques : certaines peuvent choisir de revenir à la situation d’avant 1970 en introduisant les signes arithmétiques le plus rapidement possible quand d’autres font le choix de retarder de quelques mois cette introduction pour la faire coïncider avec l’enseignement des propriétés conceptuelles des opérations. Il est d’ailleurs raisonnable de penser qu’on observerait parfois certaines équipes de cycle qui, déçues par les résultats de l’option qui a été la leur, en changent pour adopter l’autre.
Les programmes tels qu’ils sont autorisent de même un rapport expérimental à la gestion pédagogique du dilemme de l’automatisation des procédures. Prenons un exemple extrême : rien ne pourrait être reproché à un maître qui choisirait de différer l’enseignement de l’addition en colonnes au début du CE1 pour privilégier, durant tout le CP, l’usage de procédures qui, comme l’addition naturelle, conduisent à un calcul mental efficace. Il faut évidemment que ce choix soit celui de l’équipe de cycle, qu’il soit expliqué aux parents et qu’en fin de cycle les élèves sachent faire une addition en colonnes ! Les programmes étant définis par cycles, leur contenu à ce moment de la scolarité constituent en effet le contrat professionnel qui lie les maîtres et l’institution. Aucun enseignant ne peut s’y soustraire.
On peut même imaginer que ce rapport expérimental à la gestion des deux dilemmes, ne se situe pas seulement au niveau individuel mais qu’il concerne une large population de maîtres volontaires, avec traitement statistique à la clef, afin de vérifier les hypothèses suivantes :
* Est-il vrai que mettre initialement l’accent sur des procédures qui incluent des connaissances déclaratives, permet un développement des compétences numériques plus harmonieux ? Est-ce un moyen de lutter contre l’échec scolaire ?
* Est-il vrai qu’en évitant d’utiliser les symboles d’opérations à un moment où les élèves confondent les opérations et les transformations (en s’exprimant comme Michel Fayol), on évite aux élèves fragiles l’enfermement dans la conception naïve des opérations ?
Une note de synthèse de l’inspection générale particulièrement inquiétante
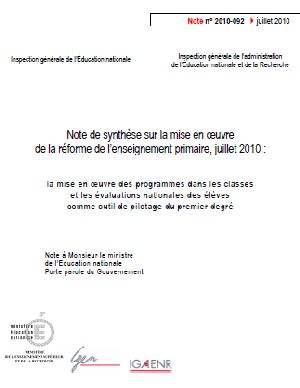 Nous venons de voir que les dilemmes de l’automatisation des procédures et de la symbolisation des opérations peuvent très bien se gérer dans un sens ou dans l’autre dans le cadre des programmes 2008, à condition, bien sûr, que les repères donnés dans les programmes pour gérer la progressivité des apprentissages restent ce qu’ils sont : de simples repères qui sont susceptibles d’aider les professeurs d’écoles mais qu’ils ne doivent pas hésiter à modifier s’ils ne leur permettent pas de rester dans la perspective de leurs options d’enseignement. Or, de ce point de vue, la note de synthèse de l’inspection générale rédigée en juillet 2010 (voir le lien en fin d’article) est particulièrement inquiétante. L’inquiétude naît de la façon dont les inspecteurs généraux s’expriment dans cette note de synthèse. Il est clair qu’une note, fût-elle rédigée par des inspecteurs généraux, ne remplace pas le contenu d’un Bulletin officiel et que la légalité, concernant les programmes scolaires, reste là où elle était. Mieux vaut cependant réagir d’emblée, de peur que cette note annonce un changement qui, lui, aurait un statut légal ou, plus vraisemblablement, que s’installe sur le mode de la coutume, l’idée que les repères n’en seraient plus.
Nous venons de voir que les dilemmes de l’automatisation des procédures et de la symbolisation des opérations peuvent très bien se gérer dans un sens ou dans l’autre dans le cadre des programmes 2008, à condition, bien sûr, que les repères donnés dans les programmes pour gérer la progressivité des apprentissages restent ce qu’ils sont : de simples repères qui sont susceptibles d’aider les professeurs d’écoles mais qu’ils ne doivent pas hésiter à modifier s’ils ne leur permettent pas de rester dans la perspective de leurs options d’enseignement. Or, de ce point de vue, la note de synthèse de l’inspection générale rédigée en juillet 2010 (voir le lien en fin d’article) est particulièrement inquiétante. L’inquiétude naît de la façon dont les inspecteurs généraux s’expriment dans cette note de synthèse. Il est clair qu’une note, fût-elle rédigée par des inspecteurs généraux, ne remplace pas le contenu d’un Bulletin officiel et que la légalité, concernant les programmes scolaires, reste là où elle était. Mieux vaut cependant réagir d’emblée, de peur que cette note annonce un changement qui, lui, aurait un statut légal ou, plus vraisemblablement, que s’installe sur le mode de la coutume, l’idée que les repères n’en seraient plus.
La fin des cycles ? Des repères qui n’en sont plus ?
Cette note, en effet, est rédigée comme si les cycles n’existaient plus à l’école élémentaire concernant le français et les mathématiques. Ainsi, p. 16, les inspecteurs généraux soulignent l’une des conséquences de l’augmentation du temps imparti à la concertation : « le dialogue entre enseignants au niveau du cycle et de l’école représente un appui diversement mobilisé mais qui s’est accentué par l’accroissement du temps dévolu à la concertation au niveau de l’école. Un tel dialogue reste essentiel du fait de l’organisation des programmes par cycle, à l’exception du français et des mathématiques ».
Pourquoi les programmes ne seraient-ils plus organisés par cycle en français et en mathématiques ? On peut craindre que ce soit parce que les repères donnés dans les programmes pour gérer la progressivité des apprentissages ne soient plus considérés comme de simples repères mais comme des progressions qui s’imposent à tous. Alors que dans le bulletin officiel où les programmes ont été publiés, la notion de « repères » concerne aussi bien le langage et l’écrit à l’école maternelle que le français et les mathématiques à l’école élémentaire, la note de synthèse est rédigée comme si cette notion de « repères » ne concernait plus que l’école maternelle.
Ainsi, p. 3, on lit que : « Deux nomenclatures complètent les programmes avec d’une part la liste des compétences attendues aux paliers 1 et 2 du socle commun, d’autre part des repères pour organiser la progressivité des apprentissages par niveau de classe pour le langage et l’écrit en maternelle ainsi que des progressions pour le français et les mathématiques pour les deux cycles de l’école élémentaire. »
Et cette façon de s’exprimer est systématique comme on s’en aperçoit un peu plus loin, dans la même page : « Les maîtres ont dans l’ensemble privilégié l’usage des repères pour organiser la progressivité des apprentissages pour le langage et l’écrit en maternelle ainsi que les progressions par cycle figurant dans les programmes pour le français et les mathématiques. » On retrouve la même formulation p. 8 : « Les repères pour organiser la progressivité des apprentissages pour le langage et en maternelle ainsi que les progressions par cycle figurant dans les programmes pour le français et les mathématiques ont constitué une base solide ». Jamais les progressions proposées en français et en mathématiques ne sont qualifiées de « repères ».
Si, comme dans l’école d’avant 1970, la définition des progressions se fait en français et en mathématiques par niveau et si ces progressions ne sont plus de simples repères, si elles s’imposent à l’ensemble des enseignants de France, il y a évidemment beaucoup moins de « grain à moudre » pour un conseil de cycle et on comprend que cette notion perde de sa nécessité. D’autant plus que l’inspection générale, en de nombreux endroits de la note, recommande l’élaboration de « repères de progression » pour toutes les disciplines. C’est le cas p. 8, par exemple : « Sans doute convient-il de faciliter la production d’outils adaptés aux nouveaux programmes en proposant des repères de progression par niveau pour l’ensemble des disciplines de l’école élémentaire. » Ne risque-t-on pas que les « repères de progression », qui sont dénommés ainsi lorsqu’ils sont en phase d’élaboration, ne deviennent des « progressions » lorsqu’il s’agira d’évaluer si les professeurs d’écoles en font usage ?
Éviter un discours professionnel illogique
Rappelons qu’au tout début de la note, les inspecteurs généraux écrivent : « Les (difficultés) tiennent moins à un manque de connaissance des programmes par les maîtres qu’à une insuffisante compréhension des enjeux et des modalités des apprentissages premiers pour eux et pour nombre de leurs formateurs ». Imaginons qu’un formateur, inspecteur ou conseiller pédagogique, observe un professeur de CP travailler la notion d’ajout répété à l’identique mais sans utiliser le mot multiplication, ni le symbole de cette opération. Ou encore : imaginons que ce formateur observe un professeur de CE1 travailler avec ses élèves la partition et la quotition, mais sans utiliser le mot division, ni les symboles de cette opération. Si l’institution se met à considérer que les repères n’en sont plus, ce formateur sera conduit à dire à l’enseignant qu’il doit respecter les progressions et que, s’il ne l’a pas fait jusqu’à présent, c’est parce qu’il a « une insuffisante compréhension des enjeux et des modalités des apprentissages premiers ». Il peut même avoir l’idée de préconiser la lecture de l’ouvrage que les mêmes inspecteurs généraux ont préfacé : « Le nombre au cycle 2 ». Auquel cas l’enseignant lira l’introduction de Michel Fayol ; il se peut qu’il prenne conscience qu’il existe bel et bien un dilemme de la symbolisation des opérations arithmétiques et … il n’y comprendra plus rien.
Insistons sur le fait que les formateurs ne sont en rien préservés du phénomène : un discours professionnel illogique est susceptible de les conduire tout autant dans une impasse. Eux aussi sont interpellés pour leur « insuffisante compréhension des enjeux et des modalités des apprentissages premiers » et, par conséquent, sont invités à s’informer du contenu de l’ouvrage « Le nombre au cycle 2 ». Dans la préface, les inspecteurs généraux leur recommandent de faire connaître ce document afin que les enseignants y puisent « au fil de leur lecture, des éléments de réflexion qui les aideront dans l’exercice plein de leur liberté pédagogique » (p. 4). Plus loin, dans la même page, en parlant de la façon de dénommer les classes de problèmes (des types ? des catégories ?), ils soulignent que « dans ce domaine comme dans d’autres, c’est la diversité des points de vue qui donne du relief aux concepts et permet au lecteur de construire sa propre réflexion ». Comment un inspecteur départemental ou un conseiller pédagogique qui aurait lu cette préface et l’introduction de Michel Fayol, pourrait-il ne pas se montrer souple concernant le moment où les enseignants de sa circonscription introduisent les symboles opératoires ? Cependant, si l’institution se met à considérer que les repères de progression ne sont plus des repères et qu’ils doivent être respectés à la lettre, cette souplesse leur sera reprochée et eux non plus n’y comprendront plus rien.
L’incertitude et l’illogisme ne sont pas une fatalité : on est sûr de l’existence du dilemme de l’automatisation des procédures, comme de celle du dilemme de la symbolisation des opérations ; on est sûr de la possibilité de les gérer expérimentalement dans le cadre des programmes de 2008. Pourquoi ne le ferait-on pas ?
Ne pas faire perdre son sens à l’épreuve pédagogique du concours
Imaginons un candidat au concours qui, interrogé sur l’« addition en colonnes au CP », se réfèrerait à la théorie de J.P. Fischer et qui exposerait le dilemme de l’automatisation de procédures, comme cela est presque fait dans l’ouvrage « Le nombre au cycle 2 ». Imaginons que le candidat défende l’idée que l’enseignement de l’addition en colonnes doit vraisemblablement être réservé à des élèves dont on est sûr qu’ils ont bien compris la numération décimale, des élèves qui savent que le « 3 » de 32 et le « 3 » de 43 n’ont pas la même valeur alors qu’on voit dans ces deux écriture, le même dessin d’un « 3 ». Imaginons que le candidat conclue que le plus sage serait de différer cet enseignement de quelques mois.
Le jury devra-il d’emblée dire à ce candidat qu’il est « hors sujet » parce que, de toute façon, l’addition en colonnes doit être enseignée au CP ? Ou bien devra-t-il lui dire que ses interrogations sont pertinentes, qu’elles prouvent ses capacités de réflexion mais qu’il conviendrait que, dans le cadre de ses activités professionnelles, il les garde pour lui parce qu’elles conduisent à des conclusions non conformes aux progressions qu’il faut adopter ?
Rappelons-le : l’explicitation du dilemme de l’automatisation des procédures, comme celle du dilemme de la symbolisation des opérations, trouvent leur origine dans des travaux universitaires tout à fait respectables qui ont fait l’objet de publications dans des ouvrages et des revues scientifiques renommés. Quel serait le sens d’une formation universitaire et quel serait le sens d’un concours où les candidats seraient conduits, le jour du concours, à taire ce qu’ils ont appris lors de leur formation ?
Rémi Brissiaud
M. C. de psychologie à l’Université de Cergy-Pontoise (IUFM de Versailles).
Équipe Compréhension, Raisonnement et Acquisition de Connaissances
Laboratoire Paragraphe (Paris 8)
Liens :
Sur Le nombre au cycle 2
http://cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2010/09/090920[…]
Sur la note de synthèse de l’inspection générale rédigée en juillet 2010
http://cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2010/09/2409[…]
Dossiers pédagogiques sur la calcul
http://cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/appren[…]
Rémi Brissiaud dans le Café
Une évaluation mal conçue
http://cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2009/evaCM2[…]
Les maths à l’école
http://cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/programm[…]
La pédagogie du nombre chez les 2-3 ans
http://cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/[…]
Bibliographie
Brissiaud R. (1989, 2004). Comment les enfants apprennent à calculer, Paris, Retz.
Brissiaud R. (1995) Enseignement et développement des représentations numériques chez l’enfant. Thèse de psychologie (non publiée). Université Paris 8.
Brissiaud, R. (2002). Psychologie et didactique: choisir des problèmes qui favorisent la conceptualisation des opérations arithmétiques. In J. Bideaud & H. Lehalle (Eds.), Traité des Sciences Cognitives – Le développement des activités numériques chez l’enfant (pp. 265-291). Paris: Hermes.
Brissiaud R. (2006). Calcul et résolution de problèmes : il n’y a pas de paradis pédagogique perdu. Texte mis en ligne sur Le Café Pédagogique
http://www.cafepedagogique.org/dossiers/contribs/brissiaud2.php
Brissiaud R. (2007). Premiers pas vers les maths. Les chemins de la réussite à l’école maternelle. Paris : Retz
Brissiaud R. (2009). L’enseignement de l’arithmétique élémentaire et l’approche historico-culturelle en éducation. In : M. Brossard & J. Fijalkow (Eds) : Théorie historico-culturelle et recherches en éducation et en didactiques, 181-196. Bordeaux : Presses Universitaires de Bordeaux.
Brissiaud, R. & Sander, E. (2010). Arithmetic word problem solving : a Situation Strategy First framework. Developmental Science, 13 (1), 92-107.
Devidal, M., Fayol, M. & Barrouillet, P. (1997). Stratégies de lecture et résolution de problèmes arithmétiques. L’Année Psychologique, 97, 9-31.
Fischer J.P. (1992). Apprentissages numériques: la distinction procédural/déclaratif. Nancy: Presses Universitaires.
National Mathematics Advisory Panel (2008). Foundations for Success: The Final Report of the National Mathematics Advisory Panel, U.S. Department of Education: Washington, DC.
Richard, J.F., & Sander, E. (2000). Activités d’interprétation et de recherche de solution dans la résolution de problème. In J.N. Foulin et C. Ponce Eds Lire, écrire, compter, apprendre : les apports de la psychologie des apprentissages. Bordeaux : CRDP d’Aquitaine.
Rittle-Johnson, B., & Siegler, R.S. (1998) The relation between conceptual and procedural knowledge in learning mathematics: a review. In C. Donlan (ed.), The development of mathematical skills (pp. 75-110). Hove, UK: Psychology Press.
Sander, E. (2008) Les connaissances naïves en mathématiques. In J. Lautrey, S. Rémi-Giraud, E. Sander & A. Tiberghien (Eds) : Les connaissances naïves, 57-102. Paris : Armand Colin.
Suchaut (2007) Apprentissages des élèves à l’école élémentaire : les compétences essentielles à la réussite scolaire » (collab. S. Morlaix). Note de l’IREDU, 07/1.
Thevenot, C., Devidal, M., Barrouillet, P., & Fayol, M. (2007). Why does placing the question before an arithmetic word problem improve performance? A situation model account. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 60 (1), 43-56.
Vygotski, L. (1934/1997), Pensée et Langage, La Dispute : Paris.
Willis G. & Fuson K. (1988). Teaching children to use schematic drawings to solve addition and subtraction word problems. Journal of Educational Psychology, 80, 192-201.











