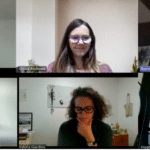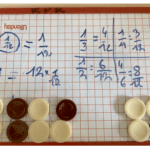• …et pourtant ce débat est vraisemblablement nécessaire aujourd’hui
• Que doit apprendre l’élève à l’école concernant la division ?
• Un exemple d’enseignement de la division selon les programmes de 1945
• Un exemple d’enseignement de la division tel qu’il se fait souvent aujourd’hui
• La division et les programmes de 2002
• Les programmes de 2002 et la conceptualisation : un manque de cohérence
• Et l’avenir ? [ + Bibliographie ]
 |
Rémi Brissiaud (a)
MC de Psychologie cognitive à l’IUFM de Versailles
Équipe « Compréhension, Raisonnement et Acquisition de Connaissances »
Laboratoire Paragraphe (Paris 8)
Un débat qui n’est pas sans danger …
Un vaste mouvement de réformes pédagogiques s’est développé dans la deuxième moitié du XXe siècle en mathématiques comme en français. Un bilan de ce mouvement concernant l’école maternelle et élémentaire en serait inégal, mais il ne serait sûrement pas négatif. Or, depuis plusieurs années, des personnes de sensibilités politiques, de fonctions et de statuts divers s’organisent en vue d’obtenir un retour aux pratiques pédagogiques d’avant ce mouvement. En français, leur mot d’ordre est notamment le retour à « la syllabique pure » pour l’apprentissage de la lecture. En mathématiques, elles prônent un retour aux programmes de 1945, ceux qui ont eu cours jusqu’en 1970, date de la réforme dite des mathématiques modernes. Elles exigent en particulier le retour à l’enseignement des 4 opérations dès le CP. C’est ainsi que le ministère de l’Éducation Nationale a officiellement autorisé divers enseignants réunis dans un Groupe de Réflexion Interdisciplinaire sur les Programmes (Grip) à « expérimenter cette réforme » dans plusieurs classes (1).
En fait, le ministre a déjà annoncé qu’il allait lancer le chantier de la rénovation de l’enseignement du « calcul » lors du Conseil des Ministres du 12/04/2006. Si cela signifiait une volonté d’organiser un vaste mouvement de réflexion sur l’état de l’enseignement des mathématiques en France pour préparer un éventuel changement des programmes, le ministre serait dans son rôle et cela n’aurait rien de scandaleux. Mais on peut craindre que, comme pour la lecture, des décisions précipitées soient prises, sans concertation préalable.
Le sens de la responsabilité devrait pourtant porter les hommes politiques à y réfléchir à deux fois aujourd’hui avant d’engager pour les mathématiques un processus analogue à celui qu’ils ont enclenché pour la lecture en début 2006. À force de campagnes médiatiques laissant croire que les pratiques pédagogiques iraient de mal en pis, la suspicion des parents ne fait que croître et les enseignants exercent de plus en plus leur profession « sous pression ». Ils doivent de plus en plus souvent se justifier de leurs pratiques auprès des parents. Ça leur est difficile parce que, dans les médias, les prises de position sont souvent caricaturales et cela ne prépare guère les parents à un échange constructif. Or, pour qu’une pédagogie soit efficace, une certaine confiance est nécessaire entre les différents membres de la communauté éducative. Actuellement, après diverses campagnes mettant en cause l’école publique, ses programmes, ses personnels et ses méthodes, la confiance des familles envers l’institution scolaire s’est dégradée et l’efficacité de celle-ci en pâtira vraisemblablement dans les années à venir.
…et pourtant ce débat est vraisemblablement nécessaire aujourd’hui
Le débat public n’est pas sans danger et pourtant, concernant l’enseignement des mathématiques, il est vraisemblablement nécessaire aujourd’hui. En effet, le fait qu’il faille enseigner les quatre opérations dès le CP semble tellement aller de soi dans l’esprit de nombreux hommes politiques et d’une grande part de l’opinion que seul un débat réellement argumenté peut laisser espérer qu’une telle décision ne sera pas prise à l’emporte-pièce.
Cette idée que les programmes puissent être « bousculés » n’est nullement une lubie. Pour s’en convaincre, il suffit de prendre l’exemple du rapport de la commission parlementaire Rolland sur l’enseignement des disciplines scientifiques dans le primaire et le secondaire. Dans une partie consacrée à l’enseignement des mathématiques à l’école (p. 35), le rapporteur évoque « les querelles byzantines » qui ont accompagné l’élaboration des programmes de 2002 en mathématiques. La commission a entendu MM. Lafforgue, Demailly et Delord (2), trois des principaux partisans du retour à l’enseignement des quatre opérations dès le CP et les parlementaires leur opposent le point de vue de Roland Charnay, considéré comme le « père des programmes de 2002» et pour qui la résolution de problèmes doit être à la fois source et critère du savoir mathématique (3). Le rapporteur de la commission dit que : « la mission déplore ce faux débat entre savoirs et compétences même si il y a eu pendant des années une certaine dérive pédagogique trop axée sur les mécanismes intellectuels de l’apprentissage. »
Les parlementaires ont également voulu m’entendre et ils semblent avoir été sensibles à certains aspects du discours que je leur ai tenu. Ils notent par exemple que : « Tout en regrettant que les psychologues n’aient pas été associés à l’élaboration des programmes, (Rémi Brissiaud) propose une sorte de synthèse des diverses positions. Selon lui, il est souhaitable d’enseigner la multiplication en CE1 et la division en CE2. Il ne faut pas trop retarder le moment où l’on aborde ces notions car si le temps d’apprentissage est trop court, ce sont ceux qui apprennent le plus vite qui s’en sortent le mieux. Il faut trouver un juste équilibre pour faire aussi la part à l’enseignement qui essaie de faire comprendre au plus grand nombre d’élèves la raison d’être des concepts arithmétiques, pourquoi les hommes les ont inventés, en quoi ils sont des outils pour affronter la réalité. Il ne faut pas revenir à ce qu’on faisait avant, quand on apprenait par cœur, car seul un petit nombre élèves étaient alors en mesure de s’interroger par eux-mêmes sur le pourquoi des choses. »
Et pourtant, dans leurs recommandations finales (p. 77), on lit qu’il faudrait… « développer l’apprentissage des techniques opératoires des quatre opérations dès le cours préparatoire » ! Les parlementaires maintiennent cette recommandation alors que, dans le corps de leur rapport, ils semblent considérer qu’une autre, explicitement différente, est la plus raisonnable !
Enfin, on ne peut pas trop se rassurer en lisant le texte du décret instituant un socle commun : « Il est nécessaire de créer aussi tôt que possible à l’école primaire des automatismes en calcul, en particulier la maîtrise des quatre opérations qui permet le calcul mental ». Si le sens est autant dans le texte que dans le contexte, cette formulation peut être aisément interprétée comme une prise position en faveur des tenants du retour aux programmes de 1945.
Que faire, lorsque l’on ne veut pas baisser les bras en attendant que tombe la mauvaise nouvelle de cette prochaine « réforme » ? Il n’y a guère d’autre choix que de continuer à expliquer, de la manière la plus précise possible, pourquoi un retour à l’enseignement des quatre opérations dès le CP serait catastrophique. C’est le but de ce texte.
C’est l’enseignement de la division à l’école qui, dans un premier temps, servira de fil conducteur : Delord, Demailly et Lafforgue proposent que les élèves apprennent à poser des divisions par 2, 4 et 5 dès le CP. Je voudrais avant tout montrer que lorsqu’on l’analyse à la lumière des connaissances disponibles en psychologie cognitive, le retour aux pratiques pédagogiques de 1945 ne se justifie d’aucune façon. Cependant, le point de vue développé ne sera pas seulement critique par rapport à un éventuel retour aux programmes de 1945, il le sera aussi par rapport à certaines conceptions pédagogiques qui ont cours aujourd’hui : en effet, l’analyse développée ne serait guère crédible si on laissait croire que la situation actuelle est idyllique, alors que les documents d’application des programmes de 2002 proposent de ne commencer à poser des divisions qu’au… CM2 (4) !
Cependant, j’essaierai de montrer qu’il ne convient pas de condamner et de bouleverser les pratiques pédagogiques actuelles. En effet, dans les classes, la plupart des enseignants ont profité de la définition des programmes par cycles (et non par année scolaire) pour adopter des progressions qui, sur ce sujet, ne se conforment ni aux instructions officielles de 1945, ni aux propositions des documents d’application et d’accompagnement des programmes de 2002. Ils enseignent la division au CE2 et leurs élèves posent leurs premières divisions dès ce niveau de la scolarité et ils ont certainement raison de faire cette lecture des programmes.
Que doit apprendre l’élève à l’école concernant la division ?
Une des missions de l’école est d’aider les enfants à comprendre la division ; elle doit aussi leur apprendre le « bon usage » de cette opération. Les psychologues, pour exprimer ces idées, disent souvent que les élèvent doivent s’approprier le concept de division. Mais qu’est-ce qu’un concept ?
Une réponse précise à cette question ne serait pas la même suivant la nature des concepts concernés (Keil, 1979). Les concepts renvoyant à des entités naturelles (le concept d’animal, par exemple) ne se construisent pas comme ceux renvoyant à des artefacts (celui de tournevis, par exemple) ou à des entités de nature morale (la tricherie, par exemple). Mais il existe quand même une caractéristique commune à tout processus de conceptualisation : conceptualiser conduit à regrouper au sein d’une même catégorie des entités qui, auparavant, apparaissaient différentes. De manière plus précise, cela consiste à considérer ces entités comme identiques d’un certain point de vue, alors qu’auparavant, et de ce même point de vue, elles apparaissaient différentes.
Concernant le concept d’animal, par exemple, les enfants de 3-4 ans considèrent très tôt que le chat est un animal parce qu’il se déplace par auto-mouvement, parce qu’il boit et mange. Mais une propriété est également importante à leurs yeux et concourt à ce qu’ils le considèrent comme un animal : le fait que les « mamans chats » aient des « bébés chats » et qu’elles les cajolent. En revanche, ils ne considèrent pas d’emblée le ver de terre comme un animal parce qu’ils ne lui attribuent pas un tel comportement (Carey, 1985). Lorsqu’on montre à un enfant de 3-4 ans un grand ver de terre et un petit ver de terre, il n’admet pas facilement que le petit puisse être le « bébé » du grand ; les jeunes enfants n’attribuent pas de relations de maternage aux vers de terre. Ils ont raison, mais ceci ne les aide guère à considérer le ver de terre comme semblable aux autres animaux qui leur sont plus familiers. Regrouper, au-delà de leurs différences, le ver de terre et le chat dans la même catégorie des animaux est un progrès dans l’appropriation de ce concept (c’est comprendre que la propriété de maternage n’est pas essentielle). Par ailleurs, un tel processus de réduction de la diversité est un processus d’adaptation parce qu’il permet des anticipations (si le ver de terre est un animal, on peut anticiper qu’une observation attentive de celui-ci devrait nous conduire à discerner une bouche, alors que cette propriété n’est pas saillante chez le ver).
Concernant un concept arithmétique comme la division, quelles sortes d’entités s’agit-il de regrouper au-delà de leurs différences ? Deux réponses sont possibles à cette question selon que l’on s’intéresse aux situations de divisions ou aux procédures permettant d’effectuer une division :
1°) la conceptualisation de la division par n permet notamment de regrouper les situations de partage en n parts égales et celles de groupement par n parce que la division est un mode de traitement commun à ces deux sortes de situations.
2°) la conceptualisation de la division permet aussi de regrouper les procédures permettant de réaliser un partage en n parts égales et les procédures permettant de réaliser un groupement par n parce que ces procédures conduisent aux mêmes résultats numériques (nous dirons qu’elles sont équivalentes) (5).
La division : un mode de traitement commun aux situations de partage et de groupement
Ce premier point de vue est celui des usages de la division. De façon systématique avant 1970, et encore très souvent aujourd’hui, deux grands usages de la division étaient distingués et explicitement présentés aux élèves. Cette opération permet : 1°) de connaître la valeur d’une part quand on partage une quantité de façon équitable en n parts égales et 2°) de connaître le nombre de groupes de n qu’il est possible de former avec cette même quantité.
En fait, cela ne vient pas immédiatement à l’esprit qu’une caractéristique essentielle de la division par n est d’être un mode de traitement commun aux situations de partage en n et de groupement par n parce que dans le langage quotidien, le mot « diviser » fonctionne comme synonyme de « partager ». Une personne qui dispose d’une collection d’objets devant elle et à qui l’on demande de la diviser par 4, forme systématiquement 4 parts égales avec ces objets (en laissant de côté les 1, 2 ou 3 objets qui ne peuvent pas être répartis et qui constituent ainsi le reste). Jamais la consigne de « diviser par 4 » ne conduit cette personne à former des groupes de 4 (en laissant de côté les 1, 2 ou 3 objets qui ne peuvent pas être groupés et qui constituent ainsi le reste). Cet état de fait doit évidemment être pris en compte pour penser une progression pédagogique concernant la division à l’école.
La division comme symbole de l’équivalence entre les procédures de partage et de groupement
De façon systématique avant 1970, et encore très souvent aujourd’hui, les maîtres font calculer les divisions posées « en potence » en oralisant chaque calcul partiel de la manière suivante : « a divisé par b, ou encore : En a combien de fois b ? ». Comme le mot « diviser » fonctionne dans le langage quotidien comme synonyme de « partager », la signification typique de cette formule est : « a partagé en b parts égales, ou encore : Avec a combien de groupes de b peut-on former ? ». Pourquoi les enseignants font-ils prononcer cette formule?
En premier lieu, il faut savoir que, longtemps, pour effectuer des calculs présentés de manière symbolique (la recherche du quotient et du reste de divisions comme 152 : 50 ? (6) ou 152 : 3 ? par exemple) les élèves ont besoin de s’imaginer des scénarios correspondants à ces écritures.
Or la formule « a divisé par b, ou encore : En a combien de fois b ? » suggèrent aux élèves qu’ils peuvent, au choix, s’imaginer un scénario de partage en b parts égales ou un scénario de groupement par b pour trouver la solution. Dans le cas de 152 : 50 ?, par exemple, il vaut mieux s’imaginer un scénario de groupement par 50 (152, c’est 3 groupes de 50 et encore 2) alors que dans le cas de 152 : 3 ?, le scénario de groupement par 3 conduit à imaginer un très grand nombre de groupes de 3 : 10 groupes de 3, c’est 30 ; 20 groupes, c’est 60… Dans le cas de 152 : 3 ?, donc, il vaut mieux s’imaginer 3 personnes et un scénario de partage équitable entre ces 3 personnes (152, c’est 3 parts de 50 et encore 2).
Mais pourquoi peut-on ainsi, au choix, se référer à l’un ou l’autre de ces scénarios ? Parce que la procédure activée par un scénario de partage conduit aux mêmes résultats numériques (même quotient, même reste) que la procédure activée par un scénario de groupement. Par exemple, on a vu que dans le cas de 152 : 3 ?, un scénario de partage donne facilement la solution (q = 50 et r = 2). Mais si, pour calculer 152 : 3 ?, on avait continué le raisonnement amorcé plus haut qui, lui, est fondé sur un groupement : 10 groupes de 3, c’est 30 ; 20 groupes, c’est 60… on aurait abouti à : 50 groupes de 3, c’est 150 et, donc, 152, c’est 50 groupes de 3 et encore 2, c’est-à-dire 152 contient 50 fois 3 et encore 2 (q = 50 et r = 2). Ce raisonnement est plus laborieux, mais il aboutit aux deux mêmes nombres. En ce sens, les deux sortes de procédures sont équivalentes et la division est l’opération arithmétique qui résulte de cette équivalence et la symbolise, équivalence hautement intéressante parce qu’elle permet de substituer un calcul très économique à un autre, bien plus long. Or une telle équivalence est loin d’aller de soi pour les enfants.
Une équivalence entre procédures qui est loin d’aller de soi
De nombreux travaux montrent qu’avant d’apprendre la division à l’école, les situations de groupement par n et celles de partage en n parts égales apparaissent aux enfants comme très différentes du point de vue des traitements numériques qui leur sont appropriés (voir notamment : Kouba, 1989 et, pour une synthèse : Verschaffel & De Corte, 1997).
Considérons par exemple ce problème de groupement par 3 : « Avec 13 gâteaux, combien peut-on faire de paquets de 3 gâteaux ? ». Beaucoup d’enfants d’école maternelle, de CP ou de CE1 savent résoudre ce problème avant tout enseignement de la division. Lorsqu’ils disposent de jetons, les enfants simulent la situation décrite dans l’énoncé en créant une collection de 13 jetons, en les groupant par 3 puis en comptant les groupes de 3 formés.
Considérons maintenant ce problème de partage en 3 parts égales : « On partage équitablement 13 images entre 3 enfants. Combien d’images chaque enfant reçoit-il ? ». Avec des jetons, les enfants résolvent ce problème par une procédure de distribution : ils dessinent par exemple 3 bonshommes, ils donnent d’abord un jeton à chacun d’eux, puis un autre jeton, etc.
Ce qu’il est important de savoir, c’est que pour les enfants, ces deux résolutions n’ont rien de commun : dans un cas, pour connaître la solution numérique, il faut compter des groupes de 3, dans l’autre, celle-ci s’obtient en comptant 1 à 1 les objets qui ont été attribués à l’un quelconque des bonshommes. On compte des groupes de 3 dans un cas, des unités simples dans l’autre ; ça n’a rien à voir !
Mais peut-être l’usage de jetons empêche-t-il les enfants de prendre conscience que ces deux types de situations peuvent être traitées de manière identique ? Parfois, ce n’est pas lorsqu’on est plongé dans l’action qu’on en perçoit le mieux les propriétés. Qu’en est-il lorsque les enfants ne disposent pas d’objets ? Une recherche récente a montré qu’en 5e année d’école et en l’absence d’un enseignement de la division, ils ne tissent encore aucun lien entre les procédures numériques qu’ils utilisent pour traiter chacune des deux sortes de situations ! (Abrose, Baek et Carpenter, 2003).
Concernant des enfants plus jeunes (Brissiaud, 2004a ; Brissiaud & Sander, 2004), les deux problèmes de groupement suivants ont été proposés oralement à 110 élèves de début de CE1 dans des conditions où ils n’avaient aucun matériel et où, disposant seulement d’une minute pour répondre, ils n’avaient pas le temps de faire un schéma pour simuler ce qui est dit dans l’énoncé (les taux de réussite sont indiqués entre parenthèses) :
- G1 : « Avec 40 gâteaux, combien peut-on faire de paquets de 10 gâteaux ? » (R = 52 %)
- G2 : « Avec 40 gâteaux, combien peut-on faire de paquets de 4 gâteaux ? » (R = 15 %)
Les deux énoncés utilisent les mêmes mots et pourtant les taux de réussite sont très différents. Par ailleurs, c’est le problème avec les plus grands nombres (40 et 10) qui est le mieux réussi alors qu’on pourrait penser qu’il est plus difficile de calculer avec des grands nombres. Comment expliquer cette grande différence entre les taux de réussite aux deux problèmes ? Cela s’explique en considérant que les enfants, même lorsqu’ils ne disposent pas d’objets physiques à manipuler, continuent à simuler l’action de groupement décrite dans l’énoncé, mais ils le font alors à l’aide d’un comptage de n en n. Dans le cas du problème G1, ils disent 10 en levant 1 doigt qui représente un paquet de gâteaux, puis 20 (2 doigts sont levés pour 2 paquets), 30 (3) et enfin 40 (4 doigts pour 4 paquets). Dans le cas du problème G2, ils disent 4 en levant 1 doigt, 8 (2), 12 (3), 16 (4), etc. Mais, d’une part il est plus difficile de compter de 4 en 4 que de 10 en 10 et, d’autre part, pour obtenir le même nombre, 40, la procédure est beaucoup plus longue avec 4. Aussi, seuls les très habiles compteurs peuvent-ils réussir.
Or, dans la même recherche, les mêmes élèves devaient également résoudre, dans des conditions identiques, les problèmes de partage suivants :
| P1 : « On partage 40 images entre 10 enfants en faisant des parts égales. Combien d’images chaque enfant va-t-il recevoir ? » | (R = 10 %) |
| P2 : « On partage 40 images entre 4 enfants en faisant des parts égales. Combien d’images chaque enfant va-t-il recevoir ? » | (R = 48 %) |
Là encore, on observe une grande différence entre les taux de réussite à P1 et P2, mais les résultats sont inversés : c’est le problème P1, celui qui contient les nombres 40 et 10, qui est le plus difficile.
En comparant les résultats aux deux types de problèmes, on s’aperçoit que G1 (groupement) et P1 (partage) contiennent les mêmes nombres (40 et 10) mais que leurs taux de réussite sont très différents (52% vs. 10%) ; il en est de même des problèmes G2 et P2 qui, eux aussi, sont formés avec les mêmes nombres (40 et 4). On est donc sûr qu’avant d’avoir appris la division à l’école, les élèves ne résolvent pas de la même manière les problèmes de groupement par n et de partage en n parts égales.
Il est important de remarquer que les résultats obtenus aux problèmes de partage s’expliquent eux aussi du fait que les enfants simulent mentalement la situation décrite dans l’énoncé. Mais dans ce cas, il serait difficile de simuler mentalement la distribution 1 à 1 parce que la réalisation de cette procédure avec des objets physiques s’appuie sur des indices perceptifs : c’est le fait que la dernière personne est servie qui indique la fin d’un tour de distribution. Aussi les enfants simulent-ils mentalement le résultat de cette distribution et non la distribution elle-même : ainsi, dans le cas du problème P2, ils s’imaginent 4 personnes et se demandent ce qu’il faut mettre devant chacune d’elles pour que le total fasse 40. C’est ainsi que l’énoncé « 40 partagé en 4 » est recodé sous la forme : « 4 fois ? font 40 ». Dans le cas de ce problème P2 la solution est simple : 4 fois 10, 40. Dans le cas de P1, le partage se fait en 10 parts ; ils s’imaginent donc 10 personnes, et l’énoncé « 40 partagé en 10 » est recodé sous la forme : « 10 fois ? font 40 ». Mais cela ne les conduit pas au résultat car la relation numérique « 10 fois 4, 40 » vient beaucoup moins facilement à l’esprit que « 4 fois 10, 40 ».
En fait, ce type de comportement est très général et ne concerne pas seulement les problèmes de partage et de groupement. Les recherches en psychologie (cf. Verschaffel & De Corte, 1997) ont montré qu’avant tout enseignement des opérations arithmétiques, les enfants sont susceptibles de résoudre une grande variété de problèmes arithmétiques mettant en jeu des ajouts, des retraits, des ajouts répétés n fois, des partages, etc. Ces recherches ont montré que les procédures informelles utilisées par les enfants sont toujours des procédures de simulation de la situation décrite dans l’énoncé et qu’elles sont de l’un des trois types suivants : 1°) simulation par l’action avec des objets physiques ; 2°) simulation par une procédure de comptage et 3°) simulation par l’usage de relations numériques connues.
Dans le cas qui nous intéresse, ce qu’il importe de savoir est :
- Que les problèmes de groupement : « En a combien de fois b ? », sont faciles à résoudre quand a contient peu de fois b (par exemple : « en 40, combien de fois 10 ? » et, plus tard, « en 152, combien de fois 50 ?) et quand les multiples de b sont faciles à calculer (ce qui est le cas des multiples de 10 et de ceux de 50).
- Que les problèmes de partage : « si a unités sont partagées en b parts égales, quelle est la valeur d’une part ? », sont faciles à résoudre quand le recodage sous la forme « b fois ? égale a » active une relation numérique connue (par exemple : « 40 partagé en 4 parts égales » qui se recode sous la forme : « 4 fois ? font 40 » et, plus tard, « 153 partagé en 3 parts égales » qui se recode sous la forme « 3 fois ? font 153 »).
s
Les enjeux de la scolarisation
À la lumière des résultats précédents, les enjeux de la scolarisation sont les suivants :
1°) Le premier enjeu est de développer chez tous les élèves la compétence à résoudre des problèmes simples de groupement et de partage en simulant les actions décrites dans l’énoncé avec des objets physiques ou en faisant un schéma papier-crayon pour repésenter par écrit ces objets physiques. Au début du CP, par exemple, la résolution d’un problème de groupement par 3 est loin de conduire à une réussite totale. À cet âge, en effet, compter des groupes de 3 ne va pas de soi : il faut dire « un » alors qu’on voit et pointe « trois » jetons ; il faut donc considérer que le « un » du comptage (l’unité) est une pluralité et cela va à l’encontre de ce que les enfants ont appris jusque-là.
Il semble de bon sens qu’il conviendrait d’atteindre cet objectif avant d’amorcer l’enseignement de la division elle-même, c’est-à-dire avant tout enseignement de sa propriété essentielle : l’équivalence entre les procédures de groupement par n et de partage équitable en n parts. En effet, comment pourrait-on espérer qu’un enfant s’approprie l’équivalence entre deux procédures s’il ne maîtrise pas la forme la plus rudimentaire de l’une d’elles ?
Par ailleurs, on a vu qu’en début CE1 et lorsque les élèves n’utilisent pas de matériel, seule une moitié d’entre eux est capable de résoudre des problèmes très simples tels que G1 (40 unités groupées par 10) et P2 (40 unités partagées en 4). Un autre objectif est donc que l’autre moitié des élèves apprenne à le faire, que ce soit par une procédure de comptage ou en utilisant une relation numérique connue. L’idéal serait évidemment que les enfants utilisent le plus souvent possible des relations numériques connues et, donc, qu’ils en connaissent un grand nombre et pas seulement celles où 10 est l’un des facteurs. Considérons par exemple le problème : « On partage 18 images entre 3 enfants en faisant des parts égales. Combien d’images chaque enfant va-t-il recevoir ? ». Ce serait bien que les élèves sachent assez tôt dans leur scolarité le résoudre parce qu’ils recodent ce problème sous la forme : « 3 fois ? font 18 » et répondent en activant la relation numérique : « 3 fois 6, 18 ».
2°) Le deuxième enjeu est que les élèves s’approprient la propriété essentielle de la division : l’équivalence entre les procédures de partage équitable en n parts et de groupement par n. Il convient également qu’ils apprennent les deux symboles de cette équivalence : les deux points du signe « divisé » et la potence de la division posée. Quand peut-on dire que, pour une personne donnée, des signes graphiques comme les deux points de « 163 : 50 ? » ou la « potence » de la division posée symbolisent l’équivalence entre les procédures de groupement et de partage ? C’est le cas lorsque, confrontée à divers usages de ces symboles, cette personne utilise tantôt une procédure, tantôt l’autre.
Comme nous l’avons vu, c’est bien ce que fait un adulte scolarisé lorsqu’il utilise ces symboles : la recherche du quotient et du reste de divisions comme 152 : 50 ? ou 152 : 3 ? le conduit à mettre en œuvre une procédure de groupement pour la première et une procédure de partage pour la seconde. Et pourtant le problème lui est posé avec les mêmes deux points dans les deux cas !
3°) Un troisième enjeu consiste à enseigner le calcul d’une division (la détermination du quotient et du reste), qu’il s’agisse d’un calcul mental dans les cas simples ou d’un calcul posé dans les cas plus complexes.
Comme nous venons de le voir avec les exemples du calcul de 152 : 50 ? ou 152 : 3 ?, les compétences en calcul mental dépendent très directement de la conceptualisation, c’est-à-dire de l’appropriation de l’équivalence entre partage et groupement : pour être performant en calcul mental, il ne faut pas s’y prendre toujours de la même façon mais, selon les cas, mettre en œuvre une procédure de partage ou une procédure de groupement. Ceci est évidemment conditionné par l’appropriation de l’équivalence entre ces deux sortes de procédures, équivalence qui est au cœur de la conceptualisation.
Le calcul posé d’une division est, lui, l’objet d’une polémique : il faut noter que certains pédagogues se seraient réjoui si cette technique avait complètement disparu du programme. Dans un document publié par le Conseil national des programmes en août 1999, par exemple, on pouvait lire : « Apprendre à faire une division est un travail formel qui n’éclaire pas le sens de cette opération… » Nous allons voir dans la suite de ce texte qu’on peut sérieusement douter d’une telle affirmation.
4°) Un dernier enjeu, enfin, ne sera pas abordé dans ce texte. Il consiste à élargir progressivement la catégorie des problèmes que les élèves reconnaissent directement comme pouvant être résolus à l’aide d’une division. Considérons par exemple le problème suivant : « 3 objets identiques coûtent 48 euros. Quel est le prix d’un de ces objets ? ». S’agit-il d’un problème de partage ? À strictement parler, non. Et pourtant, pour le résoudre, il est possible de partager la somme totale qu’il faut payer en 3 parts égales correspondant à chacun des objets. On conçoit aisément que la reconnaissance de ce type de problèmes en tant que problème de division, nécessite un raisonnement chez les élèves les plus jeunes (soit l’évocation d’un partage, soit la prise de conscience qu’il faut chercher : « 3 fois ? font 48 ») ; on conçoit aussi que, dans un deuxième temps, cette reconnaissance devienne quasi-immédiate.
Après avoir recensé ce que savent faire les enfants avant tout enseignement de la division, et en avoir déduit les enjeux de l’enseignement de la division à l’école, examinons comment les pédagogues favorisaient le progrès lorsqu’ils se conformaient aux programmes de 1945 (on examinera ensuite comment ils le font souvent aujourd’hui et comment les programmes de 2002 leur recommandent de le faire).
Un exemple d’enseignement de la division selon les programmes de 1945
L’analyse qui suit s’appuie essentiellement sur l’étude de deux séries de manuels qui étaient très utilisés entre 1945 et 1970 (1970 est la date de la réforme dite des « mathématiques modernes »). Ces manuels sont respectivement : « Le calcul vivant » une collection éditée chez Hachette et dirigée par L. et M. Vassort et « Le calcul quotidien » éditée chez Fernand Nathan et dirigée par Bodard.
À cette époque, la division n’était pas enseignée avant le CE2
Une telle proposition peut surprendre parce que dans la table des matières de tous les ouvrages de CE1 de l’époque, des leçons s’intitulent : « division par 2 », « division par 3 »… Mais le titre est trompeur : ce n’est pas la division qui était enseignée, c’était la recherche de la valeur d’une part lors d’un partage. Aussi bien dans la série « Le calcul vivant » que dans la série « Le calcul quotidien », au CE1, la seule signification qui était attribuée à une égalité telle que « 21 cerises : 3 = 7 cerises » était la suivante : si 21 cerises sont partagées entre 3 personnes, chacune d’elle en reçoit 7. Avant le CE2, à aucun moment, l’enseignant ne disait explicitement à ses élèves que la division sert aussi à résoudre les problèmes de groupement, c’est-à-dire que l’égalité « 21 : 3 = 7 » renvoie aussi à un scénario où les cerises sont groupées par 3 et où 7 exprime alors le nombre de groupes de 3 cerises. On remarquera d’ailleurs que le seul fait de noter « cerises » dans l’égalité, ce qui se faisait systématiquement dans les petites classes à l’époque (cf. ci-dessous) place nécessairement l’égalité dans un contexte de partage. On ne peut pas écrire : « 21 cerises : 3 = 7 groupes de 3 cerises »(7).
 |
| Le calcul vivant CE1 (page 39) |
La question qu’il convient de se poser est donc la suivante : est-ce un bon choix d’utiliser sur une longue durée (fin du CP et tout le CE1), le mot « divisé » comme synonyme de « partager » ? Est-ce un bon choix de faire croire sur une longue durée aux élèves que les deux points et la potence sont seulement des sortes d’abréviations sténographiques pour le mot « partager » alors qu’il faudra plus tard leur enseigner que ce sont des symboles de l’équivalence entre le partage et le groupement ?
C’est une erreur pédagogique d’assimiler sur une longue durée la division au partage
C’est assurément un très mauvais choix pédagogique parce qu’à chaque fois qu’un mot ou des symboles sont utilisés sur une longue durée dans un sens trop restreint, cela crée des difficultés de généralisation. C’est évident, par exemple, avec le mot « rectangle ». Ci-dessous, ce sont bien trois rectangles qui sont dessinés mais l’affirmation qu’il s’agit d’un rectangle n’est pas aussi évidente pour chacune d’elle.
 |
Dans le cas du mot « rectangle », il est pratiquement impossible d’éviter un tel phénomène : il faudrait que les enfants rencontrent et utilisent d’emblée ce mot dans toute son extension, c’est-à-dire pour désigner des rectangles dans des positions non typiques, bien sûr, mais aussi pour désigner les rectangles particuliers que sont les carrés, ce qui est impossible avec le lexique quotidien qui est le nôtre. La difficulté provient du fait que dans le langage courant, les mots « rectangle » et « carré » fonctionnent au même niveau de généralité alors que d’un point de vue théorique la notion de rectangle est plus générale que celle de carré (le carré est un rectangle particulier). Cet obstacle n’existerait pas si notre lexique était structuré différemment. Il n’y aurait aucun problème si les enfants disposaient initialement du mot « carré » et d’un autre mot permettant de désigner les rectangles qui ne sont pas carrés, le mot « plaques » par exemple.
Les rectangles
 |
En apprenant le mot « rectangle » avec comme extension les « plaques » et les « carrés », il leur paraîtrait évident que les carrés sont des rectangles. Or, concernant la division, on dispose fort heureusement de deux mots différents : « partager » et « grouper » (analogues à « plaques » et « carré »), et d’un troisième mot, diviser, qui est moins courant dans la langue que les deux précédents et qu’il est donc possible, lors d’un usage scolaire, de définir pratiquement d’emblée comme renvoyant indiféremment à l’une ou l’autre des actions précédentes. Convaincre les élèves que le mot « diviser » est synonyme de partager est une erreur pédagogique grave : cela revient à créer artificiellement la difficulté qu’on rencontre inévitablement avec le mot « rectangle ». Lorsqu’on fait ce choix, les enfants auront du mal à généraliser l’emploi de division aux situations autres que celles de partage, de même qu’ils ont du mal à désigner par le mot « rectangle » les figures qui sont autres que les rectangles typiques, et notamment les carrés.
On ne peut pas comprendre l’enseignement de la division avant 1970, si on ne prend pas en compte la façon dont les enfants apprenaient les tables de multiplication
Revenons au fait que l’égalité : « 35 cerises : 5 = 7 cerises » était enseignée dès le CP avec la signification suivante : si 35 cerises sont partagées entre 5 personnes, chacune d’elles en reçoit 7. On a vu que les élèves de cet âge, lorsqu’ils sont confrontés au problème : « 35 cerises sont partagées entre 5 personnes », n’accèdent à la solution que s’ils sont capables de le recoder sous la forme « 5 fois ? égale 35 » et si cela active une relation numérique connue. Fort heureusement, dans les progressions adoptées à cette époque, les élèves avaient auparavant appris la table de multiplication par 5 sous la forme : « 5 fois 1, 5 », « 5 fois 2, 10», « 5 fois 3, 15 », « 5 fois 4, 20»,« 5 fois 5, 25 », « 5 fois 6, 30», « 5 fois 7, 35 », « 5 fois 8, 40», « 5 fois 9, 45 », « 5 fois 10, 50 ».
De même, lorsque les élèves au CE1 étaient confrontés à un problème du type : « On partage 24 objets en 3 parts égales », ceux qui cherchaient « 3 fois ? font 24 » n’accèdaient à la solution que parce qu’ils avaient auparavant appris la table de multiplication par 3 sous la forme : « 3 fois 1, 3 », « 3 fois 2, 6», « 3 fois 3, 9», « 3 fois 4, 12», « 3 fois 5, 15», « 3 fois 6, 18», « 3 fois 7, 21», « 3 fois 8, 24», « 3 fois 9, 27», « 3 fois 10, 30 ».
Rappelons que dans le mode traditionnel d’apprentissage des tables, les différentes lignes de la table de 3 commencent toujours par « 3 fois … » (alors qu’on aurait pu avoir : « 1 fois 3 », « 2 fois 3 », etc.). De même, les différentes lignes de la table de 5 commencent toujours par « 5 fois … » (alors qu’on aurait pu avoir : « 1 fois 5 », « 2 fois 5 », etc.). Ce format d’apprentissage des tables avait sa raison d’être : c’est celui qui favorise le mieux la résolution des problèmes de partage en s’appuyant sur les résultats de tables de multiplication (8).
Un choix pédagogique qui privilégie trop rapidement l’usage de relations numériques connues
Cette progression pédagogique a de toute évidence l’avantage d’inciter les enfants à mémoriser les relations numériques nécessaires à la résolution des problèmes simples de partage. Mais des questions importantes se posent. En effet 48% seulement des enfants réussissent le problème P2 (40 partagé en 4) en début de CE1 alors que celui-ci utilise une relation numérique extrêmement simple : « 4 fois 10, 40 ». On imagine aisément qu’avec la pédagogie qui vient d’être décrite, un grand nombre d’élèves risquent d’être en échec pour l’une des deux raisons suivantes : soit ils sont incapables de mettre en œuvre le raisonnement nécessaire au recodage du problème « 35 cerises partagées en 5 parts égales » sous la forme « 5 fois ? font 35 », soit ils maîtrisent insuffisamment les tables de multiplication. Concernant l’aspect « raisonnement », pour que tous les élèves comprennent ce type de résolution, il faut évidemment le mettre en relation avec le résultat d’une résolution par l’action, à l’aide de matériel. Or, ce n’était généralement pas fait.
Rappelons que le premier enjeu d’une progression vers la division est de développer chez tous les élèves la compétence à résoudre des problèmes simples de groupement et de partage en simulant les actions décrites dans l’énoncé avec du matériel (ou en faisant un schéma papier-crayon). Concernant les problèmes de partage, dans la progression suivie avant 1970, on ne réservait pas un temps qui aurait servi à ce que tous les élèves comprennent comment l’usage de relations numériques connues permet, via un recodage de l’énoncé de départ, d’obtenir la solution numérique. Concernant le groupement, la situation était pire : dans cette progression, ce type de problèmes n’était pas proposé avant le CE2.
Au CE2, la pertinence de la division pour résoudre des problèmes de partage et de groupement était affirmée sans que l’équivalence entre ces procédures soit expliquée
Le plus souvent, donc, c’est au CE2 seulement que la division était réellement enseignée parce que c’est seulement à ce niveau de la scolarité que ses deux usages étaient présentés aux élèves. Dans l’ouvrage intitulé : « Le calcul vivant », aucune tentative de mise en relation des deux significations n’est tentée : les auteurs se contentent d’affirmer dogmatiquement que la division permet de résoudre les deux sortes de problèmes. La leçon correspondante du « Calcul quotidien » CE2 est reproduite plus bas. Il semble y avoir une tentative d’explication mais c’est trompeur : l’équivalence entre les deux procédures n’est même pas constatée dans les cas particuliers des exemples qui sont utilisés.
Les élèves sont conduits à chercher le résultat du partage de 30 billes en 2 parts égales (15 billes par boîte). Mais aucune comparaison n’est faite avec une situation de groupement qui utiliserait les mêmes nombres : à aucun moment on ne s’assure qu’avec 30 billes qu’on grouperait par 2 dans des boîtes, on pourrait remplir… 15 boîtes. De même, on conduit les élèves à grouper 30 billes par 5 (6 groupes). Mais à aucun moment on ne compare avec la situation où, disposant de 30 billes, on forme « 5 boîtes égales », c’est-à-dire 5 parts égales (6 billes dans une part). Constater que deux procédures conduisent au même résultat nécessite évidemment de les mettre en œuvre dans des situations qui en permettent la comparaison. Les auteurs ne le font pas ici. Ils ne visent donc pas à ce que les élèves constatent l’équivalence entre les deux procédures dans les cas particuliers qu’ils examinent. Ils visent évidemment encore moins à ce que les élèves comprennent les raisons d’une telle équivalence ! Elle n’est ni constatée, ni expliquée.
 |
| Le calcul quotidien CE2 (p. 24) |
On peut trouver cette analyse trop rapide parce que les auteurs, à la fin du document précédent, font appel à un même type de situation, le partage, pour mettre en relation les deux cas d’usage de la division : ils distinguent ceux où l’on cherche « la valeur d’une part » et ceux où c’est le « nombre de parts » qui est inconnu. Or, on a la relation suivante :
valeur totale = nombre de parts x valeur d’une part
De plus, les facteurs d’un tel produit peuvent être intervertis (commutativité de la multiplication), cela justifie que dans les divisions qui sont posées en potence en bas du document précédent, on puisse intervertir la place du nombre de part et de la valeur d’une part. En fait, lorsqu’on analyse les ressorts de la tentative pédagogique qui consiste à distinguer la recherche de la valeur d’une part et la recherche du nombre de parts, on s’aperçoit qu’elle repose sur la stratégie suivante. On suppose que les enfants ont présent à l’esprit la commutativité de la multiplication et le but est qu’ils découvrent la commutativité de la « multiplication à trou » qu’est la division. C’est l’existence de deux possibilités de positionnement à l’intérieur de la potence qui est censée permettre de passer d’une commutativité à l’autre !
Mais qui peut penser qu’un tel procédé peut conduire un enfant de CE2 à comprendre ? Toutes les recherches qui se sont intéressées à cette question montre que les enfants ne transfèrent pas facilement la commutativité de la multiplication à celle de la multiplication à trou qu’est la division (Squire & Bryant, 2002 ; Brissiaud, 2004b). Non seulement ce type d’argument n’est pas du tout convaincant pour un enfant de cet âge, mais il a l’inconvénient d’enfermer un peu plus encore l’usage de la division dans les situations de partage !
Un apprentissage de la résolution de problèmes à partir de problèmes-types
En pédagogie, lorsqu’on est très critique vis-à-vis d’une progression, il est toujours prudent, pour éviter de verser dans le dogmatisme, de s’interroger sur ce qui explique que certains élèves développent quand même leurs connaissances dans le cadre de cette progression. Il est clair que de nombreux élèves ayant utilisé les manuels précédents apprenaient à résoudre des problèmes de division. Cela s’explique vraisemblablement de la façon suivante : ils étaient confrontés à un très grand nombre de problèmes dont l’enseignant leur disait explicitement qu’ils doivent être résolus en faisant une division. Ils avaient donc la possibilité de progresser selon une forme d’apprentissage qui commence à être bien étudiée en psychologie : l’apprentissage à partir d’exemples en situation de résolution de problèmes (9). Les pédagogues, eux s’exprimeraient autrement. Pour dénommer cette forme d’apprentissage, ils parleraient plutôt d’un apprentissage à partir de problèmes-types.
Ce mode d’apprentissage est généralement peu valorisé par les pédagogues. Et pourtant il est plus fréquent qu’on ne le croit : lorsqu’une personne est confrontée à un nouveau problème, elle recherche souvent en mémoire un problème proche qu’elle sait résoudre afin de s’en inspirer pour trouver une solution (Sander, 2000). Les pédagogues se méfient à juste titre de ce mode d’apprentissage parce qu’il conduit à une résolution des problèmes par analogie et l’on sait que le raisonnement par analogie conduit au meilleur comme au pire. Il y a des analogies « superficielles » et des analogies « profondes » et seules ces dernières peuvent conduire à la bonne solution, autrement que « par chance ».
Un mode d’apprentissage élitiste
Comme il fallait s’y attendre, diverses recherches (la première est de Chi et collègues, 1989) ont montré que cette forme d’apprentissage fonctionne mieux chez les personnes qui s’interrogent d’elles-mêmes sur les conditions d’application de la résolution-type qui leur a été présentée : elles se préservent mieux de l’usage d’analogies superficielles. Ce mode d’apprentissage a donc l’inconvénient de creuser l’écart entre les « bons élèves » qui sont dans un rapport réflexif concernant la pertinence de ce qu’ils savent et les moins avancés qui ne sont pas dans un tel rapport. Ces derniers utilisent des analogies superficielles ; face à l’énoncé de problème : « 6 enfants se partagent équitablement un paquet de gâteaux ; chacun d’eux reçoit 4 gâteaux. Combien y avait-il de gâteaux dans le paquet ? », ces élèves utilisent la division parce que l’énoncé contient le mot « partage ». Ils utilisent ce qu’on appelle une stratégie d’usage de « mots-clefs ».
Les recherches ont donc montré que lorsque des élèves sont en situation d’apprentissage à partir de problèmes-types, le progrès dépend de leur compréhension des conditions qui autorisent l’application des résolutions-types qui leur ont été présentées. Aussi un tel mode d’apprentissage fonctionnera-t-il d’autant mieux que ces conditions ont été présentées sous une forme générale. De ce point de vue, on comprend que l’apprentissage de la résolution de problèmes de division à partir de problèmes-types ne fonctionne pas si mal lorsque les élèves s’appuient sur la formule : « a divisé par b, ou encore : En a combien de fois b ? ». Considérons le cas d’un élève qui, face à un nouveau problème, se pose la question de savoir s’il est dans l’un des deux cas auxquels cette formule renvoie. En reformulant l’énoncé du problème, il peut apprécier dans quelle mesure la situation décrite dans cet énoncé correspond à l’un des deux cas d’usage de la division explicités: « a divisé par b, ou encore : En a combien de fois b ? ». Cet élève peut ainsi apprendre à résoudre la plupart des problèmes élémentaires de division. Or, à l’époque, les élèves faisaient grand usage de cette formule, ne serait-ce que parce qu’elle est un outil permettant de mener à bien le calcul d’une « grande division ».
Le calcul d’une « grande division » et la conceptualisation de la division
Dans le cas général de la division par un nombre à plusieurs chiffres (par exemple : 15 967 : 25 ?), la technique de la division telle qu’elle était systématiquement enseignée en France avant 1970, nécessite de mettre en œuvre de manière coordonnée les deux procédures dont l’équivalence fonde la division (partage et groupement). Cette technique est reproduite ci-dessous avec quelques adaptations qui la rendent plus « moderne » (notamment parce que les soustractions sont posées) :
 |
Pour calculer cette division (15 967 : 25 ?), on imagine un scénario de partage successif des centaines, dizaines et unités (il n’y a que 15 milliers dans le nombre de départ, ce sont donc bien des centaines qu’il faut commencer à partager) :
- On est d’abord conduit à partager les 159 centaines du nombre de départ en 25 parts égales (q = 6 centaines chacun ; r = 9 centaines ou 90 dizaines).
- Puis il faut partager en 25 les dizaines restantes qui sont 96 : les 90 dizaines correspondant au reste partiel de 9 centaines et les 6 dizaines du nombre de départ (q = 3 dizaines et r = 21 dizaines ou 210 unités).
- Enfin, il faut partager les 217 unités restantes : q = 8 unités et r = 17.
La structure générale de la technique est donc du côté d’un partage successif des milliers, centaines, etc. Mais il est crucial de remarquer que chaque quotient partiel, lui, est obtenu très facilement en imaginant un groupement par 25 : « En 159 combien de fois 25 ? », « En 96 combien de fois 25 ? » et « En 217 combien de fois 25 ? ». On comprend pourquoi la tradition pédagogique incitait les enfants, à chaque étape, à dire : « 159 divisé par 25 ou encore : En 159 combien de fois 25 ? », etc.
L’intérêt de cet algorithme de calcul d’une division était mal exploité
Nous venons de voir que pour effectuer une division par un nombre à 2 chiffres dans le cas général où le quotient a lui-même plus de 2 chiffres, l’algorithme traditionnel conduit à mettre en œuvre de manière coordonnée les deux procédures dont l’équivalence fonde cette opération arithmétique : partage et groupement. Ce savoir-faire n’est donc nullement indépendant de la conceptualisation de la division en tant qu’opération arithmétique et cet apprentissage de l’algorithme de la division est potentiellement une occasion de progresser dans cette conceptualisation (contrairement à ce que disaient les auteurs des projets mort-nés de l’été 1999 : « Apprendre à faire une division est un travail formel qui n’éclaire pas le sens de cette opération »).
En fait, cet intérêt de l’algorithme traditionnel de calcul d’une division était mal exploité avant 1970, parce qu’une étude des manuels de l’époque montre que cette technique n’était pas enseignée en mettant en valeur cet aspect. À l’époque, on se refusait par exemple à poser les soustractions. Les calculs intermédiaires étaient plus complexes à mener et moins transparents quant à leur signification. Cela compliquait évidemment la compréhension de la démarche générale qui est adoptée dans cette technique : la coordination du partage et du groupement.
Reste que, comme nous l’avons vu plus haut, un grand nombre d’enfants mémorisaient, grâce à cet algorithme, la formule : « a divisé par b, ou encore : En a combien de fois b ? », et celle-ci favorisait chez eux le progrès dans la résolution de problèmes de division.
L’enseignement de la division avant 1970 n’est pas un « paradis pédagogique » perdu
Concernant la division, donc, l’enseignement tel qu’il se pratiquait avant 1970 est loin d’être un « paradis pédagogique » perdu. Il est critiquable de nombreux points de vue dont les principaux sont les suivants :
Critique n° 1 : les problèmes de groupement n’avaient aucune place durant les deux premières années d’école et, concernant les problèmes de partage, la résolution à l’aide de relations numériques connues était insuffisamment mise en relation avec une résolution par une action portant sur des objets physiques. On supposait que tous les élèves de cet âge savaient recoder : « 18 partagé en 3 » sous la forme : « 3 fois ? égalent 18 », ce qui est loin d’être le cas.
Critique n° 2 : les enseignants faisaient obstacle au progrès de certains élèves en assimilant sur une longue durée la division au partage et en utilisant les deux points et la potence comme simples abréviations sténographiques de « partager ».
Critique n° 3: l’équivalence entre partage et groupement n’était pas expliquée aux élèves de CE2.
Critique n° 4 : l’apprentissage de la résolution de problèmes se faisait seulement à partir de résolutions-types, ce qui légitime l’usage d’analogies superficielles.
Mais il faut dire aussi que cet enseignement avait ses points-forts :
Point-fort n° 1 : les élèves étaient incités de manière précoce à mémoriser des relations numériques. De plus, les pédagogues étaient attentifs à la façon dont s’articulent le format de mémorisation des tables de multiplication et la progression adoptée concernant la division.
Point-fort n° 2 : la technique opératoire retenue avait l’avantage de se fonder sur un usage coordonné du partage et du groupement et d’utiliser une formule : « a divisé par b, ou encore : En a combien de fois b ? » qui aide à apprendre à résoudre des problèmes à partir de résolutions-types.
Un exemple d’enseignement de la division tel qu’il se fait souvent aujourd’hui
Il serait incompréhensible qu’on revienne à la forme d’enseignement qui vient d’être présentée parce que de nombreux enseignants utilisent aujourd’hui des progressions qui ont été élaborées à partir d’une analyse critique des pratiques pédagogiques d’avant 1970. Ces progressions conservent les points-forts de cet enseignement et en évitent les faiblesses : elles substituent aux pratiques pédagogiques critiquées plus haut, d’autres qui favorisent mieux la conceptualisation, c’est-à-dire l’appropriation par les élèves de l’équivalence entre partage et groupement. C’est une de ces progressions qui est présentée succinctement ci-dessous. D’autres sont évidemment imaginables.
Au CP et au CE1 : résoudre des problèmes de partage et de groupement
Les enseignants savent fort heureusement aujourd’hui qu’il n’est pas nécessaire d’avoir fait des leçons sur la division pour pouvoir proposer aux élèves des problèmes de partage et de groupement : ils les résolvent en simulant ce qui est dit dans l’énoncé soit par l’action avec du matériel (ou en faisant un schéma papier-crayon), soit par une procédure de comptage, soit en utilisant des relations numériques connues.
Dans la progression présentée ici, dès le CP, les élèves résolvent ainsi des problèmes de groupement ; ils apprennent à considérer que l’unité d’un comptage peut être une pluralité, et à utiliser des relations numériques connues pour résoudre ce type de problèmes.
Au CP, de même, ils résolvent des problèmes de partage en simulant la distribution. Considérons par exemple le problème : « On partage 19 images entre 3 enfants en faisant des parts égales. Combien d’images chaque enfant va-t-il recevoir ? ». Les enfants peuvent dessiner 3 bonshommes et procéder à la distribution de 19 jetons.
Considérons le cas particulier d’un partage avec reste nul : « On partage 18 objets en 3 parts égales… », par exemple. L’apprentissage des tables de multiplications est au programme du CE1. Or, de nombreux enseignants continuent aujourd’hui à enseigner ces tables sous la forme traditionnelle (pour la table de 3 : « 3 fois 1, 3 », « 3 fois 2, 6 », etc.) parce que divers arguments conduisent à penser que c’est cette forme qui favorise le mieux la mémoriation (10) (Brissiaud, 1994) et parce que, comme nous l’avons vu, cette forme est celle qui favorise le mieux la résolution numérique des problèmes de partage. Le problème de partage de 18 objets en 3 parts égales est recodé sous la forme « 3 fois ? font 18 », ce qui active la relation numérique : « 3 fois 6, 18 ».
Mais à aucun moment, au CE1, les enfants ne rencontrent le mot « divisé » et les symboles qui l’accompagnent. Les critiques n° 1 et n° 2 faites plus haut à la progression d’avant 1970 n’ont donc plus de raison d’être avec cette nouvelle progression alors que le point-fort n° 1 s’y trouve préservé.
Au CE2, introduire le mot « division » et sa symbolisation (par les deux points) dans une situation de groupement
Au CE2, le jour où l’on va annoncer aux élèves qu’ils vont apprendre ce qu’est la division et qu’ils vont apprendre la façon dont on note cette opération (les deux points), il semble difficile de leur enseigner en une seule leçon les deux usages de la division, comme cela se faisait avant 1970 (cf. l’extrait de livre plus haut). Si l’on veut que les élèves découvrent l’équivalence entre groupement et partage et en comprennent les raisons, cela ne peut pas se faire en une seule séquence. Il faut donc choisir la signification qui sera privilégiée ce jour-là : groupement ou partage ?
Comme nous allons le voir, il est plus simple d’enseigner l’équivalence dans le sens « groupement –> partage » que dans le sens « partage –> groupement ». Il est donc préférable que la première rencontre des élèves avec la division se fasse dans un contexte de groupement. Ce jour-là, il est possible d’utiliser une situation d’anticipation comme la suivante : une collection de 163 cubes est formée (avec des cubes emboîtables, les élèves se répartissent le travail, ils forment 16 barres de 10 cubes et y ajoutent 3 cubes isolés, avant de mettre l’ensemble dans une boîte opaque). Le problème est posé : on va former des groupes de 25 avec ces 163 cubes. Combien peut-on former de groupes de 25 ? Restera-t-il des cubes isolés ? Remarquons ici que dans 163, il y a « peu de fois » 25 (4 fois 25, 100 ; 6 fois 25, 150) ! Ce problème de groupement est donc du type G1 (40 objets groupés par 10), c’est un problème facile à résoudre en simulant mentalement le groupement : le jour où l’on prononce par la première fois le mot « division » à l’école, il vaut mieux le faire dans le contexte de la résolution d’un problème facile que difficile !
Ayant obtenu la solution numérique, on vérifie collectivement en mettant en œuvre le groupement et on dit aux élèves que ce qu’ils viennent de calculer s’appelle une division ; cette opération est définie ainsi :
| « Diviser 163 par 25, c’est chercher deux nombres : 1°) Combien de fois il y a 25 dans 163, ce nombre s’appelle le quotient (q) 2°) Le reste (r) On note : 163 : 25 ? q = 6 (c’est le nombre de fois) et r = 13 (c’est le reste) On peut écrire l’égalité suivante : 163 = (25 x 6) + 13 » |
Avec d’autres problèmes du même type (type G1), les enfants apprennent à calculer le quotient et le reste. Ils calculent par exemple, le quotient et le reste de :
Dès ce moment, supposons qu’on propose la suite d’exercices suivants aux élèves :
| 232 : 50 ? | 64 : 10 ? | 827 : 100 ? | 139 : 25 ? | 57 : 10 ? |
Remarquons, encore une fois, que toutes ces divisions se calculent facilement si on se réfère à un groupement (les nombres sont choisis de sorte que le diviseur est contenu « peu de fois » dans le dividende et les multiples du diviseur : 50, 10, 100, 25 sont faciles à calculer).
Au CE2 (2 semaines plus tard), découvrir l’équivalence entre partage et groupement
À ce moment de la progression, les élèves ne savent pas encore que la division permet de résoudre des problèmes de partage (les parents de certains élèves leur ont dit que : « diviser c’est partager », mais ils ne font pas encore le lien avec la division-groupement qu’ils viennent d’apprendre à l’école). Pour qu’ils découvrent cette autre signification de la division, on va leur proposer à nouveau un problème d’anticipation, mais de partage cette fois : il s’agit d’anticiper le résultat du partage de 137 cubes entre 25 élèves, par exemple. Il est important de noter que le recodage de ce problème sous la forme : « 25 fois ? égale 137 » n’active évidemment aucune égalité numérique (pour deux raisons : 5 fois 25 est mieux connu que 25 fois 5, mais aussi à cause du reste). Le fait d’imaginer le partage réalisé ne conduit donc pas à la solution numérique ; les élèves sont ainsi incités à trouver une autre stratégie : ils vont découvrir qu’une stragégie de groupement, elle, peut conduire très simplement à la solution.
Présentons de manière plus précise la façon dont cette découverte s’effectue. Une collection de 137 cubes est donc rassemblée dans une boîte opaque (on procède comme cela est décrit plus haut, en répartissant le travail). Dans la classe, 25 élèves restent assis, les autres se lèvent pour aider l’enseignant à réaliser le partage. Pour partager équitablement les 137 cubes entre les 25 élèves assis, que faut-il faire ? On donne 1 cube à chacun de ces élèves et on s’arrête aussitôt pour le faire le point.
Pour continuer, il faudrait donner un autre cube à chacun des 25 élèves, mais on ne le fait pas : chaque élève a 1 cube devant lui (pour cela il a fallu en retirer 25 du stock de 137 cubes initial) et il doit anticiper combien il en aurait si on achevait la distribution.
Chaque élève a la possibilité de raisonner ainsi : « Pour qu’on me donne un autre cube, il faut en retirer encore 25 du stock restant ; pour m’en donner un de plus, il faut encore en retirer 25… ». L’élève est conduit à comprendre que 1 pour lui correspond à 25 prélevés dans le stock et, donc, à chercher combien de groupes de 25 il y a dans 137 : « En 137, combien de fois 25 ? ». Le problème proposé était un problème de partage, mais il se résout comme un problème de groupement, c’est-à-dire, comme cela a été vu précédemment, comme un problème de division.
Cette propriété a évidemment besoin d’être généralisée en considérant d’autres valeurs numériques (67 objets partagés entre 10 personnes, par exemple). La mise en scène pédagogique précédente présente l’intérêt de favoriser une telle généralisation : l’élève peut se dire que dans tous les cas, lorsqu’il est l’un des bénéficiaires d’un partage équitable, que ce soit en 25 parts ou en 10 parts, 1 objet pour lui correspond à une distribution de 25 ou de 10 objets pour l’ensemble des élèves. Pour connaître la valeur de sa part, il doit donc s’interroger sur le nombre de distributions de 25 ou de 10 qu’il est possible de faire.
Dès ce moment, les élèves peuvent résoudre des problèmes tels que « On partage 189 objets en 50 parts égales. Quelle est la valeur d’une part ? ». Ils posent la division correspondante à l’aide des deux points. L’écriture 189 : 50 ? avec comme solution q = 3, r = 39 leur donne la solution du problème. On remarquera qu’à ce moment, les élèves ne disposent pas encore de moyen systématique pour calculer des divisions par 3, 4, 5…
Au CE2 (2 semaines plus tard), découvrir la division posée en potence et la faire fonctionner comme symbole de l’équivalence entre le groupement et le partage
Il suffit dès lors de confronter les élèves à des problèmes du type : « On partage 589 objets en 3 parts égales… » pour qu’ils apprennent à diviser par 3, 4, 5…. En effet, deux semaines plus tôt environ, ils ont vu qu’un tel problème peut être résolu par la division 589 : 3 ? Comment calculer une telle division ? En se demandant : en 589, combien de fois 3 ? Mais 589 contient beaucoup de fois 3 et cela risque d’être très long ! Mieux vaut s’imaginer le partage. Le recodage « 3 fois ? égale 589 » ne donne pas non plus la solution. D’où l’idée de procéder méthodiquement en partageant successivement les centaines, dizaines et unités. Au début, les élèves s’aident d’un matériel de numération ; assez rapidement, ils s’imaginent l’usage d’un tel matériel pour contrôler leur travail sur les écritures chiffrées : ils apprennent à calculer une division « posée en potence ».
Dès ce moment, supposons qu’on propose la suite d’exercices suivants aux élèves :
| 232 : 5 ? | 94 : 10 ? | 827 : 3 ? | 139 : 25 ? | 40 : 4 ? |
Ils vont calculer différemment ces divisions selon les valeurs numériques : les divisions par 10 et 25 seront faites mentalement et directement par une procédure de groupement, alors que les divisions par 5, 3 et 4 seront soit posées (comme pour 232 : 5 ? ou 827 : 3 ?) et leur calcul organisé avec la potence (partage successif des centaines, dizaines et unités), soit recodées sous la forme « b fois ? égale a » (comme pour 40 : 4 ?). Dès ce moment, les élèves font ainsi fonctionner les deux points comme symbole de l’équivalence entre le partage et le groupement.
Dès le CM1, les élèves apprennent à calculer une division par un nombre à 2 chiffres (9 786 : 25 ?, par exemple) et ils apprennent la technique traditionnelle, celle où chaque calcul intermédiaire s’exprime : « 97 divisé par 25 ou encore : En 97, combien de fois 25 ? ». De plus, en posant les soustractions, on rend le plus transparent possible le fait que, dans cette technique, chaque calcul partiel est du côté du groupement. En effet, la soustraction 97 – 75 figure explicitement dans le calcul. Le nombre 75, dans cette soustraction, est la marque d’une recherche de « fois 25 ». Lorsque la soustraction est calculée directement, comme c’était le cas avant 1970, cette recherche ne laissait pas de trace écrite directement interprétable. Ainsi, dans la technique traditionnelle aménagée de cette manière, il est plus clair que les calculs partiels sont du côté du groupement ; comme la structure générale de l’action y est du côté du partage, cette technique amène à utiliser de manière coordonnées les deux procédures dont l’équivalence fonde la division. Le point-fort n°2 de la progression d’avant 1970 est conservé, il est même amplifié.
Une progression qui se fonde dans une démarche constructiviste…
Rappelons-nous la critique n° 3 qui a été faite à la progression adoptée avant 1970 : l’équivalence entre partage et groupement n’était pas expliquée aux élèves de CE2. Or, dans la progression qui vient d’être rapportée, la plupart des élèves découvrent cette équivalence. Le point-clef de cette découverte est la prise de conscience de deux propriétés d’une procédure de distribution :
1°) Lorsque, pour réaliser un partage en n parts égales, on procède à une distribution un à un, chaque tour de distribution est un groupe de n.
2°) Il y a autant d’unités dans une part qu’il y a de groupes de n dans le stock initial.
Lorsqu’une personne effectue une distribution, elle ne prend généralement pas conscience qu’un tour de distribution est un groupe de n parce qu’elle n’a pas à s’interroger sur le nombre d’objets correspondant à un tour : elle dispose en effet d’un indice perceptif qui lui signale la fin d’un tour (le tour en cours est achevé quand la dernière personne a été fournie). La mise en scène pédagogique décrite plus haut permet de focaliser l’attention des élèves sur cette propriété d’une distribution, cruciale si l’on veut aider les élèves à relier partage et groupement.
Remarquons qu’il s’agit d’une démarche constructiviste. Il est important de rappeler que le mot « constructiviste », avant d’être utilisé comme injure par certains réseaux qui disent lutter contre les « pédagogistes constructivistes », est un terme technique en psychologie. Quand il s’agit du constructivisme piagétien, ce mot renvoie à l’idée que le progrès, en mathématiques notamment, se réalise d’abord en actes et qu’il nécessite ensuite, pour émerger socialement, des processus de prise de conscience et de symbolisation. Prises de conscience et symbolisations permettent ainsi la conceptualisation qui correspond au moment où « la compréhension de l’action vient rattraper sa réussite » (Piaget, 1977).
Quelle critique est-il possible de faire à la progression qui vient d’être présentée ? Il y en a une qui vient immédiatement à l’esprit : le raisonnement qui permet de prendre conscience qu’une distribution en n parts égales est aussi, de fait, un groupement par n, est-il accessible à tous les enfants de CE2 ? Le phénomène de prise de conscience qui a été décrit se produit-il chez tous les élèves ?
Remarquons d’abord qu’une telle interrogation justifie qu’on ne propose pas ce genre de séquence au CE1. Aujourd’hui, dès que les responsables de la politique éducative de notre pays écrivent des directives, ils utilisent la locution « le plus vite possible » pour qualifier l’apprentissage de tel ou tel savoir-faire. Il est donc important de rappeler que certains raisonnements sont plus accessibles à un élève de CE2 qu’à un élève de CP ou de CE1. Par ailleurs, à la question posée, il faut assurément répondre qu’il faudrait être bien naïf pour penser que l’ensemble des élèves de CE2 sortent d’une séance comme celle qui a été décrite en ayant compris les raisons de l’équivalence entre le partage en n parts égales et le groupement par n. Mais de nombreux élèves l’ont comprise et ceux-là progressent en mathématiques en fondant leur comportement en raison.
…mais une progression qui laisse aussi ouverte la possibilité d’apprendre à partir de résolutions-types
Une question reste en suspens : qu’advient-il pour les élèves qui, lors de la séance décrite précédemment n’ont pas compris les raisons de l’équivalence entre le partage en n parts égales et le groupement par n ? Une première réponse consiste à dire que ce type de séquence peut être repris pratiquement à l’identique en CM1. Reprendre deux années de suite un même type de leçon n’a scandaleux. Dans le cas présent, cela crée une nouvelle occasion pour que le plus grand nombre d’élèves comprennent ce qui fonde la division en tant qu’opération arithmétique. Et revoir une fois la même leçon ne peut pas encore être source d’ennui (il suffit de consulter les manuels d’avant 1970 pour s’apercevoir que la répétition de leçons à l’identique d’une année sur l’autre avait cours depuis le CE1 jusqu’au CM2 !).
Mais une autre réponse peut également être avancée : dans cette progression, lorsque le progrès ne se déroule pas comme on pourrait l’espérer, ce n’est pas si grave parce que tout est fait pour que l’autre forme d’apprentissage de la résolution de problèmes, l’apprentissage à partir de résolutions-types, puisse avoir lieu, comme avant 1970 et, même, mieux qu’à cette époque. En effet, tous les points-forts de la progression d’avant 1970, ceux qui expliquaient que des élèves apprenaient à résoudre des problèmes de division à cette époque, sont toujours présents :
- accent mis sur la connaissance précoce de relations numériques,
- accent mis sur la connaissance précoce de relations numériques,
- attention portée à la façon dont s’articule le format de mémorisation des tables de multiplication et la progression adoptée concernant la division,
- formulation explicite de l’équivalence entre procédures de partage et de groupement à travers l’apprentissage de la formule : « a divisé par b, ou encore : En a combien de fois b ? », dont on a vu qu’elle permet à certains élèves, face à un nouveau problème, de savoir s’ils sont ou non dans un cas d’utilisation de la division.
De plus, la progression qui vient d’être présentée favorise mieux que les précédentes cette forme d’apprentissage de la résolution de problèmes, parce que les élèves y sont mis en garde contre l’usage d’analogies superficielles.
Une progression qui met en garde l’élève contre l’usage d’analogies superficielles
Depuis une quinzaine d’années environ, il est devenu courrant de proposer des problèmes de partage ou de groupement au CP et au CE1, c’est-à-dire avant d’enseigner explicitement la division. Il faut insister sur le fait que cela a constitué une véritable rupture dans la tradition pédagogique. Auparavant, en effet, la pratique professionnelle dominante reposait sur une idée qui est faussement de « bon sens » : on ne peut proposer de tels problèmes qu’après avoir étudié cette opération (ce que de nombreux parents croient encore aujourd’hui). On sait de même aujourd’hui que les enfants savent résoudre des problèmes de proportionnalité ou de fractionnement avant d’avoir étudié en classes les savoirs correspondants.
Cette « révolution pédagogique » a ouvert la possibilité d’une pratique particulièrement intéressante. Supposons qu’au CE2, par exemple, un enseignant organise une séance de résolution de problèmes. Il a la possibilité de mélanger des problèmes que les élèves peuvent résoudre en reconnaissant la ou les opérations arithmétiques conduisant à sa solution (addition, soustraction, multiplication, division) avec des problèmes de proportionnalité ou de fractionnement que les élèves ne peuvent pas résoudre ainsi. De ce fait, l’enfant ne sait pas a priori à quel type de problème il a affaire. Cela a la conséquence importante de l’inciter, pour chaque problème, à construire un modèle mental de la situation décrite dans l’énoncé et ainsi d’éviter le dysfonctionnement classique où l’élève sélectionne une opération sur des indices superficiels (sur un « mot-clef », notamment) (11). Supposons que dans une telle séance, on glisse le problème suivant : « 6 enfants se partagent équitablement un paquet de gâteaux ; chacun d’eux reçoit 4 gâteaux. Combien y avait-il de gâteaux dans le paquet ? ». Les élèves risquent beaucoup moins qu’avant 1970 d’utiliser la division au motif que, dans l’énoncé, figure le mot « partage ». Dans ce genre de progression, les enfants sont mis en garde contre l’usage d’analogies superficielles.
Résumons : cette progression offre les mêmes possibilités d’apprentissage du « bon usage » de la division que celles que les enseignants utilisaient avant 1970 ; des améliorations sensibles y sont mêmes apportées, qui incitent à penser que cette forme de progrès y est mieux prise en compte. Mais surtout, cette progression offre une autre possibilité d’apprentissage du « bon usage » de la division : un apprentissage fondé sur la compréhension des raisons de ce « bon usage » (l’équivalence entre le partage en n parts égales et le groupement par n). Pourquoi faudrait-il revenir à la progression d’avant 1970 ? Pourquoi faudrait-il rétablir une pédagogie dont les graves insuffisances avaient précisément conduit les mathématiciens et les pédagogues des années 60 à explorer les chemins d’une rénovation générale ?
La division et les programmes de 2002
Procédures « personnelles » ou procédures de simulation de la situation ?
Commençons par présenter ce qui paraît le point-fort des programmes de 2002 : dans ces programmes, les locutions les plus utilisées sont vraisemblablement les expressions : « procédures personnelles » et « solutions personnelles ». En employant ces locutions, les auteurs insistent sur le fait qu’avant tout enseignement des différentes opérations arithmétiques, les enfants peuvent résoudre des problèmes qui, pour eux, sont inédits. Nous avons déjà souligné l’importance de cette idée et présenté la « révolution » qu’elle a permis de réaliser dans la culture pédagogique. Il y a donc là assurément une idée à mettre au crédit des auteurs des programmes.
Mais pourquoi appeler ces procédures « personnelles » ? Seraient-elles propres à chaque élève au sens où chacun d’eux sélectionnerait une procédure en fonction de sa personnalité ? Certainement pas ! Les résultats scientifiques sont de ce point de vue sans ambiguïté : on n’a jamais vu un enfant qui n’a pas bénéficié d’un enseignement de la division, résoudre un problème de groupement par une procédure de partage (et réciproquement). Insister sur ce fait, c’est insister sur le principal des enjeux de la scolarisation : que les enfants apprennent à résoudre un problème de groupement comme s’il s’agissait d’un problème de partage (et réciproquement). Lorsqu’on souhaite que les enseignants prennent la mesure de ce qui est leur responsabilité professionnelle, dans le même temps qu’il faut souligner ce que les enfants savent faire avant tout enseignement, il faut souligner ce qu’ils ne savent pas faire et dépend de leur scolarisation. De fait, lorsqu’on examine en détail les programmes et leurs documents d’application, on s’aperçoit qu’ils sont silencieux concernant l’enjeu majeur de la scolarisation concernant la division : la conceptualisation de cette opération.
Des programmes silencieux concernant la conceptualisation de la division
Si l’on considère l’ensemble formé par les programmes des cycles 2 et 3 en eux-mêmes et par leurs documents d’application, il contient 108 pages : dans aucune d’elles il n’est dit que la propriété essentielle de la division est d’être un traitement commun aux problèmes de groupement par n et de partage en n parts égales.
Dans ces documents, de nombreuses pages sont consacrées au calcul mental en général mais à aucun moment il n’y est dit que les compétences en calcul mental d’une division dépendent de manière cruciale de l’appropriation de l’équivalence entre le groupement et le partage (c’est-à-dire de la conceptualisation de cette opération).
Dans ces documents, de nombreuses pages sont consacrées à l’étude du rôle du langage dans l’activité mathématique, mais à aucun moment n’est souligné le fait qu’une phrase comme : « a divisé par b, ou encore : En a combien de fois b ? » est susceptible de favoriser le progrès en résolution de problèmes de division. À aucun moment non plus n’est souligné le fait que le format d’apprentissage des tables de multiplication doit être pensé en relation avec l’apprentissage du calcul mental d’une division avec reste nul.
Concernant le symbolisme qu’il convient d’utiliser pour enseigner la division, il est spécifié dans les documents d’application que l’apprentissage des divisions posées en potence doit commencer au CM2. De plus, il est dit (p. 27) que : « Pour la division euclidienne, il n’existe pas de signe conventionnel pour le quotient entier. Pour rendre compte complètement du calcul (quotient entier et reste), l’égalité caractéristique de la division est utilisée : 37 = (5 x 7) + 2 ». Les programmes ne recommandent donc pas l’utilisation d’une écriture comme « 37 : 5 ? », où apparaissent les deux points lus « divisé par » et où le signe « = » est remplacé par un point d’interrogation (la réponse étant formée du couple de nombres q = 7, r = 2). Mais à aucun moment, les programmes ne signalent une difficulté majeure : lorsqu’on suit les recommandations du programme, les élèves, avant le CM2, ne disposent d’aucun symbole pour désigner la division avec reste (à la différence des autres opérations). Ils n’ont ni la potence, ni les deux points à leur disposition. Comment peut-on espérer favoriser l’appropriation par les élèves de l’équivalence entre le partage en n parts égales et le groupement par n, si l’on ne dispose d’aucun symbole spécifique de cette équivalence ?
Si l’on s’intéresse à d’autres documents annexes qui se dénomment : les « documents d’accompagnements » des programmes, on se trouve face à un ensemble plus important encore, qui contient 166 pages consacrées aux cycles 2 et 3. Dans cet ensemble seules 6 lignes parlent de la conceptualisation de la division. Elles sont dans le chapitre des documents d’accompagnement consacré au « calcul posé à l’école élémentaire » (p. 54) et disent que le calcul posé d’une division (programmé, rappelons-le, par ces mêmes documents au CM2) nécessite comme préalable : la « maîtrise des deux sens de la division : « quelle est la valeur de chaque part ? » (diviser 2 782 par 26, revient à partager 2782 en 26 parts égales et chercher la valeur d’une part), « combien de fois » (diviser 2 782 par 26, revient à chercher combien de fois 26 est contenu dans 2 782).
Serait-ce parce que les auteurs des programmes pensent que « la maîtrise des deux sens » de la division est un préalable à l’apprentissage du calcul posé qu’ils ont décidé de repousser cet apprentissage au CM2 ? On comprendrait mal pourquoi ! En effet, lorsqu’on utilise la technique classique, la division par un nombre à un chiffre est entièrement située du côté du partage, c’est seulement lorsqu’on divise par un nombre de 2 chiffres ou plus qu’il faut articuler partage et groupement au sein de la même technique. Vérifions-le sur cet exemple :
 |
Pour comprendre ce calcul, il faut imaginer les partages successifs suivants : on partage les 4 centaines de 472 en 3 parts égales (1 centaine chacun et il reste 1 centaine, c’est-à-dire 10 dizaines), puis on partage les 17 (10 + 7) dizaines restantes en 3 (5 dizaines chacun et il reste 2 dizaines, c’est-à-dire 20 unités), etc. Même si tous les enfants ne maîtrisent pas les « deux sens » de la division au CE2, on voit mal pourquoi on ne pourrait pas commencer l’apprentissage de cette technique dès ce moment de la scolarité. Par ailleurs, et plus fondamentalement, nous avons vu que lorsqu’on s’intéresse à l’articulation entre calcul et conceptualisation, le progrès en calcul peut être à la source de la conceptualisation comme il peut la consolider. Il n’y a donc pas de raison de faire de la conceptualisation un préalable absolu.
Pour comprendre ce silence, il faut étudier les ouvrages de l’équipe ERMEL (12)
Concernant la division, les choix faits dans les programmes de 2002 semblent donc très surprenants. Or, d’une façon générale, pour comprendre les raisons des choix qui sont cesssux des programmes de 2002, il convient de se reporter à la série d’ouvrages qui rapportent le contenu d’une recherche-innovation qu’ERMEL a menée les années précédant la publication des programmes.
Ce qui surprend d’emblée, lorsqu’on examine les trois ouvrages ERMEL consacrés respectivement au CE2 (1995), au CM1 (1997) et au CM2 (1999), c’est que chaque année, les élèves y apprennent une manière différente de calculer une division. Au CE2, on lit (p. 204) : « une procédure clé au CE2 : les tests d’hypothèses, les essais de multiples (procédure par essais d’une succession de multiples du diviseur en vue d’atteindre le dividende )». Pour 98 œufs groupés dans des boîtes de 6, par exemple, les enfants essaient des multiplications : 20 x 6 = 120, c’est trop ; 15 x 6 = 90, ce n’est pas assez…
Au CM1, pour aller vers un algorithme de la division, les élèves sont placés dans une situation de partage. Dans un premier temps, ils sont, là encore, invités à faire des essais, mais ils ne tentent plus de s’approcher du dividende en une seule multiplication : la situation de partage les amène à simuler mentalement une distribution d’abord de grands nombres, puis de plus petits. Dans le cas de 1355 divisé par 8, par exemple, cela conduit à la disposition présentée ci-dessous à gauche (en 1997, date de parution de ERMEL CM1, les programmes ne recommandaient pas encore de ne pas poser de division à ce niveau de la scolarité). Ensuite, toujours au CM1, les enfants sont invités à faire le moins de soustractions possibles comme dans le cas de 11 394 divisé par 14 qui est reproduit ci-dessous à droite.
 |
Une question se pose évidemment : comment, dans le cas de la division de 11 394 par 14, les enfants trouvent-ils qu’on peut d’emblée donner 800 objets à chaque personne? Ils construisent une table des multiples de 14 (2 x 14 = 28 ; 3 x 14 = 42 ; 4 x 14 = 56, etc.) et ils en déduisent les produits : 20 x 14 = 280 ; 200 x 14 = 2800, etc.
Or, au CM2, les enfants apprennent à calculer une division… de manière classique, en partageant successivement les milliers, centaines, dizaines et unités, c’est-à-dire sans écrire tous les zéros qui figurent dans les divisions précédentes. Quelle est l’utilité de changer chaque année de technique ? Si les enfants avaient appris dès le CE2 à calculer, dans des cas simples, une division par partages successifs des centaines, dizaines et unités, n’est-il pas raisonnable de penser qu’ils auraient mieux su faire une division à la fin de l’école primaire et que, de plus, il n’aurait pas été nécessaire d’y consacrer autant de temps ?
Plus précisément, il faut y étudier la façon dont les enfants apprennent à résoudre des problèmes de division
Le choix fait dans ERMEL concernant la technique de la division paraît particulièrement contre intuitif. En fait, il s’explique lorsqu’on examine la façon dont les auteurs conçoivent l’apprentissage de la résolution des problèmes de division.
Ainsi, dans l’ouvrage de CM1 (p. 227), on lit que :
« En résumé, dans les pratiques courantes, pour aider l’élève à reconnaître une situation de division, l’enseignant se réfère à :
- un modèle numérique décontextualisé (celui de la « multiplication à trou ») ;
- des indices sémantiques relatifs à des situations-type : réalisation d’un partage ou de groupements équipotents (de même nombre d’éléments) ;
- des questions auxquelles répond l’opération : « combien à chaque fois ? » ou « combien de fois ? ».
Or ERMEL critique chacune de ces trois possibilités et la rejette. L’usage du modèle numérique de la « multiplication à trou » est critiqué de manière très pertinente : « comment passer de l’écriture multiplicative ? x b = c à la division ? S’il n’y a aucun aspect sémantique, aucune traduction dans cette transformation, faut-il diviser b par c ou c par b ? ». Les deux possibilités suivantes sont rejetées parce qu’ elles « privilégient la recherche directe de la bonne opération, ce qui est une démarche dangereuse » (nous reviendrons plus loin sur ce point).
Que propose ERMEL à la place ? Les auteurs proposent (CM1, p. 228) de laisser les enfants utiliser plusieurs modèles numériques (l’exemple choisi est celui d’un problème qui pourrait être résolu par la division de 350 par 12) :
- essai de multiples de 12 en vue d’atteindre 350 (éventuellement, exploration d’une table de multiplication),
- addition de multiples de 12 en vue d’atteindre 350 (faire 350 avec des multiples de 12),
- soustraction de multiples de 12 à partir de 350 (extraire de 350 les multiples de 12 qu’il contient).
Alors qu’il s’agit de reconnaître que la division est un traitement commun à des situations diverses, ERMEL propose donc de laisser les enfants utiliser une pluralité de traitements. Les auteurs lèvent ce paradoxe : ils pensent que, progressivement, les enfants construiront des équivalences entre ces différents traitements et, donc, qu’un traitement commun, finalement, émergera. Un calendrier est même fourni (CM1, p. 228) :
| Multiplication à trou : ? x b = a | CE2, CM1, CM2 |
| Addition de multiples de b | CE2, CM1, CM2 |
| Soustraction de multiples de b (progressivement optimisée) | CM1, CM2 |
| Technique usuelle (partage des mille, cents…) | CM2 |
On reconnaît dans ce calendrier les différentes étapes censées conduire à la technique traditionnelle. Un dernier point doit être précisé pour comprendre les propositions théoriques d’ERMEL concernant la division : son rejet d’une éventuelle utilisation pédagogique des situations-types de partage en n parts égales d’une part et de groupement par n de l’autre, s’explique en grande partie par cette conviction qui explicitée p. 223 du CM2 :
« Un objectif majeur concernant la compréhension de la division porte sur l’équivalence des deux problèmes « partager A en B parties (de même nombre) ; combien à chacun ? » et « en A combien de fois B » qui amènent tous deux la division de A par B. Ce point ne peut être mis en évidence à partir d’une analyse sémantique de la situation.» (la mise en gras est de mon fait)
Une analyse critique du point de vue d’ERMEL
Cette analyse tient en quatre points. Dans les deux premiers, on note que les auteurs d’ERMEL se trompent quand ils considèrent que la seule progression possible concernant la division qui soit de nature constructiviste est celle qu’ils proposent. En effet :
1°) Il est faux de considérer qu’une analyse sémantique d’une situation de partage ne peut pas conduire les enfants à prendre conscience de l’équivalence entre les procédures de partage en n parts égales et celles de groupement par n. Nous avons explicité dans ce texte une situation pédagogique qui, dès le CE2, permet chez de nombreux enfants cette prise de conscience. L’élément clé est le fait que dans une distribution 1 à 1 destinée à partager en n parts égales, chaque tour de distribution est un groupe de n. Il y a donc autant d’unités dans une part qu’il y a de tours de distribution possibles, c’est-à-dire de groupes de n dans le stock initial. ERMEL, apparemment, ne connaissait pas en 1999 cette possibilité d’analyse sémantique alors que de nombreux professeurs d’écoles l’utilisaient déjà dans leur classe (Brissiaud et collègues, 1996).
2°) Il est faux de considérer que la référence explicite aux deux principaux types de situations de division conduit nécessairement les enfants à dysfonctionner parce qu’ils cherchent « la bonne opération » permettant de traiter le problème. En effet, chercher « la bonne opération » permettant de traiter un problème nouveau n’est pas dangereux en soi ; ce qui est dangereux c’est lorsque cette recherche se fait à partir d’indices superficiels, alors que l’élève, parfois, n’a même pas construit une représentation singulière de la situation décrite dans l’énoncé. Et ce qui est très dangereux, c’est lorsque l’enfant, face à un problème, n’envisage même pas la possibilité de le résoudre par une procédure proche d’une simulation de la situation décrite dans l’énoncé parce qu’il pense qu’en mathématiques, il faut nécessairement « chercher la bonne opération ». Or on dispose d’un moyen didactique pour éviter ce dysfonctionnement : le mélange de problèmes qui peuvent être résolus aisément en cherchant la bonne opération avec d’autres qui rendent impossible ce fonctionnement
Dans les deux points suivants sont soulignées les difficultés importantes que rencontrera tout enseignant qui tentera de mettre en œuvre la progression décrite dans ERMEL :
1°) Abrose, Baek et Carpenter (2003) ont mené une recherche où ils analysent le fonctionnement d’élèves qui sont mis dans des situations de résolution de problèmes de multiplication et de division dans les conditions que décrit ERMEL. Le compte-rendu de leurs observations montre que les élèves, lorsqu’ils doivent résoudre un problème de partage, conservent cette situation de partage présente à l’esprit tout au long de la résolution et cela les empêche souvent de mettre en œuvre des procédures qui seraient celles qu’ils utiliseraient dans la situation de groupement correspondante. Aussi, le rapprochement entre les deux types de modèles numériques pour que, finalement, les enfants comprennent que les deux types de situations relèvent d’un traitement commun, est-il loin d’aller de soi.
2°) La même recherche montre qu’il n’y a pas de continuité entre les procédures où les enfants travaillent sur des nombres qui ne sont pas décomposés en milliers, centaines… et les procédures où ils utilisent cette décomposition. Aussi l’aspect « constructif » de la progression proposée par ERMEL est-il loin d’apparaître à tous les élèves qui sont engagés dans une telle progression. De nombreux élèves apprennent péniblement à gérer des soustractions successives de nombres non décomposés en milliers, centaines, dizaines et unités au CM1 et, au CM2, ils doivent avoir l’impression très désagréable de repartir de zéro!
En conclusion, il faut souligner qu’à la lecture des chapitres qui sont consacrés à la division dans les trois ouvrages ERMEL, on comprend bien la façon dont le progrès des élèves y est envisagé et, donc, le « pari pédagogique » correspondant. On comprend aussi le silence des programmes : le propos y est complexe et il n’est pas simple d’expliquer cette démarche, les raisons pour lesquelles elle a des chances d’aboutir. S’ils rapportaient cette démarche, les programmes devraient aussi expliquer aux enseignants pourquoi elle « vaut le coup » d’y consacrer autant d’énergie. Or, cela semble difficile parce qu’il est loin d’être évident que cette progression, même très bien menée, conduise à de meilleurs résultats qu’une autre qui s’appuie sur une analyse sémantique des situations de partage en n parts égales, de façon à les comprendre en tant que situations de groupement par n.
Les recherches scientifiques disponibles soulignent les difficultés du « pari pédagogique » que fait ERMEL concernant la division, mais elles ne conduisent nullement à penser qu’il est intenable. Sur ce point, alors que j’ai beaucoup écrit, lors de la polémique récente sur les méthodes de lecture, contre l’interdiction de la méthode naturelle d’écriture-lecture (13), je serais inconséquent si je demandais de rejeter la démarche proposée par ERMEL, dès lors qu’un enseignant est capable de la mener à bien.
En revanche, que penser des programmes de 2002 ? Leur document d’application, en disant qu’il ne faut pas poser de division avant le CM2, se situe très clairement dans le cadre de la progression décrite par ERMEL, progression dont nous venons de voir combien elle est difficile à mettre en œuvre. Je suis loin de penser que cette progression a, pour la conceptualisation de la division, les qualités de la méthode naturelle d’écrire-lecture pour la conceptualisation de l’écrit. Mais supposons un instant que ce soit le cas. Qu’aurait-on dit des programmes de 2002 concernant l’écrit s’ils avaient imposé l’usage de la méthode naturelle d’écriture-lecture, sans alerter les enseignants sur les difficultés de mise en œuvre d’une telle méthode et en étant silencieux sur la façon dont s’effectue le progrès dans cette méthode ? Qu’aurait-on dit si les programmes de 2002 avaient ainsi tenté d’imposer l’usage de la méthode naturelle d’écriture-lecture sans même signaler qu’il existe d’autres méthodes, plus faciles à mettre en œuvre et qui, lorsqu’elles sont mises entre les mains de professeurs des écoles débutants ou qui ne sont pas des experts de la didactique de l’écrit à l’école, peuvent conduire l’ensemble des élèves à une bonne conceptualisation de l’écrit ?
Ainsi, concernant la division, les programmes de 2002, interprétés à la lumière de leurs documents d’application et d’accompagnement, ne sont pas vraiment raisonnables. Heureusement, ils sont définis par cycles et les programmes en eux-mêmes interdisent très peu de choix pédagogiques, beaucoup moins en tout cas que les documents annexés. En toute légalité, donc, de très nombreux enseignants utilisent aujourd’hui d’autres progressions concernant la division que celle qui est préconisée par les documents d’application et d’accompagnement des programmes.
Les programmes de 2002 et la conceptualisation : un manque de cohérence
Il est intéressant de se demander si les programmes de 1945 et ceux de 2002 abordent la conceptualisation des autres opérations arithmétiques ou celle des fractions, par exemple, comme ils le font de la division. Y avait-il de la cohérence dans la façon dont le progrès était envisagé avant 1970 ? Y en a-t-il dans les programmes de 2002 ? Concernant la période précédant 1970, la réponse est vraisemblablement positive, mais il conviendrait d’étudier plus précisément cette question comme cela vient d’être fait pour la division. Ce qui surprend, en revanche, c’est le fait que la réponse est clairement négative concernant les programmes de 2002. Avant de chercher à le montrer, présentons quelques points-clés concernant la conceptualisation de la soustraction.
La conceptualisation de la soustraction : un parallèle avec celle de la division
La conceptualisation de la soustraction, comme celle de la division, peut évidemment s’appréhender de deux points de vue : celui des situations dans lesquelles l’usage de cette opération est pertinent et celui des procédures qui permettent de calculer une soustraction.
Du point de vue des situations d’usage de la soustraction, on sait que les principales sont la recherche du résultat d’un retrait (combien reste-il ?), celle d’un complément (combien faut-il ajouter à une quantité pour qu’elle devienne égale à une plus grande) et la recherche d’une différence : combien y a-t-il de plus (ou de moins) là que là ? La soustraction apparaît comme un traitement numérique commun à ces différentes situations et c’est la raison d’être de cette opération (réduction de la diversité des situations).
Du point de vue des procédures, il existe deux grandes stratégies de calcul d’une soustraction : le calcul par retrait et celui par complément. S’il faut calculer 102 – 6, par exemple, on peut procéder par retraits successifs : « 102 moins 2, c’est 100 ; il faut encore retirer 4, 100 moins 4, 96 ». En revanche, pour calculer 102 – 94, on procède plus volontiers par complément : « De 94, il faut 6 pour aller à 100 ; il faut encore 2 pour aller à 102 ; le résultat est 8 ». Bien entendu, si l’on calcule 102 – 94 par retraits successifs, c’est plus laborieux mais on obtient le même résultat : « 102 moins 2, ça fait 100 ; il faut encore retirer 92 ; 100 moins 90, ça fait 10 ; il faut encore retirer 2 ; le résultat est 8 ». De ce point de vue, le concept arithmétique de soustraction se fonde dans l’équivalence entre les procédures de retrait et de complément.
Comme dans le cas de la division, avant tout enseignement de la soustraction, les enfants savent résoudre les problèmes évoqués plus haut (recherche du résultat d’un retrait, d’un complément et d’une différence), du moins quand une procédure de simulation de la situation qui est décrite dans l’énoncé conduit facilement à la solution numérique. Cette simulation peut prendre trois formes : utilisation d’objets physiques, procédure de comptage ou utilisation de relations numériques connues. Quand cette simulation ne conduit pas ou conduit difficilement à la solution numérique, le problème est mal réussi.
Considérons par exemple ce problème de recherche d’un complément (dans la suite, on l’appellera le « problème du mini-bus qui se remplit ») : « Un minibus transporte 3 personnes. À un arrêt, d’autres personnes montent et le minibus redémarre alors qu’il est complet : il y a maintenant 42 personnes à l’intérieur. Combien de personnes sont montées dans le minibus ? ». Lorsque les enfants ne disposent pas de matériel, la simulation à l’aide d’une procédure de comptage les amène à « avancer sur la suite des nombres » en disant : 3 (nombre de départ), 4 (1 a été ajouté), 5 (2 a été ajouté), 6 (3), 7 (4), etc. Avec ces valeurs numériques, ce comptage 1 à 1 depuis le nombre 3 jusqu’à 42 est évidemment très difficile à contrôler. Par ailleurs, aucune relation numérique connue ne permet de simuler ce que dit l’énoncé (3 plus ? fait 42 n’active aucune relation numérique connue). Aussi le taux d’échec est-il important chez les enfants de début de CE1 (22% de réussite dans la recherche de Brissiaud et Sander, 2004 ; Brissiaud, 2004a).
En revanche, considérons ce problème de recherche du résultat d’un retrait qui contient les mêmes nombres (dans la suite, on l’appellera le « problème du mini-bus qui se vide ») : « Un minibus contient 42 personnes. Il s’arrête à un arrêt et 3 personnes descendent. Combien reste-t-il de personnes dans le minibus ? ». Pour le résoudre, les enfants comptent à rebours : 42, 41 (1 a été retiré), 40 (2 a été retiré), 39 (3 a été retiré). Comme le comptage à rebours conduit facilement à la solution, ce problème est évidemment bien mieux réussi : 75% de réussite en début de CE1.
Par ailleurs, comme dans le cas de la division, toutes les façons d’introduire le signe «—» dans la classe ne se valent pas. A l’erreur pédagogique qui consiste à assimiler sur une longue durée la division au partage correspond l’erreur qui consiste à assimiler sur une longue durée la soustraction à sa signification typique, la recherche du résultat d’un retrait, et à entraîner le comptage à rebours que les enfants utilisent spontanément dans ce type de situation (Svenson & Sjöberg, 1982).
 |
| Le calcul quotidien CE1 (p. 13) |
Les pédagogues d’avant 1970 commettaient cette erreur : longtemps le signe «—» fonctionnait en classe comme simple abréviation sténographique de « j’enlève », de « je perds »… et, quand les enfants ne disposaient pas d’objets, les seules soustractions qu’on leur proposait étaient celles où l’on « retire peu » : au CP, par exemple, on demandait aux élèves de calculer 9 – 2 parce que le comptage à rebours est « court », mais on ne leur demandait pas de calculer 9 – 7. Comme dans le cas de la division, cette erreur pédagogique a pour conséquence que de nombreux élèves auront ensuite des difficultés à généraliser l’usage de la soutraction à d’autres situations que celles où l’on cherche le résultat d’un retrait.
Guy Brousseau, le père de la didactique des mathématiques en France, a avancé un nom pour désigner la difficulté de généralisation qu’un tel choix génère (Brousseau, 1983) : il dit que, dans ce cas, l’enseignant crée un « obstacle didactique » au progrès. De plus, il analyse les raisons pour lesquelles les enseignants peuvent être tentés de faire un tel choix : dans ce cas en effet, on enseigne aux élèves le retrait, on leur enseigne la façon typique de calculer un retrait et on leur fait croire, ainsi qu’à leurs parents, qu’on leur enseigne la soustraction. Il appelle ceci de manière suggestive un « effet Jourdain » : le maître s’extasie devant l’usage du signe «—», félicitant l’élève et disant à ses parents : « Regardez ! Il utilise la soustraction ! », alors que l’enfant ne fait qu’un usage banal de ce signe. Brousseau a nommé ainsi ce phénomène en référence au passage de la pièce de Molière où Monsieur Jourdain s’extasie lorsque son Maître lui annonce qu’il fait de la prose : il pense ainsi être devenu savant alors qu’il n’a fait que s’exprimer banalement. On remarquera que, comme dans le cas de l’usage du mot « rectangle », l’« effet Jourdain », fondamentalement, repose sur la confusion de deux usages du mot « prose » : toutes les proses ne se valent pas , de même que tous les usages du mot « rectangle », du mot «diviser » et du mot « soustraction » ne se valent pas.
Signalons enfin que, comme dans le cas de la division, l’usage de la soustraction doit être étendu à d’autres situations que les trois « situations-types » décrites plus haut. Les élèves doivent par exemple apprendre à résoudre un problème de minibus où la valeur inconnue est l’état initial : on sait combien de personnes montent à un arrêt, combien il y a de passagers ensuite et l’on s’interroge sur le nombre de passagers avant l’arrêt.
Un usage surprenant de la notion de « résolution experte »
Concernant la conceptualisation de la division, nous avons vu que les programmes de 2002 sont pratiquement silencieux. Ce n’est pas le cas concernant la soustraction. Mais cette problématique est peu abordée à travers les « situations d’usage » de soustraction, elle l’est essentiellement à travers l’opposition entre l’usage de « procédures personnelles » et de « procédures expertes » pour résoudre un problème (parfois, c’est le mot « solution » qui est employé). Nous avons déjà vu que cet emploi de l’adjectif « personnel » semble malheureux, celui de l’expression : « procédures de simulation de la situation » aurait mieux précisé ce que savent faire (et, donc, ne savent pas faire) les enfants avant la conceptualisation. L’usage du mot « expert » ne semble guère plus heureux (14). Pour les besoins de la discussion, utilisons-le quand même.
Dans le document d’accompagnement des programmes (chapitre « Résolution de problèmes et apprentissage »), les auteurs étudient de manière un peu détaillée la façon dont ils pensent que les enfants progressent dans la résolution d’un problème du type « recherche d’un complément » (le minibus qui se remplit). Ils écrivent :
« Pour (cette) catégorie de problèmes (recherche d’un complément), le programme prévoit qu’il doit pouvoir être résolu par des procédures personnelles à la fin du cycle 2 et que la résolution experte relève donc du cycle 3.
Avant de discuter la partie de la phrase mise en gras (mise en gras qui est de mon fait), interrogeons-nous sur la signification de « résolution experte ». La « résolution experte » d’un problème comme celui du minibus qui se remplit, est évidemment celle où l’élève le résout à l’aide d’une soustraction. On peut qualifier cette façon de faire d’« experte » parce que l’autobus se remplit, le nombre de ses passagers augmente et l’élève calcule une soustraction ! L’enfant utilise donc le symbolisme arithmétique dans un sens non banal, à rebours du langage quotidien. Cela atteste d’un début de conceptualisation de la soustraction et, donc, d’un début d’expertise.
De plus, on est sûr qu’un enfant qui résout le problème du minibus qui se remplit à l’aide d’une soustraction saura aussi utiliser cette opération pour résoudre le problème du minibus qui se vide. En effet, on n’a jamais vu un enfant capable d’utiliser la soustraction pour résoudre le problème du minibus qui se remplit et qui ne le soit pas pour le problème de celui qui se vide ! Cela signifie que, pour lui, la soustraction est un mode de traitement commun aux deux sortes de problèmes et cela atteste d’un début de conceptualisation de la soustraction.
Mais revenons à la phrase en gras pour montrer que, dans leur usage du mot « expert », les auteurs des programmes manquent de recul : peut-on dire, comme cela est écrit dans le document d’application, que la résolution « experte » d’un problème de recherche d’un complément, celle qui se fait à l’aide d’une soustraction, « relève du cycle 3 » ? Il faut clairement affirmer le contraire : d’une part, parce que de nombreux élèves progressent au CE1 (le problème du minibus qui se remplit est réussi par 22% des enfants en début d’année, et par 42% en fin d’année dans la recherche de Brissiaud et Sander, 2004) et d’autre part, parce que la façon dont on introduit la soustraction au cycle 2 conditionne tout au long de leur scolarité celle dont certains élèves vont pouvoir conceptualiser la soustraction et, donc, résoudre ce type de problèmes de manière experte.
Nous avons qualifié d’erreur pédagogique le fait d’introduire le signe «—» comme synonyme de « retirer » ou « perdre » et, pour calculer 9 — 5, par exemple, de conforter les enfants dans le comptage à rebours qu’ils utilisent spontanément : 9, 8 (1 a été retiré), 7 (2 a été retiré), etc. En effet, lorsqu’on conforte les enfants dans l’association : soustraction <—> comptage à rebours et lorsqu’on leur pose ensuite un problème de recherche d’un complément, comme ils simulent la situation de recherche d’un complément en « avançant » sur la suite des nombres, l’usage de la soustraction leur apparaît incompatible avec cette simulation de la situation (Fuson et Willis, 1985 ; Brissiaud, 1994b). Du coup, certains élèves se mettent à utiliser de manière erronée l’addition parce que cette opération, elle, leur paraît compatible avec cette procédure de comptage en avançant. Malheureusement, cette erreur est encore faite par 20% des élèves au CM2 (Riley & Greeno, 1988).
La problématique de la conceptualisation de la soustraction (et donc, celle de la résolution « experte » des problèmes de recherche d’un complément) doit préoccuper les pédagogues dès les premiers jours où ils introduisent le signe «—», dès le cycle 2. S’ils s’en préoccupent seulement au cycle 3, c’est non seulement prendre du retard, c’est surtout risquer l’erreur pédagogique décrite plus haut et, donc, faire obstacle au progrès de certains élèves sur une longue durée.
Plus surprenant encore, lorsqu’ils énumèrent les compétences exigibles en fin de cycle 2, les programmes qualifient de « procédure experte » l’usage de la soustraction pour résoudre un problème comme celui du minibus qui se vide (recherche du résultat d’un retrait). Or l’usage de la soustraction, dans ce cas, est un usage banal du signe «—», il ne révèle aucune conceptualisation. Dans ce cas, le signe «—» est une simple abréviation sténographique d’un verbe dont la sémantique est du côté du retrait (descendre). Dans certaines expériences, 100% des élèves proposent en fin de CP d’utiliser le signe «—» pour résoudre ce type de problème (Carey, 1991).
Dans un des documents d’accompagnement, les auteurs assument pourtant cet usage du mot « expert » en expliquant qu’ils parlent de « solution experte » dès que l’enfant « utilise le même raisonnement et les mêmes calculs que ceux qu’utiliserait une personne experte » (p. 15).
Or cette définition de l’expertise ne tient pas ici. Selon cette définition, en effet, il faudrait considérer que l’apprenti pianiste qui s’assoit sur le tabouret avant de mettre les mains sur le clavier utilise pour s’asseoir une « procédure experte de pianiste ». Il se comporte en effet comme l’expert ! Certaines tâches (s’asseoir sur le tabouret pour l’apprenti pianiste, résoudre le problème du minibus qui se vide pour l’élève de cycle 2) ne permettent pas de savoir si celui qui les exécute est un expert parce qu’elles ne mettent pas en jeu les compétences et les savoirs qui sont ceux de l’expert (l’art du piano dans un cas, la conceptualisation de la soustraction dans l’autre). Cette définition conduit à parler d’« expertise » chez des élèves concernant la soustraction alors qu’on n’a aucune preuve du fait qu’ils ont commencé à conceptualiser cette opération.
Simple querelle de mots ? Non, évidemment, parce qu’amener les professeurs d’écoles à « voir de l’expertise » là où il n’y en a pas, ne les aide pas à viser, chez leurs élèves, la véritable expertise : la conceptualisation des opérations arithmétiques. En fait, il s’agit d’un authentique effet Jourdain, mais à l’intention des enseignants : les programmes s’extasient devant l’usage du signe «—» pour résoudre le problème du minibus qui se vide, félicitant les maîtres tout en leur disant : « Regardez ! Il utilise une procédure experte ! », alors que l’enfant ne fait qu’un usage banal de ce signe «—».
Un choix pédagogique étonnant parce qu’à l’opposé de celui qui est fait pour la division
Comment expliquer ce mésusage du mot « expert » ? Il reflète malheureusement une insuffisance didactique plus réelle. Ce n’est pas écrit explicitement, mais dans la progression que les auteurs des programmes avaient en tête au moment où ils les ont rédigés, le signe «—» est introduit au CP comme synonyme de « retirer » ou « perdre » et, pour calculer 9 — 5, par exemple, les enfants sont confortés dans l’usage du comptage à rebours qu’ils utilisent spontanément : 9, 8 (1 a été retiré), 7 (2 a été retiré), etc. En effet, ce mode d’introduction de la soustraction et du signe «—» est très précisément celui que préconise ERMEL. Les styles pédagogiques de ERMEL et des pédagogues d’avant 1970 sont très différents, ils sont même à l’opposé, mais certains choix, étrangement, apparaissent communs : celui de la signification et du mode de calcul qui sont privilégiés lors de l’introduction de la soustraction. Il est étonnant qu’ERMEL soit aussi peu attentif aux difficultés de généralisation dans l’emploi de la soustraction que ce choix crée. Rappelons encore une fois que Brousseau (1983) nous a depuis bien longtemps mis en garde contre ce type de décisions pédagogiques qui apparaissent de prime abord comme des simplifications : ici, introduire de manière précoce la soustraction dans sa signification typique et avec son mode de calcul typique. Ce qui apparaît pendant un certain temps comme une avance, crée finalement du retard parce que certains élèves s’enferment dans cette signification et ce mode de calcul typique. Il nous mettait ainsi en garde contre ces « simplifications excessives » qui créent ce qu’il appelle des « obstacles didactiques ».
Étrangement aussi, lorsqu’on les examine du point de vue de la conceptualisation, les choix pédagogiques de ERMEL apparaissent à l’opposé concernant la division d’une part et la soustraction de l’autre. Concernant la division, le symbolisme est introduit tardivement et c’est le souci que ce symbolisme s’instaure d’emblée comme symbole de l’équivalence entre le partage et le groupement qui guide les propositions pédagogiques. Concernant la soustraction, le symbolisme est introduit d’emblée mais avec une seule signification (la signification typique) et, sur une longue durée, ce symbolisme renvoie à cette seule signification. Ainsi, les propositions du programme, lorsqu’on les analyse du point de vue de la conceptualisation, n’apparaissent guère cohérentes. En fait, comme nous le verrons dans la conclusion, leur cohérence est à chercher ailleurs que dans le traitement que ces programmes font de la conceptualisation, elle est à chercher dans la façon dont est traité le thème de la résolution de problèmes.
Une analyse similaire, avec, peut-être, des enjeux encore plus importants, pourrait être menée concernant les apprentissages numériques à l’école maternelle (Brissiaud, 2003). Nous nous contenterons, pour montrer que le cas de la soustraction n’est pas une exception, d’aborder succinctement celui des fractions.
Des programmes qui font des recommandations étonnantes concernant les fractions
On sait qu’une écriture telle que 3/4 peut se lire indifféremment « 3 divisé par 4 » ou « 3 quarts ». Comme dans le cas de la division euclidienne, chacun de ces modes de lecture renvoie de manière privilégiée à une situation différente :
- « 3 divisé par 4 » renvoie, par exemple, à un scénario où l’on partage 3 baguettes de pain en 4 parts égales (les programmes parlent de cette signification comme d’une « signification quotient »).
- « 3 quarts » renvoie à un autre scénario où l’on s’intéresse à une seule baguette de pain ; puis celle-ci est fractionnée en 4 parts égales et l’on prend 3 de ces quarts (on parlera dans ce cas de « fractionnement de l’unité ».
Si l’on peut lire indifféremment 3/4 d’une façon ou de l’autre, c’est parce que les deux façons de faire conduisent à la même quantité : si l’on partage 3 baguettes équitablement entre 4 personnes, chacune d’elle recevra 3 quarts de baguettes. Encore une fois, donc, nous sommes face à un signe qui est le symbole d’une équivalence entre procédures et, pour conceptualiser les fractions il faut s’être approprié cette équivalence ou encore connaître à la fois la « signification quotient » évoquée plus haut et la signification « fractionnement de l’unité ».
Or de nombreux travaux scientifiques soulignent que la « signification quotient » évoquée plus haut (3/4 c’est 3 divisé par 4) permet mieux que l’autre de comprendre les équivalences entre fractions, elle permet mieux de comprendre que 3/4 = 6/8, par exemple (Nunes et collègues, 2004). Certains chercheurs parmi les meilleurs connaisseurs de ce thème d’étude recommandent même d’introduire les fractions avec, comme première signification, le sens quotient plutôt que le sens « fractionnement de l’unité » (Streefland, 1991 ; Empson, 1999). Et, à ma connaissance, aucun chercheur ne recommande de ne pas aborder à l’école primaire ce sens quotient (pour une synthèse, voir : Carpenter et collègues, 1993 et, en français : Adjiage, 1999). Et pourtant, dans les documents d’application et d’accompagnement des programmes, en différents endroits, on lit que la signification quotient des fractions relève du collège. Cette décision ne revient-elle pas à cantonner les élèves à une seule signification de l’écriture a/b ? Comment compte-t-on, avec une seule signification (a bièmes), qui est aussi la plus triviale, amorcer le processus de conceptualisation : « a divisé par b » est égal à « a bièmes » ! Peut-on espérer qu’un grand nombre d’élèves, en fin de CM2, ressentent un sentiment d’évidence face à une égalité telle que 54/10 = 5,4 sans que la barre de fraction du premier membre de cette égalité ait d’emblée une signification de division (« 54 divisé par 10 ») ? Lorsque la barre de fraction n’a pas d’emblée ce statut, il faut raisonner de la manière suivante : à chaque fois que 54 dixièmes contient 10 dixièmes, cela correspond à une unité; il faut donc chercher combien de fois il y a 10 dixièmes dans 54 dixièmes ; c’est 5 fois et il reste 4 dixièmes. L’égalité précédente ne peut pas avoir un statut d’évidence lorsqu’il faut mener un raisonnement aussi complexe pour qu’elle apparaisse légitime. Les programmes se donnent l’objectif que les enfants sachent que 54/10 = 5,4 mais, parce qu’ils ne favorisent pas la conceptualisation des fractions, ils ne se donnent pas les moyens d’atteindre cet objectif.
Ainsi, les mêmes arguments qui invitent à rejeter tout retour aux programmes de 1945, conduisent à porter un jugement critique sur plusieurs aspects des programmes de 2002. Mais il ne faudrait pas penser qu’il existe une sorte de symétrie entre les deux positions : au début de ce texte un éventuel retour à l’enseignement des 4 opérations au CP a été qualifié de catastrophique alors que ce mot n’a jamais été utilisé concernant la situation actuelle. Une première raison est, évidemment, que de nombreux enseignants se situant dans le cadre institutionnel des programmes eux-mêmes et non dans celui des documents qui l’accompagnent, enseignent la division posée au CE2, enseignent le « sens quotient » des fractions au CM1, etc. Mais, plus fondamentalement, la différence entre les deux sortes de programmes, celui de 1945 et celui d’aujourd’hui tient dans leurs possibilités d’évolutions futures.
De ce point de vue, trois sortes de programmes peuvent être distingués :
- Des programmes qui créent des différends entre les divers « acteurs » intéressés par leur contenu : enseignants, parents, chercheurs de différents statuts… mais dont le contenu est susceptible d’évoluer assez facilement. Les programmes actuels sont de cette sorte.
- Des programmes qui créent un équilibre, même provisoire, entre les points de vue des divers acteurs précédents et c’est évidemment vers cette deuxième sorte de programmes qu’il faut tendre.
- Des programmes qui créent des différends entre les divers acteurs précédents mais dont le contenu n’évoluera plus, sauf si une amélioration très conséquente de la vie démocratique de notre pays survient : les programmes de 1945 sont de ce troisième type, qu’il faudrait absolument éviter aujourd’hui.
Expliquons cette typologie. Au début de l’année 2006, un sondage a été commandé par le Ministère de l’Éducation Nationale, qui demandait aux personnes sondées si elles étaient pour ou contre la méthode globale d’apprentissage de la lecture. Ce fut évidemment un raz-de-marée de « contre » (environ 90 %). Imaginons qu’on fasse aujourd’hui un sondage en disant aux personnes interrogées qu’il est possible d’enseigner la division au CP parce que ça se faisait il y a quelque temps et en leur demandant si elles désirent que leurs enfants bénéficient de cet enseignement… Quel parent ne souhaite pas que ses enfants apprennent tout ce que l’école est susceptible de leur enseigner ? Supposons que des chercheurs tentent d’expliquer qu’en réalité, c’est toujours le partage qu’il est ainsi proposé d’enseigner aux enfants mais un partage qu’on a « habillé » du langage et des signes arithmétiques de la division. Supposons que ces chercheurs tentent d’expliquer que, ce faisant, certains élèves n’accéderont peut-être jamais au concept de division parce que trop longtemps, ils penseront que division = partage. Ce discours paraîtra bien complexe et il ne trouvera place que dans des médias très spécialisés.
On ne mesure peut-être pas assez aujourd’hui à quel point la situation actuelle, c’est-à-dire un fonctionnement pédagogique avec des programmes de mathématiques susceptibles d’évoluer, est le résultat d’une véritable révolution : celle de la réforme dite des « mathématiques modernes ». Le caractère révolutionnaire de cette réforme était moins dans le nouveau contenu qu’il a été décidé d’enseigner que dans le fait qu’on ait pu décider d’enseigner des contenus qui, tout simplement, allaient contre le bon sens. La plupart des personnes concernées par cette réforme n’étaient pas des spécialistes du domaine et, donc, se forgeaient une opinion à partir de leur simple bon sens. Ça ne les prédisposaient pas à l’accepter. Il fallait que l’époque soit très différente de celle d’aujourd’hui pour que cette réforme ait pu, malgré cela, exister.
Avec le développement des moyens modernes de communication (télévision et internet notamment), une démocratie comme la nôtre est de moins en moins à l’abri du populisme. On connaît les belles analyses que fait Pierre Rosanvallon de cette pathologie de la démocratie (15) : il ne la définit pas comme une idéologie mais par son fonctionnement. Il considère le populisme comme un retournement pervers contre elle-même des idéaux et des procédures de la démocratie. Le populisme repose sur le fantasme d’un peuple qui serait unanime à penser autrement qu’une petite élite alors que celle-ci tenterait d’imposer son point de vue. Par exemple : le fantasme d’un peuple unanime à penser qu’il faut revenir à l’enseignement des 4 opérations dès le CP alors qu’une poignée de pédagogues défendraient le contraire.
Si nous devions revenir aux programmes de 1945 et si ces programmes devaient créer à nouveau toutes les difficultés qui ont été analysées dans ce texte (notamment : un ennui important dans les classes du fait de la répétition, un désintérêt généralisé des enseignants pour le fonctionnement intellectuel de leurs élèves, un enseignement élitiste parce que seuls les enfants qui s’auto-questionnent progressent en résolution de problèmes…), malgré toutes ces difficultés, nous n’en garderions pas moins ces programmes pendant 50, voire 100 ans (16). En effet, quiconque voudrait dénoncer le prétendu enseignement de la multiplication et de la division dès le CP, qu’une campagne de type populiste le ramènerait bien vite à la raison : « Ils ne veulent plus que nos enfants apprennent la multiplication et la division dès le CP ! » ; « À une époque qui nécessite des savoirs de haut niveau, ils alignent les programmes vers le bas ! ».
L’enjeu, aujourd’hui, est qu’une campagne de même type ne nous emmène vers cette situation bloquée. Que faire ? Expliquer, en s’appuyant sur les connaissances scientifiques disponibles, que les élèves n’auraient rien à gagner à un retour aux programmes de 1945 parce que tout enfant qui apprenait avec ces programmes doit aussi apprendre avec la plupart des progressions adoptées aujourd’hui. Expliquer aussi que certains enfants ont beaucoup à perdre parce que la plupart des progressions adoptées aujourd’hui corrigent certains défauts graves de celles qui les précédaient. Lorsqu’on étudie les pratiques pédagogiques anciennes avec les « lunettes théoriques » de la conceptualisation, et lorsqu’on connaît les pratiques pédagogiques qui sont celles de très nombreux enseignants aujourd’hui (grâce à la définition des programmes par cycles et au fait que les programmes en eux-mêmes interdisent très peu de choix pédagogiques), on ne voit absolument pas ce qu’apporterait un retour à ces pratiques anciennes. Il faut aussi expliquer qu’on voit assez bien ce que pourrait apporter une amélioration des programmes et il faut favoriser une démarche sereine d’élaboration de ces futurs programmes.
Favoriser l’échange entre chercheurs et enseignants
La critique des programmes de 2002 qui a été développée ici n’est pas un phénomène isolé : d’autres chercheurs critiquent ces programmes d’un de vue point scientifique différent, celui de la didactique des mathématiques. Ainsi, le « nouvel INRP » (celui de Lyon) a récemment créé un site Internet, EducMaths. Ce site contient un forum dédié aux questions d’enseignement des mathématiques. Le principe en est le suivant : une question est posée et deux « spécialistes » du domaine rédigent des réponses qui sont mises en ligne. Ensuite, les visiteurs du site peuvent eux-mêmes réagir. À la question : « Quelles idées, issues de la recherche sur l’enseignement des mathématiques, ont exercé une grande influence sur les pratiques des enseignants depuis 10 ans ? », Alain Mercier, un didacticien des mathématiques qui était l’un des deux spécialistes sollicités, répond de manière provocatrice (17) : « Une idée a peut-être eu de l’influence, hélas, c’est l’idée que faire des mathématiques c’est résoudre des problèmes ». Son point de vue rejoint celui qui a été développé ici : depuis plusieurs années, les enseignants sont invités de façon pressante à réfléchir sur la notion de « problème de recherche » et ils le sont de moins en moins à réfléchir sur les progressions et les conditions permettant la conceptualisation arithmétique. C’est ce que veut dire A. Mercier quand il avance : « le slogan de la résolution de problèmes permet de nier l’importance des conditions didactiques et de proposer …/… un enseignement qui ne s’adresse plus qu’aux rares élèves capables de tirer profit par eux-mêmes de leurs rencontres aléatoires ».
De ce point de vue, les programmes de 2002 apparaissent très différents dans ce qu’ils préconisent pour l’apprentissage de l’écrit et pour celui des mathématiques. Concernant l’apprentissage de l’écrit, les programmes de 2002 ont officialisé une sorte de « recentrage » du discours pédagogique sur certaines conditions indispensables au progrès (la conceptualisation des relations grapho-phonologiques, la fréquentation d’œuvres littéraires, notamment). Concernant les mathématiques, en revanche, le discours sur les conditions indispensables à la conceptualisation de chacune des opérations arithmétiques perd de sa cohérence dans les programmes successifs et il tient de moins en moins de place au profit d’un discours plus général s’attachant essentiellement à décrire la démarche de pensée qu’il faudrait favoriser chez les élèves.
Cette différence entre les parties consacrées à l’écrit et aux mathématiques dans les programmes de 2002 s’explique par les échanges qui se sont développés entre chercheurs et enseignants ces quinze dernières années dans le premier de ces domaines et qui n’ont pas d’équivalents dans le second. L’Observatoire National de la Lecture a été crée en 1996 et, même si on peut regretter que toutes les sensibilités pédagogiques s’inspirant des recherches scientifiques disponibles n’aient pas été sollicitées, cet organisme a quand même favorisé la confrontation des points de vue des pédagogues, des didacticiens et des psychologues, il a favorisé l’émergence d’une culture commune.
Aussi semblerait-il logique de faire avec les mathématiques à l’école ce qui a si bien réussi dans le domaine de la lecture : favoriser le débat, confronter les points de vue. C’est possible parce que, souvent, ils ne sont pas si éloignés. Quand le psychologue Jean-François Richard (2004), par exemple, dit qu’il faut être attentif au niveau de généralité auquel on introduit les nouveaux savoirs (introduire le signe « – » comme synonyme du retrait et en l’associant à un comptage à rebours, c’est l’introduire à un niveau de généralité trop bas, par exemple), son discours fait écho à celui du didacticien Guy Brousseau quand il parle d’obstacle didactique.
Evidemment, cela demande du temps et le résultat de tels échanges n’est pas garanti d’avance. Mais c’est le propre de ce genre de processus et, en cela, il s’oppose aux décisions de type populiste. Comme le souligne P. Rosanvallon, se rassembler sur des propositions positives est plus difficile que d’agréger en faveur du retour à l’enseignement des 4 opérations dès le CP ceux qui militent pour cela, ceux qui viennent soutenir leur point de vue parce que la situation de l’enseignement des mathématiques à l’école n’est pas ce qu’elle devrait être, ceux qui pensent que l’école en général va mal, ceux dont les enfants n’ont jamais rien compris aux mathématiques à l’école, etc. Par ailleurs, il suffit qu’un homme politique décide que l’enseignement des 4 opérations se fera à nouveau dès le CP, pour que cette décision réalise sur le champ le fantasme de toutes ces personnes. Le régime de temporalité des décisions de type populiste est celui de l’immédiateté. Elles ne sont pas porteuses d’incertitudes. Entre les défenseurs d’un processus d’échange et de confrontation des points de vue et les militants d’un retour immédiat à l’enseignement des 4 opérations dès le CP, les armes ne sont pas égales. En tout cas, pour les pédagogues et les chercheurs, au nom même de l’intérêt des élèves, il n’y a pas d’autre solution que de prendre place dès maintenant dans ce débat à un niveau d’argumentation qui, espérons-le, conduira l’opinion, les parents, les journalistes et les responsables politiques à mesurer la complexité des enjeux et à adopter une position de sage prudence.
30 Mai 2006
Bibliographie
Abrose R., Baek J. M. et Carpenter T. (2003) Children’invention of multidigit multiplication and division algorithms. In A. Baroody & A. Dowker : The development of arithmetic concepts and skills, 305-336. NJ & London : Lawrence Erlbaum
Adjiage, R. (1999). L’expression des nombres rationnels et leur enseignement initial. Thèse de didactique des mathématiques (non publiée), Université Louis Pasteur de Strasbourg.
Brissiaud, R. (1994a) Penser l’usage du mot “fois” et l’interaction oral / écrit lors de l’apprentissage initial de la multiplication. In M. Artigue, R. Gras, C. Laborde & P. Tavignot (Eds), Vingt ans de didactique des mathématiques en France.(pp.195-202). Grenoble : La pensée sauvage.
Brissiaud R. (1994b) Teaching and Development : Solving “Missing Addend” Problems Using Substraction. In Schneuwly & Brossard (Eds) : Learning and development: contributions from Vygotsky. European Journal of Psychology of Education, 9 (4), 343-365.
Brissiaud, R. (1995) Un exemple d’opérationnalisation de la notion de zone de proche développement concernant la didactique de la soustraction. In C. Margolinas (Ed) Les débats de didactique de mathématiques – actes du séminaire national 1993 – 1994. Grenoble : La pensée sauvage.
Brissiaud R. (2002) Psychologie et didactique : choisir des problèmes qui favorisent la conceptualisation des opérations arithmétiques. In J. Bideaud & H. Lehalle (Eds) : Traité des sciences cognitives. Le développement des activités numériques chez l’enfant, 265-291. Paris : Hermes
Brissiaud (2003) Comment les enfants apprennent à calculer (nouvelle édition) : Le rôle du langage, des représentations figurées et du calcul dans la conceptualisation des nombres. Paris: Retz.
Brissiaud R. (2004a) La resolution de problèmes arithmétiques : une étude longitudinale au CE1. In ARDM (Ed) Séminaire national de didactique des mathématiques 2004 Les actes, p. 223-228
Brissiaud, R. (2004b) : allègements successifs des programmes : une légèreté didactique ?
http://smf.emath.fr/Enseignement/TribuneLibre/EnseignementPrimaire/CahiersBrissiaud.pdf
Brissiaud, R., & Sander, E. (2004). Conceptualisation arithmétique, résolution de problèmes et enseignement des opérations arithmétiques à l’école : une étude longitudinale au CE1. Document présenté au symposium ARDECO « Les processus de conceptualisation en débat : Hommage à Gérard Vergnaud ». Clichy-La Garenne. 28-31 Janvier 2004. 10 pages.
Brissiaud, R., Ouzoulias, A. & Clerc, P. (1996) J’apprends les maths CE2 – Livre du maître, Paris : Retz.
Brousseau G. (1983) Les obstacles épistémologiques et les problèmes en mathématiques. Recherches en didactique des mathématiques, 4-2, 164-198.
Brousseau G. (1987) Fondements et méthodes de la didactique. Recherches en didactique des mathématiques, 7-2, 33-115.
Carey, S. (1985) Conceptual Change in Childhood, Cambridge, MIT Press.
Carey D. (1991) Number sentences : linking addition and substraction word problems and symbols. Journal for Research in Mathematics Education, 22, 266-280.
Carpenter T., Fennema E. & Romberg T. (1993) Rational numbers ; An integration of research. Hillsdale, NJ : Lawrence Erlbaum Associates.
Chi, M, Bassok, M., Lewis R., Reiman, P.& Glaser, R. (1989). Self-explanations : how students study and use examples in learning to solve problems, Cognitive Science, 13, 145-182.
Empson, S. (1999). Equal Sharing and Shared Meaning: The Development of Fraction Concepts in a First-Grade Classroom. Cognition and Instruction, 17, 283-343.
Fuson K. (1986) Teaching children to subtract by counting up. Journal for Research in Mathematics Education, 17, 172-189.
Fuson K. & Willis G. (1988) Substracting by counting up: more evidence. Journal for Research in Mathematics Education, 19, 402-420.
Keil F. (1989) Concepts, kinds and cognitive development, MIT Press.
Kouba, V. (1989). Children’s solution strategies for equivalent set multiplication and division word problems. Journal for Research in Mathematics Education, 20, 147-158.
Nogry, S., & Didierjean, A. (2006) Apprendre à partir d’exemples : interactions entre présentation du matériel, activités des apprenants et processus cognitifs. L’année psychologique, 106(1).s
Nunes T., Bryant P., Pretzlik U., Bell D., Evans D. & Wade J. (2005). Children’s understanding of fractions, Paper presented at the ARDECO symposium, Paris, February 2004.
Richard J. F., (2004) Les Activités Mentales (4e édition) : De l’interprétation de l’information à l’action. Paris : Colin.
Riley, M. & Greeno, J. (1988) Developmental analysis of understanding language about quantities and solving problems, Cognition and Instruction, 5(1), 49-101.
Sander, sE. (2000). L’analogie, du Naïf au Créatif : analogie et catégorisation. Paris, L’Harmattan.
Squire, S. & Bryant, P. (2002). From sharing to dividing. The development of children’s understanding of division. Developmental Science, 5(4), 452-466
Svenson, O. & Sjöberg, K. (1982) Solving simple substractions during the first three school years. Journal of experimental education, 50, 91-100.
Streefland (1991) Fractions in realistic mathematics education, Boston : Kluwer.
Vergnaud G. (1990) La théorie des champs conceptuels ; Recherches en Didactique des Mathématiques vol. 10 n°2.3 ; pp. 133- 170.
Verschaffel, L. & De Corte, E. (1997) Word Problems : a vehicle for promoting authentic mathematical understanding and problem solving in the primary schol ? In T. Nunes & P. Bryant (Eds) Learning and Teaching mathematics – An International Perspective, 69-97, Hove : Psychology Press
a : Ce texte a bénéficié de la relecture et de nombreuses suggestions de mon collègue André Ouzoulias. Par ailleurs, le site du Laboratoire Paragraphe est en phase de réaménagement ; dès que possible, divers textes difficiles à se procurer et auxquels je me réfère seront mis en ligne sur ce site : http://paragraphe.univ-paris8.fr/fr/presentation/
2 : Delord est professeur certifié de mathématiques. Il est connu par son site internet, http://michel.delord.free.fr/ sur lequel il bataille avec une énergie peu commune contre le « pédagogisme constructiviste ». Demailly est Professeur d’Université de mathématiques et membre de l’Académie des Sciences. Lafforgue est médaille Field (équivalent du prix Nobel pour les mathématiques), mais on est obligé de remarquer que, souvent, quand il s’exprime sur d’autres sujets que les mathématiques, il s’astreint à moins de rigueur que dans son œuvre scientifique.
3 : Roland Charnay est aussi connu pour être le principal coordinateur de l’Equipe de Recherche Mathématiques à l’Ecole éLémentaire (ERMEL), une équipe de l’INRP qui a publié deux séries d’ouvrages pour faire la classe depuis le CP jusqu’au CM2, l’une en 1977-1983 et la seconde en 1990-1996. De nombreux formateurs en mathématiques en IUFM pensent que ces ouvrages doivent servir de référence en formation initiale et continue des professeurs d’écoles.
4 : C’est précisé dans le document d’application des programmes du cycle 3 (page 45), dans une partie appelée « aide à la programmation des activités ». Au CE2 et au CM1, d’après ce document, on ne serait que dans une phase d’ « approche » ou de « préparation » à ce calcul posé.
5 : D’une façon générale, en arithmétique élémentaire, il est toujours possible d’analyser la conceptualisation de ce double point de vue : celui des situations et celui des procédures. Gérard Vergnaud (1990) qui utilise le mot « schème » plutôt que « procédure » remarque fort justement : « Il n’y a pas de situations sans schèmes et il n’y a pas de schèmes sans situations ».
6 : Pour la division euclidienne, il vaut mieux éviter d’écrire 163 : 50 = 3 (reste 13) comme cela se faisait avant 1970 parce que l’expression qui figure dans le second membre de cette égalité : « 3 (reste 13) » non seulement ne peut pas être considérée comme renvoyant à « un nombre égal à ce que désigne le premier membre » mais, de plus, elle peut renvoyer à d’autres divisions euclidiennes que celle qui est désignée par le premier membre (313 divisé par 100, par exemple). Le respect des règles d’usage du signe « = » est tellement important dans la suite de la scolarité des élèves que la plupart des pédagogues évitent aujourd’hui cette transgression. La difficulté provient du fait que la solution d’une division euclidienne est constituée d’un couple de nombres (quotient et reste) et non d’un seul nombre. Ce problème est résolu de manière simple en utilisant un point d’interrogation à la place du signe « = ». La division euclidienne de 163 par 50 est ainsi posée sous la forme : 163 : 50 ? et les élèves répondent : q = 3 et r = 13.
7 : Plus généralement, l’usage de ce qu’on appelait à l’époque des « nombres concrets » faisait obstacle à l’appropriation de plusieurs propriétés importantes des opérations, dont la commutativité de la multiplication.
8 : Ce qui est décrit ici correspond au contenu de la série « Le calcul vivant ». Dans l’autre série étudiée, « Le calcul quotidien », les enfants apprennent également au CE1 à résoudre les problèmes de partage de a unités en b parts égales en posant la division a : b ? Mais dès le CE1, ils calculent le résultat en disant : « en a combien de fois b ? ». Ils apprennent cette règle « par cœur » parce que cette manière de calculer n’est reliée à aucun problème de groupement et nulle part le fait qu’on puisse s’exprimer ainsi n’est justifié. Mais les auteurs étaient cohérents : dans cette série, les enfants apprenaient les tables de multiplication sous les deux formats possibles (remarquons qu’entre 1880 et 1970, ce choix est très minoritaire : cf. Brissiaud, 1994a). Dans tous les cas, à cette époque, les auteurs de manuels adaptaient le format d’apprentissage des tables de multiplication à la progression qu’ils avaient adoptée concernant la division.
9 : On trouve une synthèse récente des recherches sur cette forme d’apprentissage dans Nogry, S. & Didierjean, A. (2006).
10 De manière plus précise : les tables de multiplication traditionnelles sont vraisemblablement celles qui favorisent le mieux la mémorisation dès lors qu’on enseigne aux élèves à retrouver les résultats de « fin de tables », sans réciter la table depuis le début : « 3 fois 6 », par exemple, est « juste après 3 fois 5 ». Comme dans la table de 3, les résultats vont de 3 en 3, « après 15, c’est 18 ».
11 : On dispose de quelques résultats expérimentaux (Brissiaud, 1995) qui montrent que, lorsqu’on n’utilise pas trop mal un tel environnement pédagogique, les effets attendus se produisent : on n’observe pratiquement plus de dysfonctionnement du type précédent en fin de CE1 alors que dans une population témoin, ils sont observés en grand nombre.
12 : Rappelons que ce sigle désigne une Equipe de Recherche Mathématiques à l’Ecole éLémentaire de l’ancien INRP quand son siège était encore à Paris et non pas à Lyon comme aujourd’hui.
13 Frank Ramus est le principal chercheur dans le domaine de lecture à avoir plaidé en faveur de modifications des programmes de 2002. Or, même lui le reconnaît : aucune recherche ne permet d’interdire la méthode naturelle d’écriture-lecture. On se reportera à : Ramus, F. (2005) Réponse à A.Ouzoulias et R.Brissiaud :
http://www.lscp.net/persons/ramus/lecture/lecture.html
14 L’usage du mot « expert » provient de travaux en psychologie cognitive où il est utilisé en opposition avec le mot « novice ». Ces travaux s’intéressaient essentiellement, chez les sujets, à leur expérience d’un domaine donné (les échecs par exemple), ils ne s’intéressaient pas aux aspects developpementaux du progrès. Or, concernant les progrès dans la résolution des problèmes de soustraction, les facteurs développementaux sont importants et les mots « novices » comme « experts » ne sont pas ceux qui conviennent le mieux. Je préfère généralement parler de « résolution arithmétique » d’un problème plutôt que de « résolution experte ».
15 Voir ses cours 2005-2006 au Collège de France
16 : Les programmes de 1945 sont très peu différents de ceux de 1882, ces derniers ont donc bien été pérennes pendant près de 100 ans.