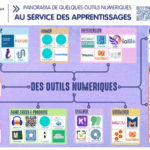Par Jeanne-Claire Fumet
Pour sa journée annuelle d’étude, le 12 mai, l’ACIREPh avait choisi Lille et la question du choix de l’œuvre étudiée en lecture suivie : comment éviter les poncifs ? Comment intégrer l’œuvre au mieux dans le lourd programme de l’année ? Quelle forme de présentation peut favoriser l’imprégnation sans saturation ? Premier constat : les choix pédagogiques des professeurs sont irrépressiblement orientés vers quelques grands textes de Kant et Rousseau, voire d’Épicure ou Freud. C’est restreindre à peu le choix offert par les 57 auteurs au programme depuis 2003. Mais n’est-ce pas le signe d’un souci d’efficacité, quand l’œuvre choisie doit servie à étayer l’écrit et à supporter l’oral de rattrapage ? Peut-on se permettre le risque d’un Plotin ou d’un Husserl ? Pourquoi pas, s’interrogent les membres de l’Acireph, qui étudient avec Sébastien Charbonnier, professeur à Lille, les effets de la canonisation en philosophie, et lancent avec Christophe Grellard, professeur de philosophie médiévale à Paris I, le pari d’un texte de Guillaume d’Ockham. Mais le désir de sortir des sentiers battus ne suffit pas à effacer la difficulté technique d’un tel élargissement.
Comment naissent les canons ?
 Sébastien Charbonnier, professeur de philosophie et spécialiste en sciences de l’éducation, rappelle que l’injonction faite à la philosophie scolaire de donner des repères pour penser en commun débouche dans l’ensemble, dans les cours des professeurs, sur l’élection de quelques références massives qui ne favorisent pas la formation de l’esprit critique. S’il est vrai qu’en une année d’enseignement, prétendre donner aux élèves les rudiments de culture et la distance critique qui leur permette d’en juger peut sembler présomptueux, la canonisation de certaines « valeurs sûres » n’en risque pas moins de figer et limiter la pensée dans des postures artificielles. Car la canonisation (d’un nom, d’un texte, d’un débat) admet trois propriétés, explique S. Charbonnier : il sanctifie son objet, justifiant le refus de la transposition didactique ; il le réifie, en identifiant la philosophie à quelques figures ou moments qui en seraient l’essentiel ; il le totalise enfin, dans un fantasme d’exhaustivité qui le mutile et le déforme en routine et en précipitation. Résultats : l’activité de philosopher se réduit à la reproduction mécanique de schémas mal compris.
Sébastien Charbonnier, professeur de philosophie et spécialiste en sciences de l’éducation, rappelle que l’injonction faite à la philosophie scolaire de donner des repères pour penser en commun débouche dans l’ensemble, dans les cours des professeurs, sur l’élection de quelques références massives qui ne favorisent pas la formation de l’esprit critique. S’il est vrai qu’en une année d’enseignement, prétendre donner aux élèves les rudiments de culture et la distance critique qui leur permette d’en juger peut sembler présomptueux, la canonisation de certaines « valeurs sûres » n’en risque pas moins de figer et limiter la pensée dans des postures artificielles. Car la canonisation (d’un nom, d’un texte, d’un débat) admet trois propriétés, explique S. Charbonnier : il sanctifie son objet, justifiant le refus de la transposition didactique ; il le réifie, en identifiant la philosophie à quelques figures ou moments qui en seraient l’essentiel ; il le totalise enfin, dans un fantasme d’exhaustivité qui le mutile et le déforme en routine et en précipitation. Résultats : l’activité de philosopher se réduit à la reproduction mécanique de schémas mal compris.
Information, formatage et formalisme contre formation
Les difficultés propres au choix de l’œuvre suivie renforcent ces mécanismes, déjà très prégnants en philosophie où les classiques ne sont définis que par l’usage dans le champ scolaire (ce n’est pas le cas, par exemple, en littérature ou en peinture). Une consultation de nombreux enseignants montre que l’on évite en général les œuvres trop denses, trop longues, trop techniques, trop éloignées culturellement ou peu rentables au regard du programme de notions. La restriction du champ est avalisée par les éditions scolaires qui consacrent près de 80% des publications à environ 10% des auteurs du programme. Si les enjeux de la conservation patrimoniale (cohérence rituelle par la répétition mécanique, fixation de l’identité culturelle, commentaire sacralisant du texte) y trouvent leur compte, la formation risque de succomber sous l’information, le formatage et le formalisme.
Pourquoi pas Guillaume d’Ockham ?
 Christophe Grellard, enseignant à Paris I et spécialiste de philosophie médiévale, en propose la gageure. Certes, la lecture requiert de connaître le contexte historique, d’opérer une approche non confessionnelle du texte saturé de questions religieuses, de surmonter la technicité du vocabulaire et la méconnaissance générale de cette période chez les enseignants. Mais on pourrait y trouver un précieux éclairage sur la naissance des thèmes politiques de la modernité, la question de la laïcité de l’État et du statut du religieux. C. Grellard propose une rapide approche du Court traité du pouvoir tyrannique (III, 7) : un droit naturel d’innocence pré-lapsaire, un second droit naturel de juridiction et de propriété, nécessités par la Chute et irrévocablement aliénés au Prince, tracent l’ébauche des débats à venir de philosophie du droit. Mais la valeur d’un tel éclairage, magistral pour des enseignants, peut-elle apparaître à des élèves qui n’ont aucune connaissance des textes de Hobbes, Locke ou Rousseau ?
Christophe Grellard, enseignant à Paris I et spécialiste de philosophie médiévale, en propose la gageure. Certes, la lecture requiert de connaître le contexte historique, d’opérer une approche non confessionnelle du texte saturé de questions religieuses, de surmonter la technicité du vocabulaire et la méconnaissance générale de cette période chez les enseignants. Mais on pourrait y trouver un précieux éclairage sur la naissance des thèmes politiques de la modernité, la question de la laïcité de l’État et du statut du religieux. C. Grellard propose une rapide approche du Court traité du pouvoir tyrannique (III, 7) : un droit naturel d’innocence pré-lapsaire, un second droit naturel de juridiction et de propriété, nécessités par la Chute et irrévocablement aliénés au Prince, tracent l’ébauche des débats à venir de philosophie du droit. Mais la valeur d’un tel éclairage, magistral pour des enseignants, peut-elle apparaître à des élèves qui n’ont aucune connaissance des textes de Hobbes, Locke ou Rousseau ?
« Un tout doté d’un caractère de continuité »
 Car la difficulté du choix de l’œuvre de lecture suivie repose aussi sur la place qui peut lui être impartie dans l’année en fonction du temps disponible. A travers les exemples donnés par Joël Dolbeau (Bergson) et Cécile Victorri (Platon), on s’interroge sur la manière de l’articuler avec l’étude des notions : présenter l’œuvre sous l’égide de notions (vérité et politique dans le Gorgias, l’art dans le Rire), ou présenter les notions à propos de l’œuvre, en convoquant d’autres textes (le droit du plus fort, dans Gorgias et le Contrat Social), voire un colloque de philosophes autour d’une question fondamentale. « Les œuvres retenues feront l’objet d’un commentaire suivi, soit dans leur intégralité, soit au travers de parties significatives, pourvu que celles-ci aient une certaine ampleur, forment un tout et présentent un caractère de continuité. », stipulent les instructions officielles. Peut-on traiter toutes les notions à travers l’étude d’une seule œuvre ? Peut-on sélectionner des passages et en abandonner d’autres, trop ardus ou spécialisés, sans perdre la continuité ? Comment faire, enfin, que l’étude soit profitable pour les élèves de niveau faible mais qui travaillent régulièrement et doivent pouvoir espérer une note correcte à l’oral de rattrapage ?
Car la difficulté du choix de l’œuvre de lecture suivie repose aussi sur la place qui peut lui être impartie dans l’année en fonction du temps disponible. A travers les exemples donnés par Joël Dolbeau (Bergson) et Cécile Victorri (Platon), on s’interroge sur la manière de l’articuler avec l’étude des notions : présenter l’œuvre sous l’égide de notions (vérité et politique dans le Gorgias, l’art dans le Rire), ou présenter les notions à propos de l’œuvre, en convoquant d’autres textes (le droit du plus fort, dans Gorgias et le Contrat Social), voire un colloque de philosophes autour d’une question fondamentale. « Les œuvres retenues feront l’objet d’un commentaire suivi, soit dans leur intégralité, soit au travers de parties significatives, pourvu que celles-ci aient une certaine ampleur, forment un tout et présentent un caractère de continuité. », stipulent les instructions officielles. Peut-on traiter toutes les notions à travers l’étude d’une seule œuvre ? Peut-on sélectionner des passages et en abandonner d’autres, trop ardus ou spécialisés, sans perdre la continuité ? Comment faire, enfin, que l’étude soit profitable pour les élèves de niveau faible mais qui travaillent régulièrement et doivent pouvoir espérer une note correcte à l’oral de rattrapage ?
Passer du temps sur l’œuvre suivie semble bénéfique, de l’avis commun, en termes d’acquis de méthode et de maîtrise de la démarche philosophique. N’en demeure pas moins que cette partie du programme pâtit sévèrement du syndrome de précipitation qui frappe le cours de philosophie à l’approche de l’échéance finale, en raison en particulier de l’amplitude et de l’indétermination d’un programme ouvrant à l’infini les possibilités de sujets d’examen, et mal adapté à un cursus scolaire assez peu tourné dans l’ensemble vers la créativité intellectuelle. Faire le choix d’œuvres moins courues et moins consensuelles, leur consacrer plus de temps, même au détriment du programme de notions, n’est-ce pas aussi confronter les élèves (pour qui rien n’est encore ni classique, ni familier en philosophie) au risque d’être un peu plus désarmés devant l’épreuve ?
Consulter les instructions officielles sur le programme :
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/25/MENE0301199A.htm
Joël Dolbeau, président de l’ACIREPh : « l’indétermination des programmes est un problème »
Sollicités pour participer à une réflexion sur la modification des épreuves de philosophie du bac technologique, sous l’autorité du Doyen de l’Inspection Générale, Paul Matthias, les responsables de l’ACIREPh, s’ils n’ont pas de projets arrêtés, ne manquent pas d’idées.
 Pour Joël Dolbeau, Président de l’association, il faut travailler des exemples précis d’épreuves alternatives, à tester et à corriger ensemble, qui puissent compléter ou remplacer la dissertation et l’explication de textes. Pas de postures théoriques fermées, donc, mais des propositions : introduire une évaluation de connaissances, par exemple, sous une forme qui serait à concevoir. Il repousse en souriant l’image du QCM, caricature souvent brandie par les tenants de la tradition : il y a en a bien d’autres manières de procéder – mais cela supposerait d’abord une meilleure détermination du programme, pour pouvoir s’accorder sur ce qu’on peut réellement évaluer. Une solution, souvent mentionnée, est cependant exclue par l’Inspection (voir ci-dessous l’interview de Paul Matthias) : l’évaluation orale systématique, trop lourde et trop coûteuse pour l’institution.
Pour Joël Dolbeau, Président de l’association, il faut travailler des exemples précis d’épreuves alternatives, à tester et à corriger ensemble, qui puissent compléter ou remplacer la dissertation et l’explication de textes. Pas de postures théoriques fermées, donc, mais des propositions : introduire une évaluation de connaissances, par exemple, sous une forme qui serait à concevoir. Il repousse en souriant l’image du QCM, caricature souvent brandie par les tenants de la tradition : il y a en a bien d’autres manières de procéder – mais cela supposerait d’abord une meilleure détermination du programme, pour pouvoir s’accorder sur ce qu’on peut réellement évaluer. Une solution, souvent mentionnée, est cependant exclue par l’Inspection (voir ci-dessous l’interview de Paul Matthias) : l’évaluation orale systématique, trop lourde et trop coûteuse pour l’institution.
Pour Joël Dolbeau, le bilan des expériences de philosophie menées en classe de seconde cette année devrait apporter un éclairage nouveau sur une possible révision des programmes et de l’organisation de l’enseignement de la philosophie, peut-être sur 3 ans et dans une perspective de progressivité qui reste encore à inventer.
Pour suivre les travaux de l’ACIREPh et consulter la revue Côté-Philo :
http://www.acireph.org/accueil_301.htm
Un entretien avec Paul Matthias dans le Café :
http://cafepedagogique.studio-thil.com/lemensuel/lenseignant/lettres/p[…]
Christophe Grellard, professeur de philosophie médiévale à Paris I : « La philosophie médiévale est en danger »
 Souffrant d’une désaffection croissante à l’Université, comme plusieurs filières philosophiques, le médiévisme est particulièrement mal en point et les postes d’enseignement ferment faute d’étudiants inscrits. La philosophie médiévale représente pourtant une dimension essentielle de l’histoire des idées, qui ne peut disparaître sans conséquences pour l’ensemble de la discipline. Selon Christophe Grellard, qui l’enseigne à Paris I, certaines spécificités contribuent à la rendre peu attractive au regard des étudiants : on la juge peu rentable aux concours qui ne l’intègrent guère, elle demande une réelle curiosité pour l’histoire et de bonnes connaissances en latin. Les étudiants la croisent peu avant la L3 et la peur de l’inconnu achève de les décourager : au moment de se spécialiser, préfèrent opter pour la philosophie antique, plus familière, ou l’éthique appliquée, plus en phase avec la demande sociale.
Souffrant d’une désaffection croissante à l’Université, comme plusieurs filières philosophiques, le médiévisme est particulièrement mal en point et les postes d’enseignement ferment faute d’étudiants inscrits. La philosophie médiévale représente pourtant une dimension essentielle de l’histoire des idées, qui ne peut disparaître sans conséquences pour l’ensemble de la discipline. Selon Christophe Grellard, qui l’enseigne à Paris I, certaines spécificités contribuent à la rendre peu attractive au regard des étudiants : on la juge peu rentable aux concours qui ne l’intègrent guère, elle demande une réelle curiosité pour l’histoire et de bonnes connaissances en latin. Les étudiants la croisent peu avant la L3 et la peur de l’inconnu achève de les décourager : au moment de se spécialiser, préfèrent opter pour la philosophie antique, plus familière, ou l’éthique appliquée, plus en phase avec la demande sociale.
Peu étudiée à l’Université, elle est aussi peu évoquée au lycée : les professeurs, vecteurs de transmission de la culture philosophique en France, la connaissent mal et manquent de temps pour l’inclure dans leur enseignement. A défaut de convergence avec le programme d’histoire au lycée, elle reste difficile à approcher aussi dans une perspective interdisciplinaire. Ce ne serait pourtant pas sans intérêt : loin de ne débattre que « du sexe des anges », la philosophie médiévale établit les grandes questions religieuses, mais aussi théoriques, linguistiques, politiques, qui vont faire la modernité, et qu’on présente trop souvent comme venues de nulle part. Aux États-Unis, l’influence forte de la philosophie analytique a conduit à redécouvrir l’œuvre de Guillaume d’Ockham, souvent éclipsée par celle de ses prestigieux adversaires, Thomas d’Aquin ou Duns Scott. C’est Guillaume d’Ockham qui a servi de modèle au romancier Umberto Eco, dans son roman Le Nom de la Rose, pour le personnage de Guillaume de Baskerville, rappelle Christophe Grellard. Peut-être une bonne manière de découvrir et d’apprécier la pensée d’Ockham, à l’occasion d’une relecture du roman ?
|
Sur le site du Café
|