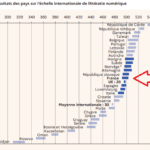- La réforme des bacs professionnels et technologiques critiquée dans un rapport de l’Assemblée
- F. Dhume : L’École, les stages en entreprises et la discrimination
Comment doubler le nombre d’apprentis dans l’éducation nationale ? C’est la question qui sous-tend le séminaire national réuni le 18 novembre à Paris par le ministère de l’éducation nationale. Les 200 cadres du système éducatif réunis doivent proposer des solutions pour réussir ce qui est presque un doublement du nombre d’apprentis. L’éducation nationale n’a pas le choix : l’ordre vient du président de la République. Mais comment changer de culture et se faire un allié de ce qui est encore perçu comme un concurrent ?
 « L’apprentissage facilite l’insertion professionnelle des jeunes. Alors soyons pragmatiques ». En ouvrant le séminaire national « développer l’apprentissage en EPLE », N. Vallaud-Belkacem fixe bien l’objectif : passer de 40 à 60 000 apprentis dans les établissements scolaires. Un défi qui est matériel mais aussi culturel et pédagogique.
« L’apprentissage facilite l’insertion professionnelle des jeunes. Alors soyons pragmatiques ». En ouvrant le séminaire national « développer l’apprentissage en EPLE », N. Vallaud-Belkacem fixe bien l’objectif : passer de 40 à 60 000 apprentis dans les établissements scolaires. Un défi qui est matériel mais aussi culturel et pédagogique.
Sur le plan matériel, développer l’apprentissage en lycée professionnel (LP) implique un soutien des régions . Il semble acquis. Mais de fait les académies partent de niveaux très différents. L’apprentissage est déjà très présent dans les académies de l’est, ainsi que de Lille et de Créteil ou Nantes. Il est quasi inexistant à Rennes, Nice ou Toulouse par exemple. Nationalement, l’apprentissage régresse dans les niveaux les plus concernés par les LP : CAP, bac pro. Il se développe dans le post bac.
Sur le plan pédagogique, l’apprentissage suppose de nouvelles méthodes du fait de l’alternance. Là le ministère a fait fort en publiant un guide pratique « Enseigner en apprentissage ». Le guide préconise « un mode d’enseignement adapté » associant « une organisation rigoureuse » et « une pédagogie dite intégrative ». L’enseignant doit intégrer sa pratique pédagogique dans un projet global d’enseignement. Il doit tenir compte de ce que l’élève fait en entreprise et organiser son enseignement en phases.
 Reste l’aspect culturel. « Dans les lycées professionnels il y a déjà une interaction avec les entreprises. Elle est fondamentale », nous explique François Bonneau, Président de la commission éducation de l’Association des Régions de France. « Il ne faut pas laisser se développer l’idée qu’en L.P. on est formé en dehors des réalités de l’entreprise ». Dans sa région, la région Centre, il constate que de plus en plus de LP le sollicitent pour créer des formations en alternance complètes ou mixtes. Interrogée par le Café pédagogique, N Vallaud-Belkacem convient que cette opposition « revient encore même si les mentalités évoluent. L’enseignement professionnel doit être soutenu et revalorisé », nous a-t-elle dit. Elle annoncera début décembre de nouveaux campus des métiers associant enseignement professionnel et alternance. Par ailleurs elle souligne le fait que la pédagogie de l’alternance « vaut pour tous les enseignants » et elle développera des formations communes entre enseignants et maitres de stage « pour qu’ils comprennent mieux l’équilibre d’un apprenti ».
Reste l’aspect culturel. « Dans les lycées professionnels il y a déjà une interaction avec les entreprises. Elle est fondamentale », nous explique François Bonneau, Président de la commission éducation de l’Association des Régions de France. « Il ne faut pas laisser se développer l’idée qu’en L.P. on est formé en dehors des réalités de l’entreprise ». Dans sa région, la région Centre, il constate que de plus en plus de LP le sollicitent pour créer des formations en alternance complètes ou mixtes. Interrogée par le Café pédagogique, N Vallaud-Belkacem convient que cette opposition « revient encore même si les mentalités évoluent. L’enseignement professionnel doit être soutenu et revalorisé », nous a-t-elle dit. Elle annoncera début décembre de nouveaux campus des métiers associant enseignement professionnel et alternance. Par ailleurs elle souligne le fait que la pédagogie de l’alternance « vaut pour tous les enseignants » et elle développera des formations communes entre enseignants et maitres de stage « pour qu’ils comprennent mieux l’équilibre d’un apprenti ».
Le séminaire doit fournir des propositions pour faciliter le développement de l’apprentissage dans l’éducation nationale. La ministre en a précisé quelques unes. Elle annonce que les outils d’orientation pots 3ème et post bac « prendront en compte l’apprentissage pour bien informer les élèves ». L’apprentissage sera aussi intégré au Parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde professionnel. Des banques de stages seront créées avec les régions. Des journées de découvertes organisées. La ministre souhaite aussi une meilleure organisation de l’offre de formation entre Etat et régions.
Reste une question épineuse : celle des discriminations qui frappent certains candidats à l’apprentissage. F Dhume, dans un rapport récent, a montré que la question gangrène les établissements. Pour F Bonneau, « il faut être vigilant et travailler avec les entreprises car certaines sont totalement ouvertes à l’insertion et acceptent des clauses sociales. Il faut lever els conditions pour lever les freins qui peuvent exister ». C’est bien la question du séminaire.
François Jarraud
Dhume : les discriminations
http://cafepedagogique.studio-thil.com/lexpresso/Pages/2014/01/06012014Article6[…]
- La réforme des bacs professionnels et technologiques critiquée dans un rapport de l’Assemblée
- F. Dhume : L’École, les stages en entreprises et la discrimination
Il ne suffira pas de créer des quotas pour les bacs professionnels et technologiques pour permettre la démocratisation du supérieur, explique Sandrine Doucet, rapporteure de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale dans un rapport que le Café pédagogique s’est procuré. Alors qu’on attend toujours l’évaluation par l’Inspection générale de la réforme des lycées de Luc Chatel, pour S. Doucet il n’y a pas de doute. La réforme des bacs pros et technologiques a dégradé leur niveau. Les professeurs de BTS en souffrent très particulièrement. Sandrine Doucet est la première voix qui s’élève publiquement sur un ressenti vécu par de nombreux enseignants des lycées : la situation se dégrade en STS (section de techniciens supérieurs amenant au BTS). Et cela a à voir avec la réforme des bacs professionnels et technologiques. Selon un procédé bien connu, la démocratisation de l’accès au bac s’accompagne d’une ségrégation croissante qui finit par remettre en question son objectif de hisser 50% d’une génération au niveau bac +3.
 À l’origine de ce rapport la volonté d’évaluer l’impact des quotas mis en place pour favoriser l’entrée des bacheliers professionnels et STS et des bacheliers technologiques en IUT suite à la loi de juillet 2013. Ces quotas sont fixés dans chaque académie en accord avec les directeurs d’IUT et les proviseurs des lycées qui disposent de STS. On en saura guère plus car l’administration n’a pas communiqué les taux des différentes académies à S. Doucet ce qui laisse planer des doutes sur leur mise en place réelle et sur la transparence des procédures d’affectation.
À l’origine de ce rapport la volonté d’évaluer l’impact des quotas mis en place pour favoriser l’entrée des bacheliers professionnels et STS et des bacheliers technologiques en IUT suite à la loi de juillet 2013. Ces quotas sont fixés dans chaque académie en accord avec les directeurs d’IUT et les proviseurs des lycées qui disposent de STS. On en saura guère plus car l’administration n’a pas communiqué les taux des différentes académies à S. Doucet ce qui laisse planer des doutes sur leur mise en place réelle et sur la transparence des procédures d’affectation.
Un jeu de chaises musicales entre SES, IUT et université
Si ces quotas ont été décidés c’est bien parce que l’accès à ces filières recherchées et sélectives devient plus difficile aux lycéens professionnels pour les STS et aux bacheliers technologiques pour les IUT. Selon S. Doucet, les bacheliers généraux représentaient 66% des étudiants inscrits en 1ère année en IUT soit exactement autant qu’en 2007 alors que près de 5 millions sont dépensés chaque année pour inciter les IUT à prendre davantage de bacheliers technologiques. Ces derniers représentent 29% des inscrits en 2013 comme en 2007. Clairement les IUT continuent à répondre favorablement aux demandes des bacheliers généraux pour cette filière. C’est que celle-ci tend à devenir une étape vers des études supérieures longues, une sorte de nouvelle CPGE. La majorité des élèves poursuivent des études supérieures après leur BTS ou DUT. Pour S Doucet, la finalité de ces deux filières est clairement en train de changer.
Résultat du maintien des bacheliers généraux en IUT, la pression des bacheliers technologiques perdure en STS. Certes les bacheliers professionnels ont augmenté parmi les inscrits en 1ère année de STS. Ils représentaient 12% des inscrits en 2007 contre 27% en 2013. Mais les bacheliers technologiques restent majoritaires alors que la série accueille aussi une proportion importante de jeunes qui se réorientent après un échec dans le supérieur universitaire. On assiste donc, selon S Doucet, à un jeu subtil de chaises musicales : la pression des bacheliers généraux en IUT rabat des bacheliers technologiques vers les STS et les bacheliers professionnels n’ont d’autre issue que de s’inscrire en université où leur taux de réussite en licence est de 3%. C’est ce phénomène qui a amené le législateur à imposer des quotas.
Pour S. Doucet, le système de quotas mis en place par le décret du 9 juillet 2014, commence à porter ses fruits. » Ainsi, sur les 101 198 candidats titulaires d’un baccalauréat professionnel (86 097 en 2013) », écrit-elle, « 79 537 (soit 79 %) ont fait porter leur premier voeu sur un BTS ou un BTS agricole (70 092 en 2013). Le nombre de propositions d’admission en BTS/BTSA faites aux candidats d’une terminale professionnelle s’est en outre accru de 12,5 % (+ 4 761). Par ailleurs, sur les 126 832 candidats titulaires d’un baccalauréat technologique (125 032 en 2013), 24 823 (soit 20 %) ont fait porter leur premier voeu sur un DUT (contre 22 518 en 2013, soit 18 %). Le nombre de propositions en DUT faites aux candidats d’une terminale technologique s’est également accru, mais de 6 % seulement (+ 878) ».
La chute de niveau des bacs pros et technos
Or le rapport souligne le fait que l’évaluation des nouveaux bacs pros et technos est « contrastée ». Ainsi la Fédération de l’enseignement privé (FEP)-CFDT, s’inquiète du niveau des bacheliers professionnels « au motif que le nouveau « bac pro » leur aurait fait perdre « l’habitude du travail » pour reprendre leurs propos. Cette situation est due au fait que le jeu actuel des coefficients rend possible l’obtention de ce diplôme en concentrant les efforts sur les matières professionnelles et les stages et en délaissant les matières générales telles que le français, les langues étrangères, les mathématiques et l’histoire-géographie. L’entrée en STS peut donc constituer une « rupture qualitative » pour ces bacheliers, d’autant que la « déperdition » entre la première et la deuxième année peut concerner jusqu’à 30 % des effectifs ». En IUT, » le « ressenti » des interlocuteurs de la rapporteure pour avis est dénué de toute ambiguïté. Ainsi, l’impression qui prévaut est celle d’un affaiblissement des compétences technologiques. Pour les responsables de l’Assemblée des directeurs d’IUT, le « profil » de ces bacheliers s’approche de celui des titulaires de baccalauréat général, la maîtrise du geste ayant cédé le pas à une approche plus conceptuelle. Les représentants du Syndicat national des personnels de la recherche et de l’enseignement supérieur-FO ont eu une opinion beaucoup plus tranchée, en considérant que le baccalauréat technologique est un « bac sans technologie ». »
Ces propos sont confirmés par les professionnels. « Les représentants de la CPME ont considéré que le « fléchage » des bacheliers professionnels vers les STS risquait de conduire à une baisse du niveau du brevet de technicien supérieur », écrit S. Doucet. Interrogée par le Café pédagogique, elle confirme. « C’est aussi l’avis du syndicat des chefs de travaux. Ils mettent en avant la qualité des BTS et ne veulent pas la perdre en s’ajustant aux bacs pros. La reforme du bac pro pose une question de niveau et de compétences ». Pour S Doucet il y a bien « un risque de décrochage » du BTS.
L’objectif des 50% de diplômés du supérieur ne sera pas atteint
Pour S Doucet, l’objectif des 50% de diplômés du supérieur ne sera atteint que parce qu’on prend en compte en France les BTS et DUT, des diplômes de cycle court. Celui de 21% de titulaires de bac +5 est inatteignable. En effet la hausse du pourcentage de bacheliers recherchée depuis 1989 ne s’est finalement faite que par la hausse du nombre des bacheliers professionnels. « Nous atteindrons certainement l’objectif des 80 % », écrit S Doucet, « mais sans que cette évolution, en raison de l’échec massif des bacheliers professionnels dans l’enseignement supérieur, nous aide à accroître le niveau de qualification de la population et à atteindre la cible des 50 % de diplômés du supérieur ». L’enseignement supérieur long continue à réserver ses diplômes aux bacheliers généraux et voue les bacheliers professionnels à l’échec (3% de reçus en licence). « C’est pourquoi les quotas ne suffiront pas à régler le double problème d’un accès démocratisé aux études supérieures et de l’élévation du niveau de qualification », écrit-elle.
Mieux accompagner les bacheliers professionnels
Pour S Doucet, des solutions existent pour faire face à ces problèmes. La question de fond reste l’augmentation du nombre de bacheliers généraux et technologiques. Il faut aussi selon elle mieux accompagner les bacheliers professionnels vers le supérieur. Elle préconise un accompagnement sur deux ans en terminale pro et première année de BTS avec des remédiations, voire des formules du BTS en trois ans ou de la première année d’université en deux ans.
Une autre piste avancée par S Doucet est la priorité donnée à la proximité dans les critères d’APB. S Doucet remarque que les élèves réussissent mieux quand ils restent dans leur lycée et que la proximité avec les enseignants est reconnue par les élèves comme un critère de réussite. Elle invite à faire entrer ce critère dans les paramètres d’APB « dans un sens de justice sociale pour consolider les élèves ».
La démocratisation ségrégative dénoncée par la rapport
Car au final, le rapport de S. Doucet dénonce la façon très particulière dont s’opère la démocratisation du système éducatif français en filières étanches scolairement et socialement. La hausse du taux de bacheliers se fait à travers des diplômes qui n’ouvrent pas réellement l’accès au supérieur. Le taux de réussite à la licence en trois ans des bacheliers professionnels est de 3,1 % seulement. En comparaison avec les étudiants issus d’un « bac » scientifique, leur chance de réussite est presque 10 fois moins élevée. On retrouve la même inégalité pour le BTS. 60 % des inscrits en première année de STS ont obtenu le BTS en deux ans et 9 % en trois ans. Seule la moitié des bacheliers professionnels inscrits en STS a obtenu un BTS en trois ans, ce qui nettement moins que les bacheliers technologiques (73 %) et les bacheliers généraux (85 %).
Or la composition sociale des deux types de bacheliers est très différente. On compte trois fois plus de titulaires du bac professionnel que du baccalauréat général chez les ouvriers (34,3 % contre 11,4 %) et un rapport inverse chez les cadres (10 % contre 36,1 %). Pour Sandrine Doucet, « on peut estimer, comme l’a fait le Syndicat général de l’éducation nationale-CFDT lors de son audition, que le contrat social proposé par la Nation à ces jeunes est totalement « faussé ». »
François Jarraud
Audition de S Doucet en commission
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cedu/14-15/c1415011.asp
- La réforme des bacs professionnels et technologiques critiquée dans un rapport de l’Assemblée
- F. Dhume : L’École, les stages en entreprises et la discrimination
L’École doit-elle s’adapter à l’entreprise ou doit-elle préserver ses valeurs, ses objectifs, même contre le monde professionnel ? L’objectif de l’École doit-il être l’insertion professionnelle d’abord ou la transmission de valeurs? Au point de rencontre de ces oppositions se trouve la question très concrète des stages. Fabrice Dhume-Sonzogni, sociologue chercheur à l’ISCRA, observe de près la façon dont l’École gère les pratiques discriminatoires des entreprises au moment de l’attribution des stages. L’observation fait mal ! Il dénonce dans un ouvrage publié par les Presses universitaires de Provence, les silences et par suite la participation de l’institution scolaire qui pense qu’oublier ses valeurs c’est parfois aider les élèves. Il montre aussi les conséquences de ce silence chez les élèves. Encore une fois, F Dhume-Sonzogni met le doigt là où ça fait mal…
 Peut-on avoir une idée de l’importance du phénomène de la discrimination durant les stages des élèves ?
Peut-on avoir une idée de l’importance du phénomène de la discrimination durant les stages des élèves ?
Il est très difficile de répondre à cette question, d’abord parce que nous disposons de peu de travaux d’évaluation, et cela dépend en outre de ce que nous entendons par discrimination. J’ai plus particulièrement travaillé sur la discrimination ethnico-raciale, pour laquelle existent quelques études, mais il n’y a quasiment aucun travaux de mesure relatifs à d’autres critères permettant d’avoir une idée de l’ampleur du phénomène. Divers rapports ministériels se sont penchés sur les « difficultés d’accès aux stages », mais ces études minorent la question des discriminations – voire ne prononcent pas même le nom – en la globalisant dans de longues listes de « freins » évoqués par les enseignants, et en la réduisant à des « comportements peu appropriés » des entreprises ainsi qu’au « handicap » de certains élèves ou à leur inadaptation face à la « réalité » des entreprises.
En 2000, l’Inspection générale de l’éducation nationale a estimé que la discrimination touchait entre 30% et 50% des élèves « d’origine étrangère » lors des recherches de stage. Le rapport a fait suffisamment de « bruit » pour que l’on inclut dans la loi du 16 novembre 2001 l’incrimination pénale des discriminations en stage, mais il n’a pas été diffusé, ce qui fait que nous ne savons pas sur quelles bases l’Inspection s’appuie pour cette estimation, ni ce que signifient ces chiffres (et par exemple ce qui est entendu par élèves « d’origine étrangère »)… À une échelle plus micro, dans une étude réalisée sur le pays de Montbéliard en 2000, j’avais travaillé notamment sur le système de placement en stages d’élèves du « dispositif de formation intégré » d’un collège : sur un panel de 200 entreprises du bassin sollicitées pour des stages, 20% des employeurs exprimaient ouvertement par téléphone des critères discriminatoires » (6/10 sur le critère « d’origine », 3/10 sur le critère de sexe, et 1/20 visant les « jeunes de SEGPA »). Tous limités qu’ils soient, ces chiffres manifestent le caractère massif du phénomène. Mais ces chiffres sous-estiment à l’évidence le phénomène, dont l’expression est bien plus souvent masquée. En outre, ils ne concernent que l’accès aux stages, alors que le phénomène est nettement plus vaste : quelques travaux portant sur l’expérience des élèves et étudiant(e)s montrent qu’ils connaissent tendanciellement un traitement différentiel sur plusieurs plans combinés : plus longue durée de recherche pour trouver un stage, plus de démarches à réaliser, plus fort taux de réponses négatives, concentration dans certains secteurs d’activités, moindres indemnités de stages… sans que tous ces éléments soient exclusivement liés à la discrimination. Nous n’avons pas à ce jour de vue globale et systématique du phénomène, mais il est clair par contre que les élèves comme les enseignants en connaissent la banalité, et qu’ils adaptent leurs pratiques en conséquence.
Vous parlez d’une « gestion routinière » de ces discriminations par les enseignants et même d’une certaine complicité. Que voulez vous dire ?
Justement, les enseignants ont tendance à banaliser le phénomène, par la manière dont ils gèrent le placement en stage. Pour comprendre cela, il faut revenir au dispositif de stage sous statut scolaire : en principe, la responsabilité du placement incombe aux enseignants, mais pour se faciliter le travail et sous couvert d’entraîner les élèves à leur future recherche d’emploi, ce sont généralement les élèves que l’on envoie chercher « leur » stage. De ce fait, l’expérience de la discrimination vécue par les élèves « n’arrive » que rarement jusqu’aux enseignants, ce qui leur permet de minimiser la situation. Les cas connus par l’enseignant sont relatifs à des élèves qui n’arrivent pas à trouver un stage dans le temps imparti : soit ils mettent en avant leur découragement face à la difficulté à trouver un stage et se voient rétorquer qu’ils se « victimisent », soit cela est interprété comme le signe que les élèves ne savent pas s’adapter aux enjeux de la situation. C’est donc assez mal parti pour reconnaître l’importance du phénomène !
Le travail enseignant en matière de placement en stage vise d’abord à ce que tous les élèves aient un stage, ce qui est souvent une condition de validation des diplômes. Pour y arriver, dans un contexte où les stages se multiplient et où la « concurrence » sur ce plan s’accroit, les enseignants construisent dans le temps des « réseaux » d’entreprises susceptibles de prendre des stagiaires ; cela prend du temps et de l’énergie, et l’économie du placement repose, selon les enseignants, sur le maintien de cet équilibre complexe. L’objectif prioritaire devient donc de maintenir ce potentiel de placement et de routiniser cette opération, ce qui veut dire aussi d’évacuer ce qui risquerait de faire problème : c’est ainsi que les enseignants en viennent à banaliser les questions comme la discrimination qui risquent de générer des conflits avec les employeurs, et ils préfèrent finalement tolérer le phénomène.
Pourtant la profession enseignante est plutôt animée par des valeurs qui sont opposées aux discriminations. Comment en arrive-t-on à cette prise en charge ?
Sur le principe, certes, la profession enseignante est souvent présentée (et se représente) comme antiraciste. Mais il y a ici une confusion : quand on parle de discriminations raciales, d’aucuns y entendent « pratiques de racistes », ce qui fait qu’il est assez compliqué de parler de discriminations parce qu’on prête à ce mot une charge accusatoire qui est en réalité héritée du discours moral antiraciste français. La discrimination est parfois liée directement à des préjugés racistes voire à l’adhésion à une idéologie raciste, mais c’est la face visible de l’iceberg, c’est la part moralement dénoncée de la question, mais cette part est en réalité marginale. La discrimination est relative au fonctionnement institutionnel global, aux rapports sociaux, et pas d’abord aux gestes individuels des agents. Dans mes travaux, j’essaie plutôt de montrer que la discrimination n’est pas d’une autre « nature » que les formes usuelles de sélection dans l’école (comme dans d’autres institutions). La discrimination renvoie plutôt aux moments et conditions auxquelles des catégories raciales, ethniques ou de genre, etc. deviennent des éléments tolérés ou « acceptables » des mécanismes de sélection. De ce point de vue, les principes antiracistes protègent peu de la discrimination, et ils deviennent même dans une certaine mesure un obstacle à la reconnaissance des discriminations.
Vous parlez d’une « coproduction » des discriminations par les enseignants. n’est-ce pas une formule très forte ?
L’idée de coproduction, formulée initialement par mon collègue de l’ISCRA, Olivier Noël, a d’abord été élaborée dans des travaux concernant les « intermédiaires à l’emploi » (missions, locales, pole emploi, etc.) : elle désigne le fait que des agents de ces services, bien qu’ils soient généralement opposés par principe à la discrimination, en viennent objectivement à en produire avec et/ou pour le compte de l’employeur, ou à « couvrir » et justifier la sélection discriminatoire. Cela ne se comprend que lorsqu’on entre dans les processus de travail, que l’on s’attache à comprendre comment les gens font avec les systèmes de contraintes qui sont les leurs, et dans quels rapports de force s’inscrit leur travail. Prenons un exemple : un enseignant qui se retrouve face à une demande discriminatoire de l’employeur (« envoyez-moi un garçon », « pas d’Arabe », « un jeune bien de chez nous, hein, on se comprend »…) est confronté à un dilemme. Mais il résout le plus souvent ce dilemme en choisissant de préserver son « réseau », et en faisant en sorte que la situation ne fasse pas problème, il montre qu’il « gère » (pas de conflit avec l’employeur, « pas de vague » pour l’institution). Ainsi, il trie les élèves, et n’adresse pas à l’employeur ceux que celui-ci ne veut pas voir, en pensant protéger les élèves non désirés d’une confrontation à la violence, et en pensant préserver son potentiel de places de stages sans se fâcher avec l’employeur : « si on ne trouve pas ici (pour l’élève discriminé) on trouvera ailleurs », etc. Ce faisant, l’enseignant discrimine pour le compte de l’employeur – la loi et la jurisprudence sont claires sur ce plan : la discrimination n’est pas constituée par l’intention éventuellement raciste, mais par le motif de la sélection. L’idée de coproduction veut rendre compte de cette situation : la discrimination n’est pas seulement le fait des employeurs qui « veulent » discriminer, mais elle est le produit d’une action en chaîne répondant à des logiques différentes mais conduisant à se mettre d’accord au final « sur le dos des publics », pour ainsi dire. Ce n’est pas la formule qui est forte, la formule ne fait que pointer un système de responsabilités croisées en incitant à regarder au-delà de l’adhésion formelle à des valeurs antiracistes ou à l’idée institutionnelle que le « professionnalisme » est une réponse simple à des dilemmes professionnels si complexes.
Comment les élèves victimes de ces discriminations les gèrent-elles ?
Tout d’abord, le rapport à la discrimination dépend d’une conscientisation des rapports sociaux : selon sa trajectoire et son expérience du monde, l’on apprend plus ou moins tôt sa condition de discriminé ou de discriminable – c’est-à-dire de personne potentiellement exposée à la discrimination. On peut vivre des années sans voir la discrimination qui nous vise, et ce d’autant que ces pratiques et processus sont masqués et expliqués autrement : les discours politiques sur « l’insertion », « l’intégration », « l’échec scolaire », etc. renvoient généralement la responsabilité de la situation aux élèves et aux familles ; et l’école fonctionne selon une « norme d’internalité » qui vise à apprendre aux enfants à rechercher en eux-mêmes la source de leur situation, à les responsabiliser à l’égard de ce qui leur arrive. C’est pourquoi la prise de conscience des discriminations est souvent brutale, dans la mesure où cela modifie radicalement la conception que l’on a du monde : un monde dans lequel les principes affichés ne sont pas la réalité vécue, et dans lequel l’on est obligé de réévaluer sa perception de soi : de « normal », on devient brusquement comme mineur ou subalterne dans l’ordre social, un être qui compte moins, exposé à des situations de violence ou d’humiliation qui ne concernent pas les membres du groupe dominant. Cette expérience produit un clivage radical dans les représentations du monde, car les membres des groupes dominants n’ont, eux, pas conscience que ce qu’ils vivent comme la « normalité » signifie pour d’autres de se sentir traité comme illégitime ou surnuméraire.
Il est important, de ce point de vue, de voir que pour les personnes discriminées, il n’y a souvent pas de différence nette entre la discrimination et une vaste série d’expériences d’humiliation, de stigmatisation, de violences… des plus implicites (les manières d’être regardé) aux plus explicites (les injures racistes, sexistes…). Etre discriminé, ce n’est pas rencontrer accidentellement et ponctuellement une situation de discrimination, c’est se rendre compte que cela se répète sous des formes et dans des situations différentes (à l’école, avec la police, dans le monde du travail, dans la rue, etc.) qui finissent par former continuité. Et ce d’autant plus que personne ne met fin à une situation de discrimination, sauf exception.
Par exemple, j’ai rencontré dans une enquête en lycée une jeune femme d’origine algérienne qui faisait un stage de secrétariat dans le cadre de son BEP ; dans l’entreprise, le patron lui a demandé de sélectionner les CV en mettant à la poubelle ceux dont le nom faisait « arabe » ou que l’adresse renvoyait à la « banlieue ». Cette jeune femme a donc appris, en stage, à discriminer, cela fait partie du curriculum « caché » mais réel de ce stage, car cela fait partie de la réalité du travail dans cette entreprise. Cette situation illégale a-t-elle été sanctionnée ? les pratiques de ce patron stoppées ? En aucun cas : cette jeune femme a donc dû en outre apprendre à ravaler la violence, à « mentir » (comme elle le dit) en bidonnant un rapport de stage qui ne reflétait pas le travail réel. Elle a été confirmée dans son expérience de l’école, où l’on présente les principes antiracistes et éventuellement un discours sur le droit, mais où ni ce droit ni ces principes ne servent effectivement à régler les relations sociales et les situations censément pédagogiques… C’est évidemment très violent.
Après, chacun « gère » comme il peut ces situations et ces contradictions, généralement renvoyé à la solitude de cette expérience. Ce n’est pas un hasard si beaucoup des jeunes concernés imaginent une assomption individuelle, et développent à partir de là un rapport utilitariste à l’école (et une surmobilité que la mondialisation capitaliste saura réexploiter)… Les réactions sont toutefois hétérogènes : soumission ou agressivité, surinvestissement ou décrochage, etc. La discrimination prend des sens différents dans les trajectoires, qu’elle éclaire en retour. Par contre, à travers mes recherches, nul(le) ne se pose en « victime ». La règle est plutôt qu’on ne parle pas de cette expérience, on l’intériorise en silence. Le discours sur la « victimisation » des jeunes ne correspond guère à une réalité empirique – ce qui ne veut pas dire que l’accusation de « discrimination » n’est pas parfois utilisée par eux pour dénoncer l’autoritarisme ou l’arbitraire scolaire, par exemple !
Qu’est-ce que cela nous apprend sur les rapports entre école et entreprises ?
Ces rapports sont complexes et en réalité variables, si l’on raisonne localement. Les établissements et les équipes sont pragmatiques, et ils s’adaptent souvent avec intelligence aux opportunités. Mais en fait on ne parle pas de cette réalité-là : ces questions sont captées par un discours surplombant et générique, sur le « partenariat École-Entreprise ». Le stage est présenté comme une recette politique à toute une série de problèmes publics – si l’on écoute le MEDEF, il prétend même résoudre les discriminations grâce aux stages, ce qui n’est pas le moindre des paradoxes… Ce discours, constant et croissant depuis les années 1970 , fonctionne à mon avis comme un « mensonge institué » – selon la formule du psychiatre Christophe Dejours. C’est-à-dire que nous avons affaire à un discours très éloigné de la réalité vécue, qui nie les rapports de pouvoir réels et les contradictions concrètes, mais qui s’impose comme la seule représentation légitime de la réalité. Cela contraint chacun à faire ce qu’il peut pour maintenir ce récit, avec plusieurs conséquences.
– Premièrement, les établissements scolaires sont pris dans un jeu d’image, et les équipes mettent une certaine énergie à organiser des « forums », des « rencontres école-entreprise », etc. en convoquant si possible la presse locale pour attester de leur conformité à ce récit mythologique du « rapprochement école-entreprise ». C’est en même temps une façon de valoriser l’établissement, dans la concurrence locale. Les élèves aussi sont convoqués dans cette opération : à travers leurs stages, on attend d’eux qu’ils soient de bons VRP de l’établissement.
– En conséquence, cette norme publicitaire peut justifier de stigmatiser les élèves qui n’y correspondent pas, et donc de disqualifier ceux qui résistent à une logique de soumission aux normes de l’insertion. Implicitement, les lieux de stage peuvent être hiérarchisés (de même que les formations et les filières), selon cet enjeu d’image à tenir ; et on peut aussi trier les élèves (qui place-t-on dans tel stage ?) en tenant compte de cette logique… jusqu’à, parfois, que la discrimination apparaisse comme une juste sanction de l’inadaptation des élèves.
– Troisièmement, au bout du compte, on charge tellement les stages de différentes logiques que le sens pédagogique et formatif peut disparaître. Avec la pression du discours favorable à l’entreprise, les enseignants se sentent en situation d’infériorité dans la relation. Leur sentiment d’être dépendant des employeurs pour placer leurs élèves fait que les enseignants abandonnent une part de leur travail : celle qui voudrait qu’ils négocient les conditions de pertinence des stages, et celle qui voudraient qu’ils garantissent le droit, notamment le droit prohibant la discrimination…
Le noeud du problème réside dans un non-dit : l’idée que l’école doit être plus en adéquation avec l’entreprise semble pour beaucoup relever du « bon sens », dans une époque qui a fait de l’objectif d’insertion professionnelle (et donc de « l’entreprise ») son horizon. Mais la question qu’on ne pose pas, ce faisant, est : quel doit être le sens de l’école ? Voilà la question politique dont nous devrions discuter, parce que tant que nous n’en parlons pas et n’en débattons pas, nous sommes collectivement pris dans une fuite en avant du discours néolibéral qui décrédibilise l’école (elle n’en ferait jamais assez), tandis qu’il idéalise « l’entreprise » (ce qui ne correspond pas au monde du travail réel).
Que devrait faire le système éducatif ?
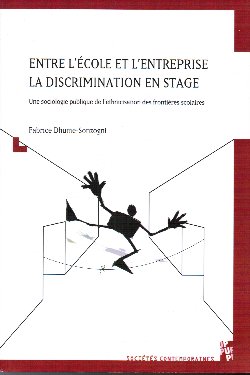 D’abord – mais dans le contexte actuel cela peut sembler un vœu pieux -, il y a lieu de rouvrir la question de ce que vise l’école. Car – les pédagogues le savent bien – l’on produit d’autant plus de violence et d’inégalités qu’on n’explicite pas ce que l’on exige. Cela veut dire simultanément d’abandonner le discours mythique qui veut faire croire que l’école pourrait (et donc devrait) former des professionnels clé-en-main si l’on ose dire. On peut accepter que l’école poursuive plusieurs objectifs (ce qu’elle a toujours fait), mais il est urgent de les hiérarchiser et de prendre acte des conséquences de ces choix. Quelle école voulons-nous ? Et là-dedans, pourquoi aurait-on besoin de « périodes de formation en entreprise » ? Et à quelles conditions ? De ce point de vue, le discours de l’institution a beaucoup changé : au milieu des années 1990, on avait du « partenariat » de l’école avec l’entreprise une visée pédagogique, un discours de la coopération ; depuis les années 2000, on est dans un discours plus hiérarchisant, celui de l’adaptation par l’école des élèves au monde du travail. C’est le retour d’un discours de normalisation.
D’abord – mais dans le contexte actuel cela peut sembler un vœu pieux -, il y a lieu de rouvrir la question de ce que vise l’école. Car – les pédagogues le savent bien – l’on produit d’autant plus de violence et d’inégalités qu’on n’explicite pas ce que l’on exige. Cela veut dire simultanément d’abandonner le discours mythique qui veut faire croire que l’école pourrait (et donc devrait) former des professionnels clé-en-main si l’on ose dire. On peut accepter que l’école poursuive plusieurs objectifs (ce qu’elle a toujours fait), mais il est urgent de les hiérarchiser et de prendre acte des conséquences de ces choix. Quelle école voulons-nous ? Et là-dedans, pourquoi aurait-on besoin de « périodes de formation en entreprise » ? Et à quelles conditions ? De ce point de vue, le discours de l’institution a beaucoup changé : au milieu des années 1990, on avait du « partenariat » de l’école avec l’entreprise une visée pédagogique, un discours de la coopération ; depuis les années 2000, on est dans un discours plus hiérarchisant, celui de l’adaptation par l’école des élèves au monde du travail. C’est le retour d’un discours de normalisation.
Ensuite, si l’on se concentre sur les stages, il faudrait travailler sérieusement aux conditions de sens de la formation : à quelles conditions un stage peut-il réellement être formateur ? Ces conditions ne peuvent seulement être définies a priori (dans les référentiels de formation), car elles engagent des pratiques des agents des établissements scolaires et des services où les élèves vont en stage. Posée ainsi, la question des stages suppose un fort investissement pédagogique, de coordination, de régulation, de coévaluation… mais cette part du travail n’est pas considérée (ou trop peu) aussi bien dans l’institution scolaire que dans les entreprises et services publics accueillant des stagiaires. Chaque tuteur de stage sait combien l’accueil d’un.e stagiaire est coûteux en temps et en énergie, si l’on veut le faire sérieusement. De ce point de vue, la démultiplication sans fin des stages, à tous les niveaux, est une impasse.
Enfin, travailler les questions de discrimination suppose de reconnaître politiquement cette réalité, ce qui est encore loin d’être le cas même si le discours du ministère évolue lentement. Plutôt qu’une politique « par en haut », qui prétend régler la question par une simple formation initiale des enseignants (cf. les programmes des ESPE, qui incluent formellement l’objectif de sensibiliser aux discriminations, ce qui est sans doute important mais au minimum insuffisant), je pense que nous gagnerions à investir sur les dynamiques d’établissement et d’équipes, en redisposant les ressources de formation des professionnels à cette échelle (ce que nous avions proposé dans le rapport Vers une politique française de l’égalité). L’enjeu est de travailler à l’échelle où les pratiques portent – là où il faut concrètement répondre aux discriminations qui se produisent -, et où l’analyse des organisations et des changements institutionnels peut être menée en fonction de ce qui serait susceptibles de soutenir le travail concret.
Propos recueillis par François Jarraud
Fabrice Dhume-Sonzogni, Entre l’école et l’entreprise : la discrimination en stage. Une sociologie publique de l’ethnicisation des frontières scolaires, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, coll. « Sociétés contemporaines », 2014, 272 p., ISBN : 978-2-85399-946-5.
Dossier intégration : Que dit le rapport Dhume ?
http://cafepedagogique.studio-thil.com/lemensuel/lenseignant/schumaines/educa[…]
Le tabou de la discrimination ethnique à l’École levé ?
http://cafepedagogique.studio-thil.com/lexpresso/Pages/2012/02/13022012_Et[…]
Pisa et l’apartheid scolaire
http://cafepedagogique.studio-thil.com/lexpresso/Pages/2013/12/03122013Article63[…]
|
Sur le site du Café
|