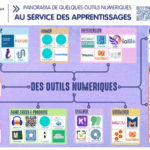Parmi les moments forts des «
rencontres sur l’accompagnement », des «démarches ». C’est la marque
de fabrique du GFEN. Outre les temps de conférence, des moments-clés
pour « vivre » dans sa chair le rapport au savoir, mettre en jeu son
estime de soi ou se plonger dans l’étonnant moment d’une démarche de
recherche collective. Avec un objectif : faire que ce moment reste
gravé comme un souvenir fort, un moment où on a incorporé un souvenir,
un choc, une rupture.
Au fil des deux jours, quelques une
au hasard, avec la limite de l‘exercice du compte-rendu : une «
démarche », ça ne se raconte pas, ça se vit…
Gérard Médioni : une expérience avec des
souris… Quand on veut aider, parfois on
Quand on veut aider, parfois on
fait le contraire… Afin de « bien y réfléchir », Gérard Médioni propose
à la trentaine d’enseignants, accompagnateurs, rééducateurs, formateurs
présents dans son atelier de vivre des situations concrètes. Il propose
donc tout de go à la salle une « expérience sur les souris », comme le
feraient des étudiants dans un laboratoire de psychologie. Plus d’un
participant est perplexe après la consigne : « Dix minutes pour inventer un
dispositif expérimental pour mettre en évidence les capacités
d’apprentissages d’un lot de souris blanches…». Contrainte
supplémentaire ? C’est à quatre par groupe qu’il va falloir inventer
l’expérience… Certains groupes imaginent des
Certains groupes imaginent des
dispositifs visant à mémoriser de parcours avec les yeux, d’autres
cherchent à attirer les mammifères avec des sons ou de la musique.
Certains montent des usines à gaz, quand d’autres font des choses très simples.
Mais
l’animateur dévoile soudain la tromperie : pour certains groupes, la
consigne écrite précisait que les souris étaient« géniales », quand les
autres étaient censés travailler avec des souris « moins douées ». Du
coup, que s’est-il passé dans la tête des groupes en train d’imaginer
des dispositifs d’apprentissage ? Il semble bien qu’on ait cherché sans
le savoir à modifier « l’attente » qu’on avait envers les souris.
Certains le reconnaissent comme une intention explicite, d’autres s’en
défendent… Le temps passe, les débats sont vifs.
Pour
l’animateur, il faut maintenant remonter sur « ce qui s’est passé »
dans le travail des groupes : certains ont intégré l’idée qu’à des
souris « pas douées », on ne pouvait pas demander de choses
compliquées. D’autres au contraire se sont dits qu’elles pouvaient
apprendre « plein de choses » puisqu’elles étaient géniales.
Vient
le temps de la théorisation : « effectivement, dit une participante,
dans mon école, quand un élève est en difficulté, on cherche d’abord à
lui « simplifier la tâche ». Parfois au risque de « l’assigner à
résidence », de faire baisser le niveau d’exigence, poursuit
l’animateur… Cet « effet Pygmalion » s’applique à l’enseignant, dans la
tête desquels il est parfois difficile d’être conscient de ces
mécanismes, mais au-delà pour trouver les leviers pour agir… Une participante interpelle le groupe
Une participante interpelle le groupe
: « Encore faut-il que les enseignants reconnaissent que la difficulté
existe ! ». Dans sa ZEP, elle regrette de constater qu’elle peine trop
souvent à mobiliser ses collègues.
On échange sur
la nécessité d’évaluer les difficultés, mais aussi trouver les
démarches qui vont permettre « d’habiter » les projets en donnant sens
à ce qui se passe dans la situation, qu’on soit en classe. « Au lieu d’émietter les
contenus en petits morceaux qui n’ont aucun goût, conclut
l’animateur, identifions
les grands nœuds conceptuels sur lequels il faut travailler, et faisons
le même pari que Rosenthal, qui montra dans les années 1960 qu’en
désignant aléatoirement des élèves comme « bons » ou « mauvais » aux
yeux des enseignants, il faisait se réaliser la prophétie… »
Christine Passerieux : le défi de
l’annonce…
Et
si au lieu de simplifier, on essayer de défier ? Mais pas dans
n’importe quelle condition…
Pour y travailler, Christine
Passerieux propose aux participants une situation dont elle juge
qu’elle est valable de la petite section aux adultes : récréer un
texte. « Cette situation ne produit jamais d’échec » lance-t-elle à la
salle avec un regard de défi. « Il s’agit de se mettre collectivement
dans la position de l’écrivain qui doit choisir, un mot, une tournure,
un rythme pour écrire un texte. D’abord seul, puis à plusieurs, on va
lire un texte, sans prendre aucune note, avant d’essayet d’en retrouver
le plus possible… Et je vous parie qu’on va réécrire le texte au mot
près. ».
Le texte est dévoilé au tableau, et
une fous la lecture silencieuse faite, l’inquiétude monte… Chacun est
appelé à écrire individuellement tout ce dont il se souvient… « Je ne
me rappelle plus de rien » chuchote une dame à sa voisine. Certains
notent des bribes, tentent désespérément de se remémorer les mots du
tableau…
Quelques minutes, et quelques regards
interrogateurs plus loin, Christine lance à la cantonade un « vous
voulez plus de temps ? ». Inutile… Chacun est arrivé au bout de ce
qu’il sait seul. Vient donc le temps de la deuxième consigne : « Chaque
groupe doit se metttre d’accord, ensemble, sur une version ». Chacun se
met à rassembler les bribes, à raconter les petits morceaux de film qui
sont dans sa tête. Au bout d’un quart d’heure, une première épreuve
naît. « C’est pas mal » dit tout fort une participants, « étonnée de
tout ce qu’on a retraduit malgré le bruit ».
Puis,
c’est la mise en commun entre les groupes, phase où l’animatrice
devient le réceptable de tous les échanges. L’animatrice est au
tableau, et annonce qu’elle va valider les phrases proposées par les
groupes. Le premier mot, « si », est accueilli sous les
applaudissements. Mais dès la première ligne, premiers empaillages
entre les groupes : les formulations varient, s’opposent, se
négocient… La charge est rude pour l’animatrice : réguler les
paroles, faire que chacun s’écoute, demander des explications
complémentaires, mettre en attente le plus décidés, scruter d’un œil
inquiet les bavards, rassurer les plus inquiets… Il faut que la parole
soit donnée à son tour, qu’elle puisse arriver à faire sentir les
ressorts poétiques du textes, faire entendre les jeux de langues, les
temps employés…
C’est long et c’est difficile, mais
le texte se découvre petit à petit. On s’accroche sur ce qui résiste,
et on s’aperçoit petit à petit qu’on n’a pas tous compris la même chose
: certains interviennent sur le sens, d’autre sur la musicalité des
mots. « Je me suis aperçue du poids du collectif pour m’aider à prendre
confiance, à mesurer que je n’étais pas seule en difficulté » revient
une participante dans la dernière phase du travail. En effet, à l’issue
de la démarche, l’animatrice revient avec les participants sur ce qui
s’est passé, sur ce qui a contribué à mobiliser les uns ou les autres,
de manière très diverse : ici, c’est la phase individuelle qui a
dérangé, quand d’autres se sont engagés dès le départ dans la tâche. A
l’inverse, la phase collective est désinvestie par certains, quand la
plupart se sont mobilisés pour faire valoir leur points de vue… Et
l’animatrice rappelle à ses élèves d’un jour que c’est à la fin de
l’écriture du poème que la tension est maximale dans le groupe, que
l’écoute s’est renforcée imperceptiblement, lorsque est venu le moment
de dire si la fin du texte était porteuse d’espoir ou au contraire
désespérée. « C’est quand la tension du sens impose l’engagement dans
l’activité, que les élèves vous oublient, tout entiers tendus vers la
résolution du problème » explique une participante à la fin de
l’atelier, n’en revenant pas de la force de la mobilisation collective.
Effectivement, à plusieurs, on va plus loin. A condition que
l’expertise de l’enseignant sache l’organiser avec la rigueur
nécessaire.
Déjà deux heures trente qu’on y est,
et le temps a filé sans qu’on y prenne garde.