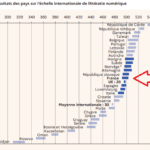« Qu’est-ce qui résume le mieux le rock qu’une guitare électrique ? » demande d’entrée de jeu, l’auteure du livre Véronique Servat. Voilà sans doute la question qui a mené à ce projet du livre pour cette historienne. Appréhender l’histoire par les objets, voilà ce qu’entreprend Véronique Servat dans son livre Bazar pop. Pour une histoire des musiques populaires. A l’occasion de la sortie de son livre, le Café pédagogique pose quelques questions à l’auteure.
« Qu’est-ce qui résume le mieux le rock qu’une guitare électrique ? » demande d’entrée de jeu, l’auteure du livre Véronique Servat. Voilà sans doute la question qui a mené à ce projet du livre pour cette historienne. Appréhender l’histoire par les objets, voilà ce qu’entreprend Véronique Servat dans son livre Bazar pop. Pour une histoire des musiques populaires. A l’occasion de la sortie de son livre, le Café pédagogique pose quelques questions à l’auteure.
« Bazar pop », écrire l’histoire sous forme de bazar peut apparaître comme contradictoire, quelle démarche a guidé votre livre ?
Dès le départ, il n’était aucunement question de m’engager dans une encyclopédie ou un catalogue. J’ai donc plutôt mis mes pas dans ceux d’historiennes et d’historiens qui ont initié puis alimenté le courant de l’histoire « par les objets », approche qui s’est traduite dans le domaine éditorial par des ouvrages remarqués tel que « Le magasin du monde » dirigé par P. Singaravelou et Sylvain Venayre (qui octroie cependant une place marginale aux objets musicaux). À la télévision, dans un format court et très accessible, le programme chapeauté par Patrick Boucheron sur Arte, « Faire l’histoire », participait aussi de cette démarche. Puis Mathilde Larrère a publié « Guns and Roses » sur les objets des luttes féministes. Toutes deux publiées aux Éditions du Détour, j’ai proposé à nos éditeurs de poursuivre dans ce sens avec une histoire des musiques populaires au prisme des objets qui ont accompagné leur développement. J’ajoute que le musée dans lequel je travaille expose des objets de la vie courante (vêtements, outils de travail, papiers administratifs, objets de dévotion) qui lui ont été donnés par des personnes ou leurs familles. Emblématiques de parcours de vie, parfois chaotiques, ils disent des trajectoires marquées par les migrations, l’exil, l’arrachement mais aussi l’enracinement, la construction de futurs parfois meilleurs, parfois pétris de désillusions. C’est assez fascinant de voir comment par le biais de ces traces inanimées du passé surgissent des histoires drôles, tragiques, toujours complexes. Cela a aussi compté dans le choix de l’approche choisie pour « Bazar pop ».
Cela dit, je ne pouvais construire mon livre comme un « Magasin de musique » car certains objets dont je souhaitais évoquer l’importance dans l’histoire des musiques populaires ne se vendent pas dans ce type d’officine. Je pense aux lunettes noires et aux seringues, aux vêtements ou encore au ballon de foot. C’est pourquoi le « bazar » était préférable au « magasin ». Ma liste d’objets établie, j’ai ensuite effectué des regroupements thématiques de façon à pouvoir m’emparer de problématiques et d’enjeux centraux de l’histoire des musiques populaires : leur mythologies, l’importance du moment fondateur autour du surgissement de la jeunesse comme groupe social, le poids des médias dans leur diffusion, l’existence de contre modèles. Je voulais aussi pouvoir parler des enjeux moraux, politiques et esthétiques qui traversent leur histoire. Pour ce faire, je me suis appuyée sur la riche production scientifique existante, mais aussi l’abondante littérature issue des érudits du milieu que peuvent être, par exemple, les critiques musicaux. Enfin je suis retournée dans les archives de presse ou audiovisuelles. J’espère avoir montré que l’histoire des musiques populaires s’écrit avec une grande diversité de sources qu’elles relèvent de la culture visuelle ou matérielle, de l’imprimé, du cinéma, de la littérature etc. Ces regroupements faits, j’ai souhaité, enfin, introduire chacune de mes thématiques par un titre musical, ce qui permet d’accompagner le livre d’une playlist, et d’entrer dans chaque chapitre de façon légère. Tout ces paramètres m’ont permis de m’engager dans l’écriture à l’appui d’une méthodologie historienne rigoureuse tout en restant accessible dans la forme du propos qui devait couvrir l’histoire des musiques populaires de leur apparition à nos jours, de manière à parler au plus grand nombre.
Pour vous les objets sont-ils ancrés dans une époque frappée d’obsolescence, ou des bouts d’éternité ?
Cela dépend un peu des objets à dire vrai. Un objet comme le walkman peut cocher les deux cases. Aujourd’hui, il a été supplanté par des outils technologiques plus performants. Pourtant, sa postérité a été assurée par le cinéma, les séries, les publicités : grâce à cela, il est encore présent dans nos vies, emblématique d’une époque, il s’est réinventé et modernisé, et sa descendance aide à écrire l’histoire de la musique nomade. Rappelons-nous que le jour de la naissance du walkman a été baptisé par Sony pour l’éternité : The day that music walked. Dans la mesure où l’histoire des musiques populaires dépend en grande partie de techniques et technologies appliquées aux moyens d’écoute ou supports d’enregistrement (du vinyle au CD, du CD au fichier MP3) il est certain que l’obsolescence est un de ses traits structurants. Mais l’industrie musicale est aussi une grande recycleuse, cela l’aide à dépasser certaines difficultés : on croyait le vinyle, Long Player ou 33 tours, mort et enterré après l’apparition du CD, condamné à errer pour l’éternité dans la grande mythologie du rock ouverte par le Sgt Pepper’s des Beatles, et puis la musique compressée a condamné le CD … Aujourd’hui les rayons des enseignes culturelles octroient davantage de place aux vinyles qu’aux CD, on trouve même des rayons de 33 tours dans les supermarchés. L’histoire de ces objets n’est pas linéaire et c’est ce qui en fait aussi l’intérêt.
Depuis plusieurs années, les musées s’intéressent à l’histoire des musiques populaires et proposent des expositions retraçant une époque, un genre musical, une trajectoire d’artiste. Les objets y sont évidemment très présents. Certains disent des permanences, d’autres des ruptures, mais beaucoup nous aident à penser des évolutions, et à questionner nos représentations : du blouson noir au casque en passant par la pochette de disque.
L’objet écrit-il une histoire, décrit-il une période musicale ou un moment historique ?
Encore une fois c’est très variable. Le jeté de petite culotte n’aurait pas pu se produire à l’époque des yéyés, dont certains n’ont jamais enregistré que des 45 tours car, à l’époque c’était vraiment le format d’enregistrement dominant. Certains éléments de culture visuelle telles que les lettres liquides que les graphistes vont utiliser sur les posters ou les pochettes de disques sont emblématiques des années hippies tout comme le LSD, tandis qu’une drogue comme l’ecstasy est surtout consommée vingt ans plus tard dans les clubs et les warehouses, anciens entrepôts, des grandes villes désindustrialisées où l’on danse sur des sons synthétiques. A contrario, la guitare est restée un instrument très présent : on l’associe toujours au rock mais elle a été sollicitée dans bien des genres musicaux tels que le zouk avec Jacob Desvarieux de Kassav ou encore les musiques touaregs de Tinariwen.
« Pour une histoire des musiques populaires », pourquoi le choix de cet adjectif ?
Le populaire ici ne porte pas sur l’histoire mais sur les musiques. Initialement, on appelait « musiques populaires » des musiques traditionnelles, ancrées dans des pratiques qui se transmettaient au sein ou entre groupes sociaux sans qu’on en garde, notamment, une trace enregistrée. Cela correspond par exemple aux musiques traditionnelles, dites parfois folkloriques, ou encore aux musiques du Sud des Etats-Unis du début du XXe siècle qu’Alan Lomax est allé enregistrer pour conserver les traces de leur histoire. Aujourd’hui elles intéressent plus spécifiquement les ethnomusicologues même si d’autres disciplines gardent un œil attentif à ce que disent leur histoire.
L’apparition du rock’n’roll au milieu des années 1950 est marquée par l’électrification, la diffusion des moyens d’écoute et d’enregistrement d’une musique plus rythmée. Surtout, il suscite un engouement incroyable de la part des jeunes. Un des moments clés pour le mesurer se situe en 1963 lorsque les adultes découvrent, quelque peu médusés, les manifestations déchainées des fans des Beatles – ce qu’on appelle la Beatlesmania – ou s’inquiètent de l’avenir de leurs rejetons venus écouter les yéyés au concert de la Nuit de la Nation, organisé à Paris, pour les un an du magazine Salut les copains, en juin. On peut alors parler de musiques électrifiées, amplifiées, ou populaires, autrement dit « pop », au sens où elles séduisent un large public à l’ère de la culture de masse.
Le terme « musiques populaires » s’est imposé dans le champ académique en France dans le sillage du courant britannique antérieur des Popular music studies auquel participent aussi bien des historien.nes, que des sociologues ou des musicologues. Il a ceci de pratique qu’il est très élastique. Il permet d’envisager l’objet depuis sa réception (les stars de l’industrie musicale transcendent les âges, les frontières et drainent un public de masse), ou par le biais des acteurs de cette histoire. Certes l’industrie musicale est tirée par des figures à la notoriété puissante, des professionnels renommés dans leur domaine mais le monde des amateurs de musiques (musicien.nes, fans) est lui aussi très riche et intéressant à observer. Il permet aussi de ne pas réduire le terme « musiques » au seul « rock » sachant que depuis sa naissance ce genre musical a évolué et que d’autres lui ont damé le pion en matière de popularité, le rap singulièrement. Le terme « musiques populaires » est donc une désignation idéale pour déplier le sujet, aller observer au sein de cet univers les contre-modèles ou les pratiques alternatives. Et ce cheminement, où l’on va croiser la cassette, le fanzine, le home studio, autant d’objets qui agglomèrent des pratiques amateures, nous engage dans l’écriture d’une histoire populaire de ces musiques.
Si vous deviez choisir UN objet, lequel et pourquoi ?
Aïe, c’est très difficile. J’aime beaucoup l’éco-système cassettes audio/walkman. D’abord pour me placer du point de vue du public plus que de l’artiste ou de l’industrie musicale. Ce sont des objets de mon adolescence. Ils offraient soudain un accès plus large à la musique en raison de leur moindre coût et de leur maniabilité. Enfin, on pouvait disposer de sa musique en toutes circonstances ou presque ! En même temps, il fallait mettre en branle toute une série de démarches et de gestes pour dupliquer un disque, enregistrer une émission de radio – in extenso ou par bouts (défi nettement plus technique car cela supposait de couper les publicités, les commentaires) – et pouvoir la faire sienne. Ensuite, on complétait les autocollants de la cassette et la fiche du boitier. Ce sont des supports dans lesquels la créativité du fan s’exprime de façon très spéciale, par le choix de l’écriture, la « customisation » qu’on va pouvoir y apporter. C’est aussi le plaisir d’offrir ces objets à quelqu’un de cher, d’y glisser plein d’émotions, de bouts d’intimité. Bref, c’est un duo qui joue à plein volume le morceau de la « madeleine de Proust », en même temps qu’il nous rappelle les pires heures de nos vies de fans de musique : lorsque le walkman mange la bande magnétique, qu’il faut sortir le bic pour la rembobiner et tenter de la sauver. Ils disent aussi comment l’objet ordinaire devient extraordinaire par la façon dont on se l’approprie et les émotions qu’il va porter.
Par-delà cette nostalgie, le duo d’objets porte déjà des enjeux que nous estimons, à tort, spécifiques à notre époque. Les débats sur la duplicabilité de l’œuvre musicale, sa reproduction à des fins privées ou commerciales, le nomadisme de l’écoute mais aussi les questions de santé publique sur l’audition – liées à l’écoute de la musique en continu à volume élevé par exemple – sont déjà présents dans le duo cassette/walkman. On les retrouve ensuite dans le duo CD enregistrable/Discman, puis MP3/Ipod etc. Bien avant Napster et les pirates du Net, dans les années 70/80, en Angleterre il y a eu une forte campagne anti copie à l’aide des cassettes. La cassette incarnait alors la menace numéro 1 de l’industrie musicale britannique. Je trouve ces épisodes éclairants pour lire les évolutions des pratiques actuelles. À peu près à la même époque, j’ai découvert l’existence de ce magazine musical anglais SFX disponible uniquement sur cassette, idée géniale pour les personnes mal ou non voyantes qui pouvaient accéder à des contenus de presse musicale, une médiation essentielle dans le secteur des musiques populaires.
Le duo walkman/cassette me plait aussi beaucoup car outre ses capacités à populariser et faire une place aux outsiders dans l’histoire des musiques populaires, ce sont des objets qui ont favorisé le dialogue avec d’autres industries culturelles telles que le cinéma ou les séries. Sans doute vous souvenez-vous que la jeune Vic (Sophie Marceau) a connu ses premières amours dans La boum avec un walkman et une cassette. Plus récemment, les magnifiques films Été 85 et Les magnétiques ont aussi fait appel à ces objets pourvoyeurs d’émotions musicales pour permettre à leurs spectateurs de comprendre les liens qui unissaient leurs personnages. J’apprécie ces porosités, ces migrations des objets des musiques populaires vers d’autres univers, y compris celui du sport par exemple, ce qui explique la présence du ballon de foot dans le « Bazar pop ». Elles disent leur omniprésence dans nos vies, leur centralité et leur capacité à ouvrir des espaces de dialogue féconds, là où trop souvent on a pu considérer le monde des musiques populaires comme une cohorte de chapelles musicales enfermées autour d’un genre et de ses codes.
Propos recueillis par Djéhanne Gani
Véronique Servat : Bazar pop. Pour une histoire des musiques populaires. Edition du Détour, 2024.