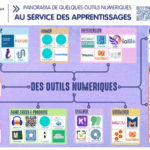Autres temps, autres mœurs. A l’âge (18 ans) où François Truffaut, déjà critique et féru de cinéma, concrétise son premier essai (« Une visite » en 1954), Nathan Ambrosioni, autodidacte et fan de films d’horreur, sort son premier long métrage ! Notre jeune auteur et réalisateur n’est cependant pas du genre fanfaron. Il s’émerveille encore de voir son scénario, envoyé par la poste, accueilli avec attention et exigence par une société de production, Sensito Films. Quelques mois après l’obtention du bac, il devient le plus jeune bénéficiaire de l’avance sur recettes, une aide sélective au financement attribuée aux projets de nouveaux venus par le Centre national du cinéma et de l’image animée. Un exploit vécu comme un encouragement pour ce provincial, étranger à la profession, soutenu depuis toujours par des parents bienveillants. Le propos des « Drapeaux de papier » n’a pourtant rien d’un conte édifiant pour enfants méritants. Le cinéaste en herbe choisit en effet un sujet ‘casse-cou’ : un drame social évoquant le difficile retour à la vie d’un jeune homme, fraichement sorti de prison au terme de douze années d’incarcération, et provisoirement hébergé par sa sœur cadette et son seul soutien. Loin des conventions du genre, la fiction sous tension, d’une simplicité radicale, suggère la force des émotions contenues, les flux et les reflux de la violence et du désir à l’œuvre dans la reconquête de soi, la construction des liens d’affection et d’amour. Une première œuvre dédiée à l’apprentissage de la liberté. Les premiers pas prometteurs d’un jeune créateur.
Dans le nu de la vie
 Un jeune homme cadré de dos dans les limbes d’un éclairage biaisé. Sa main caresse lentement son crâne rasé de façon prolongée : un geste répété (comme un signe distinctif) que nous retrouverons tout au long du récit dans les moments de tension intérieure du personnage central. Vincent (Guillaume Gouix, saisissante composition), 30 ans, vit les derniers moments de son séjour en prison. Une fois sorti, il frappe au domicile de la seule personne qu’il connaît. Charlie (Noémie Merlant, subtile interprète), 24 ans, sa sœur, -dont nous lisons l’étonnement mêlé de stupeur sur le visage au premier regard-, ouvre la porte et se dit prête à l’héberger dans son petit appartement le temps qu’il retrouve ses marques dans un monde méconnaissable et décroche …du travail après les douze années passées enfermé. Ce dernier répond aux petites annonces sans stratégie d’embauche au point de révéler d’où il vient à la première question de son interlocuteur et employeur potentiel au téléphone. Charlie rêve de devenir graphiste et vit modestement d’un emploi alimentaire de caissière et l’irruption de Vincent dans son existence bouleverse son fragile équilibre.
Un jeune homme cadré de dos dans les limbes d’un éclairage biaisé. Sa main caresse lentement son crâne rasé de façon prolongée : un geste répété (comme un signe distinctif) que nous retrouverons tout au long du récit dans les moments de tension intérieure du personnage central. Vincent (Guillaume Gouix, saisissante composition), 30 ans, vit les derniers moments de son séjour en prison. Une fois sorti, il frappe au domicile de la seule personne qu’il connaît. Charlie (Noémie Merlant, subtile interprète), 24 ans, sa sœur, -dont nous lisons l’étonnement mêlé de stupeur sur le visage au premier regard-, ouvre la porte et se dit prête à l’héberger dans son petit appartement le temps qu’il retrouve ses marques dans un monde méconnaissable et décroche …du travail après les douze années passées enfermé. Ce dernier répond aux petites annonces sans stratégie d’embauche au point de révéler d’où il vient à la première question de son interlocuteur et employeur potentiel au téléphone. Charlie rêve de devenir graphiste et vit modestement d’un emploi alimentaire de caissière et l’irruption de Vincent dans son existence bouleverse son fragile équilibre.
Chronique sociale minimaliste
Pour faire vivre cette confrontation, le jeune réalisateur ne s’embarrasse pas de rebondissements scénaristiques. L’argument, d’une simplicité extrême, explore le parcours difficile de réinsertion d’un jeune homme qui a perdu un âge décisif de sa vie (l’adolescence) dans l’enfermement après une enfance délinquante et des faits de violence (dont nous devinons quelques bribes). Au-delà des mots, nous voyons les visages et les corps des deux protagonistes, chez Vincent surtout l’écorché, nerfs à vif, colère à fleur de peau, la mise à l’épreuve de l’affection ‘fraternelle’ supposée évidente, les risques pris dans les relations avec les autres, ces inconnus. Des situations, considérées comme habituelles, prennent une toute autre dimension. Ainsi, au premier jour de son embauche comme serveur dans un restaurant, Vincent, le geste appliqué, l’attitude concentrée, est soudain pris, à la faveur d’un détail infime, d’une fureur agressive, un accès de violence destructrice et qui entraîne son renvoi immédiat.
Au fil de ce chaotique retour à la vie, peu d’explications nous sont fournies par les personnages eux-mêmes dont la caméra, mobile, familière, capte les frémissements, du moindre souffle au déferlement d’émotions. A ce titre, la relation avec le père (Jérôme Kircher, inquiétant) ritualisée autour d’un repas à trois échappe aux figures imposées à force de tension palpable, filmée dans son essor éruptif. Jusqu’à la reprise de l’affrontement archaïque, actualisé sous nos yeux, entre le père, bloc de pierre inaccessible, et le fils au tempérament volcanique, repris par le jeu infernal du rapport de force, avant qu’il ne revienne embrasser sa sœur de tout son corps massif.
Mise en scène épurée
Au bout du compte, le parcours semé d’embûches de l’irréductible Vincent rejoint des terres plus familières au ‘roman d’apprentissage’. L’épanouissement sentimental (lumineuse rencontre amoureuse avec Emma, incarnée par Alisson Paradis) et professionnel (dans le métier d’horticulteur) semblent se concrétiser durablement à la condition d’un éloignement (consenti) du frère et de la sœur. En réalité, l’intrigue a peu d’importance au regard de la pertinence des partis-pris de la mise en scène et de leurs effets sur notre perception. La manière de Nathan Ambrosioni privilégie en effet le rendu des affects, des pulsions de violence aux accès de tendresse, de l’instinct de survie aux élans du cœur. Ce sont toujours les émotions retenues ou débordantes que le réalisateur cherche à capter dans les mouvements du corps, les vibrations des visages. Ses héros manient peu les armes habituelles associées au langage pour formuler leurs émotions et leurs aspirations mais le jeune autodidacte du cinéma fait confiance à la caméra (proche, attentionnée) pour enregistrer les traces visibles des tourments intérieurs qui traversent les personnages.
L’originalité des cadrages serrés, les éclairages audacieux et la maîtrise du montage morcelé dessinent un atmosphère d’une inquiétante étrangeté comme si nous pénétrions dans ‘la pénombre des âmes’, dans l’intimité de psychismes déchirés.
Il est difficile de ne pas songer au cinéma du jeune et génial Xavier Dolan (une source d’inspiration revendiquée par Nathan Ambrosioni). Pourtant l’auteur des « Drapeaux de papier » s’éloigne de son modèle refusant le maniérisme et le lyrisme au profit d’une forme épurée et d’une sécheresse dans l’agencement des plans et le traitement (contenu) des effusions sentimentales (discrètement soutenues par la partition originale de Matthew Otto). Notre adepte des films d’horreur (et fabricant de courts-métrages forgés par ce genre dès l’achat d’une caméra à l’âge de 16 ans) déploie une mise en scène aux antipodes de cet univers d’enfance. Mais le propos manifeste une forme de noirceur, parfois effrayante, dans le regard porté sur la dureté du quotidien, à la manière des prermiers films de Cédric Kahn [« Bar des rails », 1991]
En fait, le premier film de Nathan Ambrosioni s’illustre par son style personnel, sa forme décapée de la plupart des conventions de genre, sa maîtrise saisissante. A sa façon, il laisse la porte ouverte à notre imagination pour approcher l’énigme d’une famille disloquée dont la mère, morte en Asie, laisse en cadeaux à ses enfants, des « drapeaux de papier ».
Samra Bonvoisin
« Les Drapeaux de papier, film de Nathan Ambrosioni-sortie le 13 février 2019
Prix du public, festival Premiers Plans d’Angers, Prix du public et du jury jeune, festival de La Roche-sur-Yon 2018