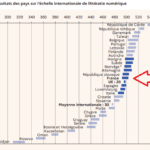Confrontés aux élèves à besoins éducatifs particuliers, les enseignants s’engagent dans l’innovation ordinaire. C’est ce que montre l’important dossier du numéro de novembre de la Nouvelle revue Éducation et société inclusives, coordonné par Serge Ebersold (CNAM). Pour lui, « ce qui se joue derrière ces questions, c’est la possibilité de repenser l’école de la république. On ne parle pas de 2 % de la population scolaire. On parle de la capacité de l’institution scolaire à prendre en considération de nouveaux enjeux liés à la diversité sociale et cognitive des élèves, de tous les élèves ».
Vous mettez en évidence que les enseignants peuvent résoudre les difficultés réelles qu’ils rencontrent avec l’école inclusive en « faisant avec » les normes usuelles, mais en faisant « autrement ». Cette possibilité d’un « autrement capable » ne peut-elle pas rassurer les acteurs en affirmant que l’école inclusive, c’est forcément une école où ils ont toute légitimité pour innover ?
 Quand la littérature met l’accent sur les contraintes, les paradoxes, les possibilités, etc., on oublie de prendre en considération la normativité des acteurs, que ce soient les enseignants, les chefs d’établissement, les personnes concernées et les familles. Cette normativité, c’est ce à travers quoi on va donner sens à ce que l’on fait. On va construire des petits pas de côté qui vont permettre de se retrouver dans ce que l’on entend faire et ce que l’on est, et dans les exigences qui nous sont faites.
Quand la littérature met l’accent sur les contraintes, les paradoxes, les possibilités, etc., on oublie de prendre en considération la normativité des acteurs, que ce soient les enseignants, les chefs d’établissement, les personnes concernées et les familles. Cette normativité, c’est ce à travers quoi on va donner sens à ce que l’on fait. On va construire des petits pas de côté qui vont permettre de se retrouver dans ce que l’on entend faire et ce que l’on est, et dans les exigences qui nous sont faites.
Rassurer les enseignants est important. Mais cela va au-delà. Il s’agit de leur permettre d’avoir des pôles de certitudes à partir desquelles il leur est possible de penser d’autres manières de faire. Je pense qu’à l’heure actuelle, cette absence de pôles de certitudes livre les enseignants à eux-mêmes. On demande aux acteurs de l’école d’innover au quotidien sans leur donner forcément les pôles de certitudes qui leur permettent de le penser. Ce que montre ce numéro de la Nouvelle revue, c’est que l’école inclusive repose sur l’innovation par l’usage et les petits pas de côté. L’école inclusive suppose de réfléchir à la manière dont l’accessibilité de l’environnement scolaire permet de capitaliser cette innovation, de la visibiliser et de la formaliser.
La notion d’innovation ordinaire nous paraissait intéressante. Ce n’est pas quelque chose qui se décrète, mais quelque chose qui se construit au quotidien par le menu, parce que ça fait sens, sans qu’on le définisse comme étant de l’innovation. On ne peut pas dissocier la notion d’innovation ordinaire de l’autrement capable de l’enseignant. Mettre en avant cet autrement capable, c’est fournir aux enseignants les moyens de faire valoir la reconnaissance des petits pas de côté qu’ils font au quotidien.
Quels types d’innovation « ordinaire » ces travaux observent-ils ?
Cette innovation ordinaire se matérialise à travers le travail de traduction qu’opèrent les acteurs de l’école en opérationnalisant les principes. Quand on met en place un projet d’établissement qui inclue, se joue la mise en sens de ce qui fait excellence dans le contexte, c’est-à-dire ce qui va permettre d’articuler dans l’établissement performance et équité.
Une des difficultés des enseignants, c’est quand le projet n’est pas vecteur de sens parce que les objectifs explicités sont extrêmement flous, les moyens mobilisés sont extrêmement vagues, et quand l’effet capacitant sur le plan didactique est absent. Alors que ce projet est censé servir d’épine dorsale, les enseignants sont livrés à eux-mêmes. Ils n’arrivent pas à y trouver les éléments leur permettant de repenser la relation enseignant-enseigné.
Et c’est là qu’il y a nécessité d’un travail d’innovation puisqu’ils sont obligés de reconfigurer cette relation en contexte. Ils développent ainsi un « art de faire » qui produit de la norme, une « norme autrement ».
La « mise en récit biographique » de l’élève est un autre élément autour duquel se jouent les possibilités d’innovation. À l’heure actuelle, le Geva-Sco ne fournit pas aux acteurs de l’école les éléments d’information permettant de penser la personne comme un élève. On y voit une personne « dans le besoin » dont la présence ne peut se penser que par le biais de la compensation. En même temps, la compensation qu’on propose est une compensation qui n’outille pas sur le plan didactique et pédagogique. Par exemple, comment l’outil numérique peut être inscrit dans le groupe classe. Comment l’AESH va soutenir les apprentissages des élèves.
C’est là que la mise en récit de la personne en tant qu’élève est essentielle. Si la mise en récit s’organise autour des conditions d’accessibilisation de l’environnement scolaire, ce n’est pas la même chose que si elle s’appuie autour d’un besoin d’appui ou d’aide.
Une autre composante me paraît importante : c’est la manière dont se constitue l’espace formalisé des possibles. Quand on réfléchit au partenariat, au travail collaboratif, on se rend compte que cela ne peut être pris comme une fin en soi. Ce qui est important dans les échanges, ce sont les formes d’interdépendance : on doit trouver des dynamiques non pas « collaboratives », mais des dynamiques « coopératives ». Quand on collabore, on travaille ensemble avec une définition donnée des rôles et des tâches des uns et des autres. Alors que la coopération consiste à co-construire les communs autour desquels on arrive à penser ce qui fait accessibilité ou pas. On s’accorde sur des règles. Les conventions qu’instaurent alors les acteurs sont importantes en permettant de transformer le travail collectif en collectif de travail.
Vous mettez en avant trois axes qui vous apparaissent féconds : le travail de traduction sociale, la production de communs, et la création de tiers-lieux. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s’agit ?
Le travail de traduction sociale, c’est transformer en modalités opératoires les principes. En pratique, c’est préciser comment on fait, quels sont les petits pas de côté que l’on fait, comment on intègre l’AESH dans la classe, comment on va s’appuyer sur le traducteur-interprète en LSF, comment le co-enseignement peut renforcer le transfert de connaissances et de compétences.
La production de communs renvoie plus précisément à la mise en sens collectif de l’impératif d’accessibilité. L’accessibilité, ça ne se décide pas, ça ne s’impose pas : ça se légitime. On va contextualiser les pratiques autour de ces communs qui constituent l’épine dorsale d’une dynamique collective et d’un collectif de travail.
Le collectif de travail s’incarne dans les conventions que l’on établit, qui ne sont pas forcément écrites mais qui ont un véritable rôle normatif et fonctionnent comme des repères normatifs. On s’est accordé là-dessus, on a défini qui travaille où, quand, comment, et on sait qu’il faut s’y tenir sinon cela on ne va pas y arriver.
Ces conventions contribuent à ce que la force novatrice qui caractérise l’éducation inclusive s’inscrive dans des « tiers-lieux », au sens où ces collectifs de travail ont des règles qui leur sont propres. Les conventions qu’établissent les acteurs conduisent à s’accorder sur un certain nombre de manières d’être et de faire qui permettent de trouver sens dans ce qu’on fait, à être reconnu dans ce qu’on fait, à identifier d’autres routines, sans pour autant être enfermé dans les contingences organisationnelles. Ce sont des espaces de respiration et de liberté qui me paraissent importants parce qu’ils permettent de construire la cohérence et la cohésion.
Les communs, c’est ce autour de quoi se joue le sens du principe inclusif. Les conventions, c’est ce autour de quoi se jouent les normes qui permettent de faire interdépendance. Et les tiers-lieux, ce sont ces collectifs de travail qui permettent d’agir dans un espace structurant et structuré en dépassant les contingences disciplinaires et organisationnelles.
Peut-on développer l’ambition inclusive sans décourager les professeurs et les élèves ?
C’est là que la notion d’autrement capable peut être intéressante. J’ai écrit un texte dans lequel je proposai de mettre le devenir de l’élève au centre, parce que c’est admettre que tout élève est « devenant » et qu’il dispose de capacités d’apprentissage au même titre que tout un chacun. L’intérêt de ce glissement de perspectives, c’est qu’il inscrit la scolarisation des élèves dans une « matrice capacitaire ». À l’heure actuelle, on évalue des besoins et on persiste à être dans une vision essentialiste qui ne renseigne pas sur les apprentissages des élèves. La « matrice capacitaire » invite à porter le regard sur l’autrement capable de l’élève en termes de connaissances, de capacités d’action, en termes de prise de responsabilités et en termes de verbalisation : je fais, je peux, j’agis, je dis, et je sais ! L’articulation de ces cinq verbes permet de s’appuyer sur les savoirs d’usage et des expertises d’usage que peuvent mobiliser les élèves et leur famille. Cette matrice capacitaire permet aux enseignants d’identifier les points d’appui qui permettent de corréler les programmes des cycles avec des compétences et des apprentissages. Il y a vraiment un travail à faire pour fournir aux enseignants des éléments d’information, des éléments d’appui pouvant consister en affinage du socle commun de compétences.
La notion de transition me tient aussi à cœur. À l’heure actuelle, on est dans une dynamique d’orientation où on informe la personne, puis on lui laisse le choix d’aller où elle a envie. Or l’enjeu, c’est de penser les cheminements. Le passage du primaire au collège n’est pas uniquement une affaire d’apprentissages. C’est aussi une nouvelle identité. L’identité d’élève n’est pas la même à l’école primaire, au collège et au lycée. La notion de transition peut être intéressante parce qu’elle permet de penser le cheminement. En pensant le cheminement de l’élève, les enseignants spécialisés peuvent travailler avec les acteurs en amont et en aval pour identifier les rites autour desquels l’élève endossera une autre identité. L’enseignant pourra ainsi reconfigurer la relation enseignant-enseigné sans être totalement perdu. On va s’interroger sur la valeur transitionnelle des soutiens et des aménagements dans l’endossement d’une autre identité. Ça manque, actuellement. Ça renvoie à l’effet capacitant des soutiens et du travail réalisé par les enseignants.
Le travail d’accessibilisation n’est-il pas aussi consubstantiel à la didactique qui est au cœur de l’action pédagogique ?
En travaillant sur les circulaires parues entre 1982 et 2011, on s’est rendu compte que la question de la didactique était de plus en plus évanescente, alors même que l’on parle de personnalisation, d’optimisation des compétences. Je crois qu’il est effectivement important de se saisir de la didactique pour penser les stratégies d’accessibilisation. On parle de « mise en accessibilité » comme s’il suffisait de le décider et d’appliquer les textes. Or, c’est là que la notion d’accessibilisation est extrêmement intéressante parce qu’elle va mettre l’accent sur les processus. Ce qui suppose d’interroger les dimensions didactiques au cours desquelles se joue l’accessibilisation de l’environnement scolaire.
Ce que montre le dossier, c’est que l’autrement et l’activité normative des individus participent d’une dynamique d’accessibilisation, d’un processus à travers lequel se construisent les conditions nécessaires à l’accessibilité de l’environnement pédagogique. Accessibiliser, c’est construire les conditions permettant à l’élève d’être dans la « zone proximale de développement ».
Finalement, ce qui se joue derrière ces questions, c’est la possibilité de repenser l’école de la république. On ne parle pas de 2 % de la population scolaire. On parle de la capacité de l’institution scolaire à prendre en considération de nouveaux enjeux liés à la diversité sociale et cognitive des élèves, de tous les élèves.
Propos recueillis par Dominique Momiron