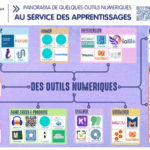Après avoir été enseignante pendant des années, Marina Tual est aujourd’hui maîtresse de conférence. Cette double casquette lui permet aujourd’hui d’avoir un regard nuancé sur la place de la recherche dans les gestes pédagogiques quotidiens des enseignant·es. « Rien ne va de soi quand on cherche à implémenter dans les classes des outils issus de la recherche » nous dit-elle. « Le métier d’enseignant, c’est hyper complexe, parce que c’est un super chef d’orchestre. Mais il faut les aider à ne pas tout réinventer chaque matin, parce que c’est un métier difficile ». Elle répond aux questions du Café pédagogique.
 Vous publiez plusieurs articles concernant les neuromythes, mais aussi le difficile passage de la recherche au terrain, ce qu’on appelle l’implémentation. Qu’est-ce qui vous a amené à ces objets de recherche ?
Vous publiez plusieurs articles concernant les neuromythes, mais aussi le difficile passage de la recherche au terrain, ce qu’on appelle l’implémentation. Qu’est-ce qui vous a amené à ces objets de recherche ?
J’ai commencé comme enseignante avec des élèves avec des troubles du comportement en ITEP, puis en SEGPA rurale ou urbaines, en REP+. Je me suis sentie très démunie, notamment avec les élèves qui avaient des difficultés de lecture. Je ne me sentais pas capable de les faire suffisamment progresser et assez vite. En fait, je me suis posé la question de l’efficacité de ce que je faisais. J’ai travaillé avec Fluence, des éditions La Cigale, Lector Lectrix, de R. Goigoux et S. Cèbe, je trouvais ça bien fait parce qu’il y avait aussi tout un volet recherche. J’ai senti le besoin d’aller me former comme enseignants spécialisée. La rencontre avec Fanny De La Haye a été déterminant parce j’ai apprécié d’expérimenter avec elle ses outils, notamment TACIT. J’ai été sensible à son discours clair « C’est pas aux enseignants de tout construire. Vous avez déjà beaucoup à faire dans vos classes ! ». On a travaillé ça dans un collège avec plusieurs collègues, pendant plusieurs années, avec des ateliers de fluence, de compréhension écrite, avec Lector Lectrix et TACIT, avec un énorme travail des enseignants. On trouvait que ça marchait vraiment bien. J’ai complété ma formation avec un Master 2 à St Brieuc avec F. De La Haye et Nathalie Bonneton, j’y ai pris beaucoup de plaisir.
Un peu par hasard, j’ai fait la connaissance de M. Gurgand et à mon grand étonnement, il a accepté de construire avec nous une évaluation de notre dispositif, et il m’a mis en relation avec Maryse Bianco et Pascal Bressoux, du LaRAC de Grenoble, et c’est comme ça que j’ai débuté ma thèse. Je suis actuellement maîtresse de conférences au laboratoire LaPsyDE et à l’INSPE de Paris.
Et votre travail universitaire a conforté votre travail ?
Pas du tout ! On a évalué l’efficacité de notre dispositif, en moyenne, et là pour moi, ça a été une douche froide : les résultats ne montraient pas d’effet ! On avait fait deux évaluations en parallèle, avec des méthodes un peu différentes, qui donnaient le même résultat. Une fois la stupeur et la déception passées, je me suis davantage intéressée à toutes les recherches sur l’implémentation. Qu’est-ce qui fait qu’un dispositif qu’on met en œuvre marche ou pas ? A quelles conditions ? On a interrogé les enseignants, les chefs d’établissement, on a fait des observations croisées en classe et en atelier, on a essayé de comprendre que certains résultats étaient aussi liés à la manière dont l’établissement avait porté l’expérimentation, les différences de modalités de formation, etc… Même si c’était riche, ce n’a pas été facile à vivre. Je me disais que si j’avais été conseillère pédagogique, j’aurais été très sûre de moi sur l’efficacité de notre approche, j’aurais fait pression sur les collègues et je n’aurais pas vu toute la complexité, tous les paramètres de l’efficacité lors de la diffusion d’un outil ! J’ai mesuré pourquoi c’est si compliqué de diffuser quelque chose qui non seulement était basé sur la recherche, mais qui avait marché pendant des années dans notre établissement
Quelles hypothèses avez-vous faites à ce moment ?
Je pense qu’il y a des pratiques fondées sur des données probantes qui sont plus efficaces que d’autres. En ce sens on peut parler de bloc standardisé. Cependant, il faut bien surveiller pendant la mise en œuvre les progrès des élèves et réajuster si besoin. Il y a alors essentiellement deux questions à se poser : met-on en œuvre le dispositif tel qu’il est prévu – mesure de la fidélité – et le dispositif est-il adapté aux besoins des élèves. Bref, tout un ensemble.
Pour que quelque chose fonctionne, il faut faire faire travailler ensemble plusieurs personnes à différents niveaux du système. Je pense aussi qu’il est très difficile d’identifier ce qu’on pourrait appeler les « éléments actifs », qui permettent de savoir si on a vraiment mis les bons ingrédients, si c’est l’utilisation de la méthode qui a été défaillante ou si c’est la méthode elle-même qu’il faut remettre en cause. Sinon, c’est comme un médicament : on ne peut rien dire de l’effet du médicament si on l’a mal pris !
Pourquoi pensez-vous que les neuro-mythes, comme les intelligences multiples ou le rôle différent du cerveau droit et gauche, sont-ils aussi développés ?
Dans la revue de recherche que nous avons réalisée, nous identifions de nombreux facteurs. D’abord, les biais cognitifs, le fait que les gens aiment bien confirmer ce qu’ils croient naturellement. Une très grande majorité d’enseignants pensent que les styles cognitifs existent, qu’on est visuel, auditif ou kinesthésique.
Ensuite, une mauvaise interprétation – ou diffusion – de résultats scientifiques. On croit encore que la dominante d’un hémisphère cérébral fait qu’on est artiste ou rationnel. Le préfixe « neuro » fonctionne comme une sorte de pensée magique garant d’une validité scientifique parce qu’issu des neurosciences, c’est à dire à la fois novateur et plein d’autorité. Pasquinelli parle de « neurophilie », Gentaz de « neuro-illusion ».
Bien sûr, la diffusion des neuromythes peut aussi venir de la diffusion médiatique, d’intérêts commerciaux ou encore de politiques qui cherchent des solutions simples, rapides et facilement applicables, alors que Sander nous invite à rester prudents face aux solutions simplistes pour des problèmes complexes. Cela implique pour les scientifiques la nécessité d’être particulièrement vigilants dans la diffusion et la communication de leurs travaux, à la fois dans la communauté scientifique et envers le grand public. Les résultats des sciences cognitives sont très importants, par exemple pour la mémorisation, mais pour savoir comment les mettre en place en classe avec 25 élèves, avec des élèves qui ont des troubles du comportement ou des dyslexiques, il y a encore tout un chemin !
Pour moi, l’idée principale, c’est surtout de montrer que l’intelligence n’est pas une chose donnée à l’avance, fixe, alors que beaucoup trop d’élèves ont déjà des idées catastrophiques là-dessus, que certains sont intelligents et d’autres pas. Il faut vraiment agir sur ces conceptions pour lutter contre les inégalités. Avec le LaPsyDE, nous avons un programme de recherche sur une intervention en maternelle pour aider les élèves à développer des connaissances et compétences métacognitives.
Pour revenir sur les outils pédagogiques, pensez-vous important que les chercheurs collaborent avec les enseignants et les formateurs pour concevoir des outils utilisables et efficaces ?
C’est la base, c’est une évidence. De nombreux chercheurs prennent déjà le temps de concevoir leurs outils de cette manière, en prenant le temps nécessaire des allers-et-retours. Diffuser des outils sans l’épreuve du terrain serait un non-sens. On essaie dans les classes, on réajuste. On se demande ce qui est acceptable par les enseignants, et ce qui est transférable d’un établissement à l’autre, d’un contexte à l’autre. Parce que je pense qu’on ne peut pas imaginer que chaque équipe soit accompagnée par une équipe de recherche.
Mais en tout état de cause, on a un gros problème en ce qui concerne l’efficacité, concernant cet accompagnement des enseignants. Certains programmes demandent que les enseignants essaient d’être le plus fidèles possible au programme pendant un an, avant de décider la seconde année d’ajustements ou d’adaptations. Je pense que c’est une voie à suivre, même si c’est compliqué. Chacun sait que tout outil peut être utilisé d’une manière tout à fait contreproductive par rapport aux intentions des auteurs, que ce soit Lector Lectrix ou les ateliers de fluence, si les enseignants ne sont pas en capacité de s’approprier les intentions des auteurs. Les enseignants ne sont pas des exécutants. Même pour un atelier Fluence, il faut bien comprendre qu’on ne s’occupe pas seulement de la vitesse, qu’on vise la compréhension, et que ça peut devenir n’importe quoi si c’est juste quelque chose de mécanique.
Est-ce une question de qualité de la formation, ou des formateurs ?
Je ne sais pas comment le dire, mais je pense qu’on court trop de lièvres à la fois, ça va trop vite.
Je crois qu’il y a beaucoup de modes dans l’éducation, de fausses innovations, comme l’explique André Tricot dans ses ouvrages sur les mythes en éducation. Il y a beaucoup d’agitation, je renverserais les choses en disant : « Il faut arrêter de changer tous les ans de mode ». C’est une souffrance pour les enseignants, ces réformes continuelles. Il y a beaucoup d’énergie perdue. Il faut travailler progressivement.
Quand je vois ce qu’on essaie de diffuser dans l’académie de Paris sur l’enseignement explicite, notre discours est vraiment de dire « ne jetez pas ce que vous faites, cherchons ensemble des voies d’amélioration progressive, continue ». Quand je vois comment travaille Marie Bocquillon, je trouve extraordinaire comment elle arrive à montrer aux enseignants, en travaillant avec des vidéos, tout ce qu’ils font déjà dans les gestes d’attention aux élèves, qu’elle aide à pointer et nommer. Elle parle toujours de « petits détails » qui fabriquent la dentelle que brode l’enseignant, et de son intérêt pour ça plutôt que pour les grands changements. L’idée n’est pas de leur imposer telle ou telle forme pédagogique. C’est l’intelligence de l’observation des pratiques qui est l’essentiel.
Nous allons arriver à une conclusion qui va sembler évidente à vos lecteurs : la nécessité d’une formation longue, la nécessité d’une vraie formation, d’un accompagnement de qualité, de la formation des formateurs, de la nécessité de casser les cloisonnements. C’est plus facile à dire qu’à faire…
Je voudrais vraiment insister sur la complexité de l’utilisation des connaissances de la recherche, sur le fait qu’il n’y ait pas de solution simple. La plupart des chercheurs en sciences cognitives sont conscients de cette difficulté. Que quoi qu’on fasse ou préconise, ça nécessite des conditions, de la finesse, de la collaboration, du temps, de la mesure, de la modestie. Et aussi beaucoup d’énergie et d’investissement de la part des cadres, pas seulement des directives. Le métier d’enseignant, c’est hyper complexe, parce que c’est un super chef d’orchestre. Mais il faut les aider à ne pas tout réinventer chaque matin, parce que c’est un métier difficile.
Les enseignants sont parfois désarçonnés par les personnes qui ne comprennent pas qu’ils expriment des difficultés ou des doutes. Mais il faut être un très bon enseignant pour pouvoir faire progresser un élève en grande difficulté, qui n’a pas du tout envie d’être là. C’est à soutenir ce travail que doit servir la recherche. Parce que l’essentiel, c’est de ne pas renoncer à réduire les inégalités.
Propos recueillis par Patrick Picard
Pour aller plus loin :
Du laboratoire à la salle de classe, le rôle central de la salle de classe